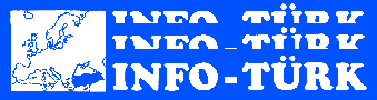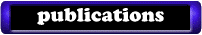Droits
de l'Homme / Human Rights
NGOs start campaign
against new bill 'threatening civil society'
Fifty-two
organizations have started a petition against a new bill allowing the
government to tighten the control on NGOs.
Having
passed the parliament's Committee for Justice, the bill will be
discussed in the general assembly Thursday (December 22).
The bill
authorizes the Ministry of Interior to dismiss NGO heads who have a
"terror" investigation against them, inspect NGOs on a yearly basis and
cancel unpermitted charity collection.
Although
the
proposal is named, "Bill on Preventing the Spread of Weapons of Mass
Destruction" only six of its 43 articles are about this subject.
CLICK
- New NGO bill under scrutiny over 'freedom of association'
concerns
The
petition
published on siviltoplumsusturulamaz.com says the bill is against the
Constitution and the human rights conventions signed by Turkey and
acquired rights.
The bill
"severely restricts" the charity collection and freedom of association
of NGOs and includes provisions that would ensure the "political
tutelage" of the Ministry of Interior on associations and foundations,
says the petition.
"If the
proposal passes into law without change, human rights associations,
associations that carry out activities in the fields of women's rights,
refugees' rights, children's-youth's rights, and LGBTI+ rights, various
legal associations, associations engaged in social struggles and
associations that use social funds, fellow country people associations,
sports clubs, and all of the associations and foundations of different
religious groups will face the risk of being closed with a single
signature and a 'quick shutdowné procedure will be created as the
administrative lawsuits to be filed will continue for years," notes the
petition.
The
petition
has been signed by 129 organizations, including IPS Communication
Foundation / bianet, the Human Rights Foundation of Turkey (TİHV/HRFT),
the Kaos GL Association, the Human Rights Association (İHD) and unions
affiliated with the Confederation of Progressive Trade Unions of Turkey
(DİSK) and the Confederation of Public Employees' Trade Unions (KESK). (BIA, 22 December 2020)
Jugé de nouveau, le mécène Kavala maintenu en détention
Un tribunal turc a maintenu vendredi en détention l'homme d'affaires et
philanthrope Osman Kavala, une figure de la société civile, à l'issue
de la première audience d'un nouveau procès pour des accusations
d'implication dans un putsch manqué en 2016.
Le tribunal a suivi la requête du parquet en rejetant la demande de
remise en liberté pendant la durée du procès formulée par les avocats
de M. Kavala, qui est détenu depuis plus de trois ans, selon une
correspondante de l'AFP sur place. La prochaine audience aura lieu le 5
février.
Les défenseurs de M. Kavala, qui jugent fallacieuses les accusations
pesant contre lui, nourrissaient l'espoir de le voir libéré par le
tribunal après des promesses de réformes des procédures judiciaires
faites par le président turc Recep Tayyip Erdogan.
Âgé de 63 ans, M. Kavala, incarcéré à la prison de Silivri en lisière
d'Istanbul, a assisté par visioconférence à cette audience au palais de
Justice de la mégalopole, qui est intervenue alors que la Cour
constitutionnelle doit prochainement examiner la légalité de sa
détention sans jugement depuis octobre 2017.
"Mon maintien en détention pendant des années, faisant fi de la
décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme et malgré
mon précédent acquittement par un tribunal local et deux ordres de
libération, n'est pas une violation ordinaire de mes droits. C'est
devenu une sorte de torture morale", a-t-il dit au juges avant la fin
de l'audience.
La prison à vie a été requise contre M. Kavala en octobre pour
"tentative de renversement du gouvernement", désignant une implication
présumée dans un putsch avorté contre M. Erdogan en juillet 2016, et
pour "espionnage politique".
"Ces accusations ne s'appuient pas sur la moindre preuve concrète.
Elles sont en totale contradiction avec ma vision du monde et mon
éthique", a dit M. Kavala au juge après la lecture de l'acte
d'accusation. "Ces allégations sont infondées. J'ai toujours été opposé
aux coups militaires et à l'interférence de l'armée en politique".
Décrit dans l'acte d'accusation comme le "collaborateur local" de M.
Kavala, le chercheur américain Henri Barkey, jugé par contumace, est
aussi visé par les mêmes charges. "Tout est inventé", a-t-il affirmé
dans un message à l'AFP.
La presse pro-gouvernementale a surnommé M. Kavala "le milliardaire
rouge", en le comparant au milliardaire américain George Soros, bête
noire de plusieurs dirigeants autoritaires dans le monde.
- "Le réduire au silence" -
M. Erdogan lui-même l'a accusé d'être "le représentant en Turquie" de
M. Soros et de "financer les terroristes".
M. Kavala est connu pour son soutien aux projets culturels portant sur
les droits des minorités, la question kurde et la réconciliation
arméno-turque.
Acquitté en février lors d'un premier procès portant sur son rôle
présumé dans des manifestations anti-gouvernementales en 2013, il avait
immédiatement été placé en détention dans le cadre d'une autre enquête
liée à la tentative de coup d'Etat.
Le Conseil de l'Europe, dont la Turquie fait partie, réclame la
libération de M. Kavala, en application d'une décision de la CEDH
estimant que son incarcération vise à le "réduire au silence".
"Nous sommes déçus par la décision du tribunal", a indiqué dans un
communiqué le rapporteur du Parlement européen sur la Turquie, Nacho
Sanchez Amor, estimant que la justice turque "a manqué une nouvelle
opportunité" pour se conformer aux décisions de la CEDH.
La comparution de M. Kavala a eu lieu sur fond de spéculations sur un
assouplissement des pressions exercées sur les opposants en Turquie
pouvant conduire à une libération de M. Kavala.
Dans un contexte de difficultés économiques susceptibles de plomber sa
popularité, M. Erdogan a en effet annoncé fin novembre des "réformes"
pour renforcer l'Etat de droit, dans l'espoir d'attirer des
investisseurs étrangers.
- "Intimider la société civile" -
Sezgin Tanrikulu, député social-démocrate et défenseur de longue date
des droits humains, a
estimé que la détention "sans base légale" de M. Kavala était une
manière pour le gouvernement d'"intimider la société civile" et les
milieux d'affaires.
Le député rend régulièrement visite à M. Kavala, un ami de longue date.
"Il n'avait jamais imaginé qu'il serait détenu aussi longtemps",
dit-il. "Mais il réalise parfaitement pourquoi on tient à le garder en
prison". (AFP, 18 déc
2020)
4th Session of 12th Gathering in Istanbul
The 4th and the last session of the 12th Gathering in Istanbul for
Freedom of Expression was held on December 13, 2020 in Istanbul with
the parti cipation of:
* Doğan Özgüden (Journalist, INFO-TÜRK -Exile)
* Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu (Constitutional Law, CHP MP)
* Ömer Faruk Gergerlioğlu (HDP MP)
* Mahmut Alınak (Lawyer, former MP)
* İsmail Beşikçi (Sociologist, Writer)
* Prof. Dr. Yaman Akdeniz (Freedom of Expression
Association)
* Ragıp Zarakolu (Journalist, Publisher -Exile)
* Engin Erkiner (Journalist -Exile)
* Oya Baydar (Sociologist, Writer)
* Aydın Engin (Journalist)
* Abdullah Kaya (Free Journalist, Diyadin-Ağrı)
* Ferhat Tunç (Singer -Exile)
* Prof. Dr. Baskın Oran (Political Sciences, Journalist,
Writer)
https://www.youtube.com/watch?v=_02cC00qhto&feature=youtu.be
Petition in support of 805 citizens demanding a
peaceful and secure life
On December 10 Human Rights Day, 805 citizens from Turkey released a
joint declaration, expressing their "common aim and demand for a
dignified and peaceful life, in a just, free and peaceful country,
where their daily bread and health will be safe and secure."
Shortly afterwards, they were targeted by Devlet Bahçeli, the Chair of
the Nationalist Movement Party (MHP), which is in the People's Alliance
with the ruling Justice and Development Party (AKP).
In response to this, a group of people have launched an online petition
on change.org in support and solidarity with the 805 citizens.
Sharing the joint declaration of the 805 citizens as well, the petition
has said, "I consider the insults and attacks targeting the signatories
to be personally targeting me and the people of Turkey and I sign the
text."
Entitled "We demand a dignified, peaceful and secure life", the
petition has read: "I join the 805 signatures calling on the opposition
to form a strong democratic alliance with a request for daily bread,
rights and justice for a dignified, peaceful and secure life together.
"Considering the heavy insults and attacks of MHP Chair Bahçeli and
other executives targeting the signatories to be personally targeting
me and the people of Turkey, I sign the text of Dignified, Peaceful
Life Together."


Call by 805 citizens for a dignified
and serene life, in a just, free and peaceful country
“Our common aim and demand is for a dignified and serene life, in a
just, free and peaceful country, where our daily bread and health will
be safe and secure,” say 805 citizens from different professions and
institutions on the occasion of Human Rights Day.
Today is December 10 Human Rights Day, which marks the 72nd year since
the adoption of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR).
On this occasion, 805 citizens from different backgrounds, professions
and institutions such as academics, writers, lawyers and physicians
have released a joint statement expressing their "common aim and demand
for a dignified and serene life, in a just, free and peaceful country,
where their daily bread and health will be safe and secure."
"While the pandemic deepens the economic, political and social crisis,
we need to envisage a new set of social relations and a radical change
in our way of looking at the world, in order to attain the kind of
humane life that we long for and deserve," the citizens have said and
added:
'From authoritarianism to totalitarianism...'
"It is increasingly clear that the one-man regime is neither able to
pull the country out of the disintegration it has engendered, nor can
it invent a new scenario. The aggressive reaction of the powers that be
to the debate over their 'reform' discourse, has once again proven that
their rhetoric serves only to delude and mislead the public.
"Above all, they see the evolution of the current regime from
authoritarianism to totalitarianism as a guarantee of their continued
rule.
What steps need to be taken?
We say that no rhetoric of reform can be convincing, or solve any of
our urgent problems, before:
• A fair amnesty is declared, covering especially political prisoners,
rather than discriminatory and arbitrary, sporadic discharges,
• Opposition writers and politicians, who are held in prison in
defiance of the rulings of the (Turkish) Constitutional Court and
European Court of Human Rights, are set free,
• Independence of the courts from the administration is ensured, and
the Council of Judges and Prosecutors is reorganized,
• Thousands of people, who, by means of "State of Emergency Decrees
with the Force of Law" (in the wake of the 15 July 2016 coup attempt),
were summarily and without due process dismissed from their jobs, their
passports seized, while some are continuing to serve jail sentences,
finally have their rights restored,
• More than 80 elected mayors representing millions of voters, but were
illegally replaced by the government, are returned to their positions,
• Threats to women's rights cease and equal rights come into effect –
(c.f. the Istanbul Convention)
• The plundering of natural resources and the environment for the sake
of profits is prevented; all the licenses and grandiose "crazy"
projects, which destroy and will continue to destroy nature of which
human beings are a part, are revoked, and resources directed towards
the basic needs of the people.
'Democratic participation is the cornerstone'
Today, while problems are piling up like mountains, we demand our right
to a dignified and peaceful life together, where we can look to the
future with confidence, and we say:
• A prerequisite for a dignified existence is that each and every
person has food, a job, and a minimum income sufficient to live in
humane conditions. People's needs for health, shelter, education must
be guaranteed by the state and the costs covered by appropriate
provisions in the budget.
• It is the duty of the state, to ensure equal rights and protection
for all identities, religions, denominations or beliefs, tongues and
cultures, without any discrimination. Everyone who lives in this
country, regardless of their identities, opinions, lifestyles, is equal
before the law and in the social domain. Freedom and equality are the
preconditions for the establishment of a commonality, and for society
to become "us" again.
• Democratic participation is the cornerstone of a shared existence and
a joint future. In order for all sections of the populace, without
exception, to express themselves freely and equally, to organize and to
take part in self-administration, the mechanisms for democratic
participation must be safeguarded.
'We need to nourish our hope for future'
"At this very critical step, we are in great need of keeping up and
nourishing our hope for the future. For 82 million citizens to live
freely with equal rights, within the common demands of the people, we
believe that, regardless of whether each wing is represented in the
parliament or not, a democratic alliance, which will leave no
democratic initiative outside its circle and will be the voice of
different aspirations all over the country, including women's
movements, environmental movements, artisans' guilds, agricultural
cooperatives, trade unions, professional associations, civil societal
organizations, platforms for rights and justice, with the consent and
mass support of the people, can become the hope of millions.
"When this is accomplished, people will head for the light and will
give their support to those, who nurture this hope, for our country to
reach level ground once again. We expect the democratic opposition to
show this courage, assume its duties and responsibilities, and swiftly
take the bold step to form an inclusive democratic alliance.
Signatories - 805 citizens
A. Demet Aşkın - Tıp Doktoru, Abbas Karakaya -
Yazar/Seslendirmeci, Abdilkadir Ertekin, Abdo Yılmaz - Emekli Mühendis,
Abdullah Çakır - İş İnsanı, Abdullah Demirbaş - Sur Eski Belediye
Başkanı, Abdullah Gökdağ - Emekli İmam/Hatip, Abdullah Karakuş - Yük.
Lisans Öğrencisi, Abdullah Keskin - Yayıncı, Abdullah Öncül - Urfa
Barosu Bşk., Abdullah Aydın - Öğretmen, Abdullah Aysu -
Tarım Uzmanı/Yazar, Abdurrahman Özpehlivan, Abdurrahman Öztürk -
Avukat, Abdülbaki Erdoğmuş - Eski Milletvekili, Abdülhakim Daş - Doğu
Güneydoğu Der. Plt. Bşk, Adalet Dinamit, Adil Okay, Adnan Bağcı - Mali
Müşavir, Adnan Genç - Gazeteci/Haberci, Adnan Gündoğan - İş Güvenliği
Yöneticisi, Adnan Özveri, Adnan Vural - SES Sağlık Emekçisi, Ahmet
Akşit - Tarihçi, Ahmet Aykaç - Emekli Akademisyen, Ahmet Bal - Emekli,
Ahmet Bozloy - Emekli Medya Direktörü, Ahmet Çakmak - Akademisyen,
Ahmet Cihan - Avukat, Ahmet Dindar - Avukat, Ahmet Doğan - Mühendis,
Ahmet Erdem - Öğretmen, Ahmet Gürgören - İşsiz, Ahmet Kardam - Yazar,
Ahmet Özer - Akademisyen, Ahmet Telli - Şair, Ahmet Türk - Siyasetçi,
Ahmet Güneştekin - Ressam, Ahmet Kuzik - Fotoğrafçı,
Ahmet Özmen - D.bakır Barosu Eski Bşk., Ahmet Ümit - Yazar,
Ahmet Faruk Ünsal - Eski milletvekili, Ahmet Hulusi Kırım -
Avukat, Ahmet Özdemir Aktan - Akademisyen, Ahmet T. Ural - Mühendis,
Akın Atalay - Avukat, Akın Atauz - Kent bilimci/Aktivist,
Akın Birdal, Alaattin Yüksel - Eski Milletvekili, Alev Er,
Ali Akel - İş İnsanı, Ali Baş - Mühendis, Ali Demiralp - Mühendis, Ali
Kulçay - Emekli Mühendis, Ali Mirzaoğlu - Emekli Sendikacı, Ali Özerk -
Mimar, Ali Rüzgar - Mimar, Ali Şahin - Yapım Koordinatörü, Ali
Çağan - Ozan, Ali Kaşıkçı - Hukukçu, Ali Nesin -
Matematikçi, Ali Arif Cangı - Avukat, Ali Ekber Kaypakkaya, Ali
Haydar Çavuş - Matbaacı, Ali Haydar Konca - Eski Bakan, Ali
Haydar Ben - DEDEF Genel Başkanı, Ali İbrahim Tutu - Eski
Milletvekili, Ali Kemal Özbiçer, Ali Naci Demiral - Emekli Mühendis,
Ali Rıza Ası - Emekli İş İnsanı, Ali Rıza Baloğlu - Bilgisayar Uzmanı,
Ali Rıza Şimşek - Yayıncı, Ali Türker Ertuncay - TV Program Yapımcısı,
Alican Uzun - İş İnsanı, Alkan Çiçek, Arif Mardin - Akademisyen,
Armağan Kargılı - Gazeteci, Artin Yasulkal - Serbest, Askeri Tanrıkulu
- İst. Diyarbakırlılar Der. Bşk., Aslan Demiral - TATOSDER Bşk.,
Aslı Erdoğan - Yazar, Ateş Aktaş - Emekli, Ateş Akyurtlu -
Akademisyen, Atilla Ansal - Akademisyen, Attila Tuygan, Avni Atam
- Y. Mühendis, Avni Kalkan, Avni Kaya - Akademisyen, Aydın Aydoğan -
Aktivist, Aydın Deniz - Gazeteci, Aydın Engin - Gazeteci/Yazar, Aydın
Erdoğan - Avukat, Ayfer Hortaçsu - Akademisyen, Ayfer Sargın - Emekli
Memur, Ayhan Ergenç - Tekstilci/DGD Plt. Sözcüsü, Ayhan Erkman - Yazar,
Ayhan Tural - İşçi, Aykan Erdemir - Akademisyen, Ayla Türksoy -
Gazeteci, Ayla Tokmak - Modelist, Aylin Tunçer - Arkeolog, Aysen
Altınel - Emekli Fransızca Okutmanı, Aysun Hankuet, Ayşe Batumlu Kaya,
Ayşe Cemal, Ayşe Erzan - Fizikçi, Ayşe Güngör - Eğitimci, Ayşe
Baykal - İngilizce Öğretmeni, Ayşe Gözen - Akademisyen,
Ayşe Hür - Tarihçi/Yazar, Ayşe Önal - Gazeteci/Yazar,
Ayşe Öncü - Akademisyen, Ayşe Berrin Ağaran - Akademisyen, Ayşe
Fidan Türkent - Emekli Okutman , Ayşegül Devecioğlu - Yazar, Ayşegül
İyidoğan, Ayşın Ekinci - Turist Rehberi, Ayşin Hangül - Mali Müşavir,
Ayten Eren - Diş Hekimi, Aziz Aygün - İşçi, Babür Pınar,
Bahadır Altan - Pilot, Bahadır Çakıroğlu - Öğretmen/İşsiz, Bahise Pirim
- Emekli Sendikacı, Barış Ulus - Görüntü Yönetmeni, Barış Trak -
İnş. Mühendisi/Mimar, Barış Yavuz - Avukat, Baskın Oran -
Akademisyen, Bayram Arslan - Emekli, Bayram Atakul - Emekli, Bayram
Erzurumluoğlu - Akademisyen, Bedrettin Günay - Emekli İmam/Hatip,
Begüm Yavuz - Emekli Halkla İlişkiler, Bektaş Şarklı - G.Antep
Baro Bşk., Berk Can Konuş - Öğrenci , Berkay Erkan - Emekli, Betül Koca
- Öğretmen, Beydağ Tıraş Öneri - Avukat, Beyhan Sunal - Öğrenci
Danışmanı, Bilal Kılıç - İşçi, Binnaz Toprak - Akademisyen, Bulduk Sarı
- Öğretmen, Burak Kalpaklıoğlu - İşçi, Burhan Sönmez - Yazar,
Burhanettin Kaya - Psikiyatr, Bülend Tuna - Mimar, Bülent Atamer
- Mühendis, Bülent Şık - Gıda Mühendisi/Akademisyen, Bülent Ant -
Mühendis, Bülent Felekoğlu - Tarihçi/Yazar, Bülent Tekin,
Cabbar Barış - Şirvan Dernekleri Fed. Bşk., Cahit Kırkazak - Avukat,
Cahit Lomen - Makine Mühendisi, Can İzar - Taş Ustası, Candan
Göksenin - B.M Emekli Memur, Cavlı Çulfaz, Celal Fırat - Alevi
Der. Fed. Gn. Bşk., Celal Meral - Matbaacı, Celal Ünsal - Emekli,
Celalettin Can - Gazeteci/Yazar, Cem Doğan - Akademisyen, Cem
Özdemir - Alman Parlementosu MV, Cemil Turan - Öğretmen, Cengiz
Arın - Akademisyen, Cengiz B. Toygür - Kimya Mühendisi, Cengizhan
Güngör - Emekli, Cenk Tahmisçioğlu - Mühendis/Yönetici, Ceren Şengül -
Doktor, Ceren Kahraman Bereket - Mimar, Cevat Keskin - Hukukçu,
Cevher Bilgin - Emekli İnş., Ceyhun İrgil - 25 26. Dönem Milletvekili,
Cihan Yiğin, Cihan Aydın - Diyarbakır Baro Başkanı, Cihan Şenoğuz
- Emekli, Cihan Uzunçarşılı Baysal - Bağımsız Araştırmacı,
Coşkun Üsterci - İktisatçı, Cuma Boynukara - Tiyatro Yazarı,
Cuma Coşan - Bismil Der. Bşk., Cumali Uyan - Gazeteci, Cüneyt
Batur - Öğretmen, Cüneyt Ozansoy - Akademisyen, Çiğdem Koç -
Avukat, Danende Zeynep Alpar - Çevirmen, Delal Seven Gibbs - Öğretmen,
Demet Parlar - Tıp Doktoru, Deniz Erdoğdu - Tıp Doktoru, Deniz İlgün -
İş İnsanı, Deniz Cankoçak - Muhreç Uzman, Deniz Nazlım -
Gazeteci, Derya Tolgay - Tasarımcı, Devin Bahçeci - Stratejik İletişim
Uzmanı, Dilek Demir - Modelist/Stilist, Dilek Dindar - Gazeteci, Dilek
Gökçin - Yönetmen, Dilsa Deniz - Akademisyen, Dizdar Aytek - Mali
Müşavir, Doğan Bermek - Mimar/Sivil Haklar Savunucusu, Doğan Bozcuk -
Mühendis/Şirket sahibi, Doğan Konuk - Mimar, Doğan Özgüden -
Gazeteci/Yazar, Doğan Özkan - Yazar, Ecevit Ceylan - Silvanlılar Der.
Bşk., Edip Yüksel - Akademisyen, Efe Engin - PSAKD İnanç Kurulu, Ekin
Duru - Çevirmen, Ekrem Baran - Mele, Elçin Aykaç - Psikolog, Emel Kurma
- Koordinatör, Emel Uzman - Emekli, Emin Çeşmebaşı - Saydan, Emine
Erdem - Öğretmen, Emine Yüzgeç - Öğretmen, Eminenur Diler - Takı
Tasarımcısı, Emir Ali Türkmen - Yayıncı, Enes Atilla Pay - Mimar, Enver
Karabey - Emekli İmam, Erbil Coşkuner, Ercan Belge - Muhasebeci, Ercan
Fadır - Yerel Yönetimler Uzmanı, Ercan Geçmez - Hacı B. Veli Ana. Kül.
V. Gn. Bşk., Ercan İpekçi - Avukat, Erdal Aydemir - Esnaf, Erdal Dalgıç
- Şair, Erdal Doğan - Avukat, Erdal Karayazgan - Mühendis, Erdal
Kılıçkaya - Avr. Alevi Konf. Gen. Sekreteri, Erdal Yıldırım - Yazar,
Erdem Vardar - Yüksek Mühendis, Erdoğan Aydın - Tarihçi/Yazar, Erdoğan
Kahyaoğlu - Yazar, Ergin Avcı - Muhreç Öğretmen , Ergin Cinmen -
Avukat, Ergün Eşsizoğlu - Emekli, Erol Çırak - Mali Müşavir, Erol
Kızılelma - SODEV Eski Başkanı, Erol Özkoray, Ersin Kalaycıoğlu -
Akademisyen, Ersoy Yıldırım, Ertan Zereyak - Akademisyen, Ertuğrul
Günay - Kültür Eski Bakanı, Ertuğrul Işık - Mühendis, Esat Korkmaz -
Yazar, Eser Karakaş - Akademisyen, Esin Gürel - Emekli, Esin Yılmaz -
Öğretmen, Esmahan Aykol - Yazar, Esra Koç - Mühendis, Esra Mungan -
Akademisyen, Esra Çiftçi - Gazeteci, Eşber Yağmurdereli,
Eşref Erdem - Eski milletvekili, Eşref Dağ - Yaşam Savunucusu,
Evren Altıner - Hekim, Ezel Akay - Yönetmen, F. Ahmet
Tamer, Fahrettin Şeker - Emekli İmam/Yazar, Fahrettin Ülgün, Faik
Güleçyüz - Emekli, Fatih Balkan, Fatime Akalın, Fatin Kanat - İHD
Ankara Şube Eşbaşkanı, Fatma Aytaç - Endüstri Mühendisi, Fatma İrier -
Emekli, Fatma Karakaş Doğan - Akademisyen, Fatma Bostan Ünsal,
Fatoş Tanyeri, Ferhat Yanık - Muhreç Polis, Ferhat Tunç -
Müzisyen, Fethiye Çetin - Avukat, Fevzi Şahin - İşletmeci, Fevziye
Aksoy - Mimar, Feyha Karslı, Feyyaz Kurşuncu - Çiftçi,
Fırat Diyadin, Fikret Beğer - Gayrımenkul Danışmanı, Fikret
Başkaya, Fikri Sağlar - Eski Milletvekili, Firdevs Güremen -
Kimya Mühendisi, Fuat Akbaş - Sosyolog, Fulya Barutçuoğlu - Duyarlı
Vatandaş, Funda Oral - Emekli/Çevirmen, Funda Türkeli - Kimya
Mühendisi, Furkan Bahadır Demirhan - Öğrenci, Gabriel Agirman -
Aktivist , Gani Kaplan - Pir S. Abdal Kültür Der. Gen. Bşk., Gaye
Boralıoğlu - Yazar, Gençay Gürsoy - Akademisyen, Gökhan Kaya, Gökhan
Özbek - Gazeteci, Göksal Çelik, Gökşin Sanlav - Esnaf, Gönül Koçtürk -
Sigortacı, Gülder Değirmencioğlu - Emekli Bankacı, Gülhis Erdost,
Gülnur Aksop - Emekli, Gülperi Kaya - Sosyal Pedogog, Gülser Öztunalı
Kayır - Akademisyen, Gülseren Onanç, Gülsinem Tantekin - Sinema Tiyatro
Teşrifatçısı, Gülsüm Postacı - Sosyal Medya Uzmanı, Gülşen Batur -
Öğretmen, Gülşin Gürkan - Aktivist, Gülten Gülay - Akademisyen,
Gülten Sönmez Seber, Günal Kurşun - Akademisyen, Güngör Şenkal,
Günsel Aydoğdu - Öğretmen, Gürel Tüzün, Gürhan Ertür - Emekli, Gürşenay
Dalveren - Muhasebeci, Güven Güzeldere - Felsefeci, H. Cavit Sarıoğlu -
İnş. Mühendisi/Mimar, Hacay Yılmaz, Hacer Ansal - Akademisyen,
Hacı Orman, Hadi Cin - Avukat, Hakan Örmen - Biyokimya Uzmanı,
Hakim Tokmak - MUŞDERFED Bşk., Haldun Açıksözlü, Halil Ergün - Sanatçı,
Halil Savda, Halil İbrahim Yenigün - Akademisyen, Halim Bulutoğlu
- İş İnsanı, Halis Ertaş - AMEDFED Bşk. Yrd., Halit Beşeli - Y. Mimar,
Halit Erdem - Emekli Sendikacı/Metal İşçisi, Haluk Ağabeyoğlu, Haluk
Özdalga - Yük. Müh. Ankara Eski MV, Haluk Yurtkuran - Turizmci/Yeşiller
Partisi Kur. Üye, Hamza Bayındır, Hanife Yüksel, Hanna Beth Sawoce,
Harika Günay Karataş - Avukat, Harun Gerizli - Asker, Hasan
Arıcan, Hasan Cemal - Gazeteci/Yazar, Hasan Doğan - PSAKD İnanç Kurulu,
Hasan Koç - Gümrük Müşaviri, Hasan Tanrıkut - Mersin Dersimliler Dernek
Bşk., Hasan Ürel - Avukat, Hasan Öztoprak - Yazar, Hasan
Şen - DEDEF Genel Sekreteri, Hasan Cevad Özdil - Mimar/Yazar, Hatice
Kavran - Dil Bilimci, Hatice Salan - Öğretmen, Hatice Ulus Keskin -
Öğretmen, Haydar Aygören - İş İnsanı, Haydar Ergülen - Yazar/Şair,
Haydar Özdemir - Mersin Yenişehir Bld. Mec. Üyesi, Hayko Bağdat -
Yazar, Hayri İnönü - Belediye Eski Başkanı, Hayri Zafer Korkmaz,
Hekim Coşkun - Aktivist, Hıdır Çelik - Akademisyen, Hicri İzgören,
Hikmet Enkür - Emekli Mali Müşavir, Hilal Küey - Avukat, Huri Özdoğan -
Akademisyen, Hülya Gülbahar - Avukat, Hülya Kirmanoğlu - Akademisyen,
Hülya Noack - Ev Kadını, Hürriyet Karadeniz - Emekli, Hüseyin Demirton
- İHD Ankara YK, Hüseyin Esentürk - 78'liler Federasyonu YK, Hüseyin
Gökoğlu - Emekli, Hüseyin Güzelgüz - Alevi Bektaşi Fed. Gen. Bşk.,
Hüseyin İnanç, Hüseyin Mat - Avrupa Alevi Birlikleri Konf. Bşk.,
Hüseyin Satı - İşçi, Hüseyin Sungur - Yazar, Hüseyin Aykol -
Gazeteci, Hüseyin Yıldız - Emekli Öğretmen, Hüseyin
Habip Taşkın, Hüsnü Öndül - Avukat, İ. Kuban Altıner -
Akademisyen, İbrahim Akkurt - Akademisyen, İbrahim Sediyani -
Gazeteci/Yazar, İbrahim Sümer - İşçi, İbrahim Yıldırım - Emekli,
İhsan Eliaçık - İlahiyatçı/Yazar, İlhami Işık -
Gazeteci/Yazar, İlhan Nebioğlu - Bankacı, İlkay Alptekin Demir - Emekli
Tıp Doktoru/Çevirmen, İlke Çandırbay - Avukat, İlkut Uluğtuğ,
İlter Sayın - Emekli Öğretmen, İlyas Şahin - Öğretmen, İnci
Hekimoğlu, İnci Tuğsavul - Gazeteci/Yazar, İpek Karenfil - İşçi,
İrfan Eroğlu - Akademisyen, İsa Altug - Tekstilci, İsa Ülker, İshak
Bıdık - Ses Sanatçısı, İshak Kocabıyık - Tüm Emekli Sen. Gen.
Sekreteri, İsmail Acar - Mühendis, İsmail Çınar - Emekli Sendikacı,
İsmail Çolak - Kamu Emeklisi, İsmail Karadağ - Emekli Öğretmen, İsmail
Özşahin, İsmail Beşikçi, İsmail Cem Özkan, İsmet Apak -
Emekli, İsmet Kurt - Alevi Kültür Der. Gn. Bşk., İştar Gözaydın -
Akademisyen, Jale Parla - Akademisyen, Jale Nejdet Erzen -
Akademisyen/Ressam, Jean-Pierre Dopagne, Jülide Kural -
Sanatçı, Jülide Tunakan - Öğrenci, Kadir Akın - Yazar,
Kamer Konca - Kırtasiyeci, Kasım Yeter - Ressam, Kaysal Yeşiltepe
- Emekli, Kayuş Çalıkman Gavrilof, Kazım Genç - Avukat, Kazım Gündoğan
- Yapımcı/Araştırmacı, Kazım Engin - Araştırmacı Yazar, Kemal
Acar - Arıcılık, Kemal Aytaç - Avukat, Kemal Polat - Mühendis, Kemal
Ulaş - Iğdır İl Dernekleri Plt. Bşk., Kemal Yalçın - Yazar, Kemal
Yazgan - Çiftçi, Kemal Akkurt - Avukat, Kemal Çiçek - Konyaaltı
Alevi Der. YK Üyesi, Kenan Taş - Makine Mühendisi, Kıvanç Ersoy -
Matematikçi, Koray Düzgören, Kuvvet Lordoğlu - Akademisyen,
Latif Şimşek - Matbaacı, Latife Fegan - Emekli Muhasebeci, Levent
Pişkin - Avukat, Levent Üzümcü, Lutfi Taylan Tosun - Çevirmen/Yazar, M.
Ali Balta - DPT Eski Uzmanı, M. Ali Demir - Welg Medya Yöneticisi, M.
Beşir Biçer - Kartal Silvanlılar Der. Bşk., M. Zeynep Taymas - Emekli
İktisatçı , Macit Çopur - Emekli, Mahir Sayın - Sistem Mühendisi,
Mahmut Alınak – Avukat, Mahmut Oğuzhan Gürkan - Öğrenci, Mair Kasuto -
Emekli İş İnsanı, Makbule Altıntaş - Sivil Toplum Uzmanı/Ekonomist,
Maya Arıkanlı Özdemir - İşletme Mühendisi/Sosyolog, Mazlum Çetinkaya -
Şair/Yazar, Mazlum Çimen, Mehmet Akça - Öğretmen, Mehmet Aktürk -
Elektronik Mühendisi, Mehmet Altinel - Müzisyen, Mehmet Betil -
İktisatçı, Mehmet Güç - Gazeteci, Mehmet İnan - İmam/Hatip, Mehmet Kuzu
- Mali Müşavir, Mehmet Şahin - Prodüktör, Mehmet Sanrı - Gazeteci,
Mehmet Tüm - Eski Milletvekili, Mehmet Türkay - Akademisyen, Mehmet
Uğur - Akademisyen, Mehmet Ali Aslan - Eski Milletvekili, Mehmet Ali
Çankaya - Avr. Alevi Birlikleri Konf. Örg. Sor., Mehmet Ali Oturan -
Akademisyen, Mehmet Arif Koçer - Hukukcu, Mehmet Edip Yıldız -
Sosyolog, Mehmet Emin Aslan - Din Alimi/Yazar, Mehmet Emin Karaaslan -
Akademisyen, Mehmet Emin Özgültekin - Öğretmen, Mehmet Emin Yüksel -
Öğretmen, Mehmet Fatih Maçoğlu - Tunceli Bld. Bşk., Mehmet Hanifi
Yangın - Silvan Taşpınar Köyü Der. Bşk., Mehmet Nuray Aydınoğlu -
Akademisyen, Mehmet Şerif Arslan - Akademisyen, Mehmet Tahir Kahramaner
- Malazgirt Bld. Eski Başkanı, Mehtap Serter - Avukat, Melik Aygül -
Yazar, Melis Alphan - Gazeteci, Menice Rümeysa Gülmez - Aktivist, Meral
Camcı - Muhreç Akademisyen/Çevirmen, Meral Tamer -
Gazeteci/Yazar, Meryem Koray - Akademisyen, Mesut Beştaş - Avukat,
Metin Bakkalcı - Hekim, Mihail Vasiliadis - Gazeteci,
Muazzez Uslu Avcı - Şair, Muhammed Yasin, Murat
Bayram - Komiser, Murat Gümrükçüoğlu - Mühendis, Murat Kuseyri, Murat
Özbank - Akademisyen, Murat Özyüksel - Akademisyen, Musa Ağacık -
Gazeteci, Musa Kurt - Eruh Derneği Başkanı, Mustafa Altıoklar -
Yönetmen, Mustafa Elveren - Emekli Öğretmen, Mustafa Peköz -
Yazar/Hukukçu, Mustafa Şener - Akademisyen, Mustafa Filiz - Fizik
Tedavi ve Reh. Uzmanı, Mustafa Kemal Coşkun - Akademisyen, Mustafa O.
Sinemillioğlu - Şehir Plancısı/Akademisyen, Mutlu Şahin -
Yönetmen, Muzaffer Doyum - Yazar, Muzaffer Koçak - Emekli,
Muzaffer Erdoğdu - Yayıncı, Müfit Özdeş - Yazar, Münevver Ünsal -
Emekli, Münir Korkmaz - Öğretmen, Mürşit Pur - PSAKD Seyhan Şb. Bşk.,
Müslüm Doğan - Eski Milletvekili/Eski Kalkınma Bk, Naci Sönmez -
Siyasetçi, Nadir Sayın - Sosyal Hizmet Uzmanı/Şair, Nadire Mater
- Gazeteci/Yazar, Nafiz Özbek - Emekli Sendikacı, Nasri Tonguç -
Emekli, Nazar Büyüm - İletişimci/Yazar, Nazım Doğan -
Emekli, Nazlı Deniz Kuruoğlu - Kuşadası Caferli G. ve D. Der. Bşk,
Nazmiye Çimen, Necat Doğan - Bismil Der. Bşk. Yrd., Necat Haksal -
Mühendis, Necati Şahin - Sanat Yönetmeni, Necati Yılmaz - Eski
Milletvekili, Necati Öztaşkın - Emekli, Necati Yakışırer -
Kars Eski Baro Başkanı, Necdet Saraç - Yazar, Necdet Koçtürk -
Mühendis/Şirket sahibi, Necip Doğu - Emekli İş İnsanı, Necip Uslu,
Necmi Demir - Emekli İktisatçı, Necmiye Alpay - Yazar, Nedret
Kuran - Akademisyen, Nejat Taştan - İnsan Hakları Savunucusu, Nejla
Demirci - Sinema Yönetmeni, Nergiz Savran Ovacık - Emekli mühendis,
Nermin Kızılışık Korkmaz - Mühendis, Nesim Ovadya İzrail -
Araştırmacı Yazar, Nesrin Nas, Nesrin Oral - Öğretmen, Nesrin Sungur
Çakmak - Akademisyen, Nesteren Davutoğlu - İletişimci, Neşe Erdilek,
Nevay Samer - Emekli Şehir Plancısı, Nevin Şakar - Ekonomist, Nevzat
Onaran - Gazeteci/Yazar, Nezahat Gündoğan - Belgesel Yönetmeni, Nezir
Dorak - Öğretmen, Nihal Oturan - Akademisyen, Nihat Bulut -
Hekim, Nil Mutluer - Sosyal Bilimci, Nilay Etiler - Tıp Doktoru,
Nilgün Doğançay - Tıp Doktoru, Nilgün Toker - Akademisyen,
Nilüfer Akgün - STK Emekçisi, Nimet Tanrıkulu - İnsan Hakları
Savunucusu, Nisan Lordoğlu - Arkeolog, Niyazi Zorlu - Yazar, Nizamettin
Aktaş - İşçi Emeklisi, Nizamettin Bakay - Gıda Toptancısı, Nur
Sürer - Sanatçı, Nural Karalp - Mühendis/Şirket sahibi, Nuran Özkırım -
Emekli, Nuray Bilgen - Mühendis, Nurcan Baysal - Yazar,
Nurcihan Hamşioğlu - Yayıncı, Nurçiçek Gündoğdu - Emekli,
Nurettin Öztatar - Gazeteci, Nurettin Sözen - İst. Belediye
Eski Bşk., Nurettin Yolcu - Emekli, Nurgül Kumbaroğlu,
Nurhan Kılıçkaya - Emekli, Nurten Ertuğrul - Mali Müşavir, Nusret
Doğruak - İnsan Hakları ve Barış aktivisti, Oğuz Elbaş - Mühendis, Oğuz
Uslu - Çiftçi, Okan Akhan - Türk Radyoloji Derneği Bşk., Oktay
Konyar, Onur Turgut - Esnaf, Orhan Alkaya - Yazar, Orhan Bazancir -
Emekli, Orhan Demirdağ - Emekli Y. Mühendis, Orhan Doğançay - Mühendis,
Orhan Silier - Tarihçi, Orhan Sarıbal - Eski Milletvekili, Osman
Okkan - Belgesel Yönetmeni, Osman Savur - Mühendis, Osman Saydan -
Emekli Mühendis, Osman Tiftikçi - Yazar, Oya Baydar - Yazar, Öget
Öktem - Akademisyen, Öktem Kalaycıoğlu - Emekli Bankacı, Ömer Madra -
Yayıncı/Emekli Akademisyen, Ömer Ersun - Emekli Büyükelçi,
Ömer Güven, Ömer Açıkgöz - Avukat, Özcan Yüce - Eski
Öğretmen/Yeni Bakkal, Özgür Turak - Avusturya Alevi Fed. Başk, Özkan
Yurdakul - Makine Mühendisi Emekli, Özlem Altıok - Akademisyen,
Özlem Doğan - Öğretmen, Pelin Cengiz - Gazeteci/Yazar,
Perihan Şenses - Avukat, Perihan Yoğurtçu, Pervin Erbil, Pınar Aydınlar
- Sanatçı, Pınar Dursun - Dr. Araştırmacı, Pınar Ömeroğlu,
Ragıp Zarakolu - Yayıncı/Yazar, Rahime Begüm Sezgin - Gazeteci,
Rahşan Anter - Emekli, Rahşan Yazar - Avukat, Rakel Dink -
Aktivist, Ralf Arditti - Emekli İş İnsanı, Ramazan Çınkır - Muhreç
Memur, Ramazan Gezgin – 78’liler Meclisi Ankara Temsilcisi,Ramazan
Yıldırım - Koordinatör, Rana Berk - Araştırmacı, Raşit Özyiğit -
Mühendis/Şirket sahibi, Recep Memişoğlu - Emekli, Remzi Budancir -
Gazeteci, Remziye Adalıoğlu - Emekli Öğretmen, Resul Sever -
Silvan Tokluca ve Çev. Köy. Der. Bşk., Reşit Canbeyli -
Akademisyen, Rezan Tuncay - Akademisyen, Rıza Şimşek - Emekli, Rıza
Türmen - AİHM Eski Hakimi, Rıza Oğur - İmam, Ruhat Gülçin Kırdar
- Yazar, Rümeysa Çamdereli - Feminist Aktivist, Rüveysa Yazgan - Emekli
Öğretmen, Sabahattin Oğraş, Saha İliman - Avukat, Sefa Feza Aslan -
Akademisyen, Said Kırmacı - Sağlık Memuru, Saime Tuğrul -
Akademisyen, Sait Çetinoğlu - Araştırmacı/Yazar, Salih Gergerlioğlu -
Öğrenci, Salih Karakaş - Emekli Öğretmen, Salih Zeki Tombak -
Yazar, Sami Caner - Emekli, Sara Poyraz - Eğitimci, Sarp Kuray,
Saygun Gökarıksel - Akademisyen, Safter Çınar - Sendikacı, Selçuk
Sağlam, Selda Kaya - Şair, Selim Ölçer - Tıp Doktoru, Selman
Gözelyüz - Gazeteci, Selmin Atamer - İletişimci, Sema Alpan
Atamer - Mühendis, Sema Bayraktar - Akademisyen, Sema
Bulutsuz - Akademisyen, Sema Gülez - Sosyolog, Sema Saydı -
İşletmeci, Semih Bilgen - Emekli Akademisyen, Semih Çelenk - Tiyatro
Yönetmeni, Semra Karadağ - Muhreç Öğretmen, Semra Somersan - Emekli
Antropoloji Doç., Sena Kaleli - Eski Milletvekili, Serap Konuk -
Emekli Bale Sanatçısı , Serdar Arat - Görsel Sanatçı,
Serhat Baysan - Emekli, Serhat Eren - Avukat, Serkan Boyar
- Akademisyen, Serkan Karaoğlu - Mühendis/Şirket sahibi, Servet Şengül
- Mühendis, Servet Demir - Sosyal Bilimci, Seval Aydın - Modacı,
Sevil Turgut - İHD Ankara YK, Sevim Savunmaz - Emekli, Sevinç Ergaş -
Ressam, Sevtap Akdağ - Eğitimci, Seydi Fırat - Yazar, Seyfettin
Gürsel - Akademisyen, Seyfi Temel, Sezgin Kartal - Gazeteci, Sırrı Er -
Spiker/Eğitimci/Yazar, Sırrı Sakık - Siyasetçi, Sıtkı Baytak -
Akademisyen, Sibel Bülay - Emekli, Sibel Çetingöz - Eğitimci,
Sibel Taşındı - İK Uzmanı, Sidar Zana Bilir - Gazeteci,
Simon Manoyan, Sinan Eskicioğlu - İlahiyatçı Yazar, Siren İdemen -
Gazeteci, Suat Özalp - Anketör, Suavi - Müzisyen/Aktivist, Sultan
Koç - Emekli Öğretmen, Sumru A. Özsoy - Akademisyen, Susen Sel -
Eczacı, Süheyla İnal, Süleyman Ateş - Sendikacı, Süleyman
Eryılmaz, Süleyman Özkaplan - Mühendis, Süleyman Talay -
Serbest Meslek, Sümeyye Avcı - İhraç Öğretmen, Ş. Fırat Çete - Sinema
Sanat Yönetmeni, Şaban İba, Şadiye Sabah - Emekli Bankacı, Şahika
Yüksel - Prof. Dr. Ruh Sağlığı Uzmanı, Şahin Tekgündüz - Emekli
Gazeteci, Şebnem Korur Fincancı - Tıp Doktoru, Şebnem Oğuz
- Akademisyen, Şehbal Şenyurt Arınlı - Yönetmen/Yazar, Şehriban Teyhani
- Yazar, Şemsa Özar - Emekli Akademisyen, Şengün Kılıç - Gazeteci,
Şenol Gürel - Şair, Şenol Morgül - Müzisyen, Şeref Kuşçu -
Serbest, Şerife Ergün - Emekli Öğretmen, Şeyhmus Erol, Şükriye
Ercan, Şükriye Mutlu - Emekli Öğretmen, Şükrü Aslan -
Araştırmacı/Yazar, Şükrü Hamarat - İnşaat Mühendisi, Şükrü
Ünlütürk - Mühendis/Sanayici, Taciser Belge - Çevirmen, Tahsin
Yeşildere - Akademisyen, Tamer Akkaş - Y. Makine Müh/Yönetici, Tarık
Günersel - Yazar, Tarık Kayakan - Çevirmen/Eğitmen, Tarık Ziya
Ekinci, Tilbe Saran - Oyuncu, Timur Ertekin - Diş Hekimi, Tolga
Bektaş - Maçka Dayanışma Derneği Bşk., Tolga Tören - Akademisyen, Torun
Ahmet Türkmen - Siyaset Bilimci/Yazar, Tuğrul Eryılmaz -
Gazeteci/Yazar, Tuna Altınel - Akademisyen, Tuncay Gökçe - Esnaf,
Tuncay Gökçe - KAYYDER Eş Başkanı, Tuncay Kurt - Öğretmen, Tuncay
Çalık - Emekli Öğretmen, Tuncer Bakırhan - Siyasetçi, Tunç Çelebi - Tıp
Doktoru, Turgut Karabekir - Y. Mimar/Yazar, Turgut Öker - Avr. Alevi
Konf. Onursal Bşk., Tülay Karacaörenli, Tülin Ural - Öğretim,
Türkan Aslan Ağaç - Avukat, Türkcan Baykal - Hekim, Ufuk Güneş -
Emekli, Ufuk Uras - Eski milletvekili, Uğur Aker - Emekli Ekonomi
Prof., Uğur Ayken - Makina Y. Mühendisi, Umur Serter - Emekli İş
İnsanı, Uygar Suvari - K. Çekmece Bld. Özel Güv., Ülkü Schneider Gürkan
- Emekli Sendikacı, Ümit Kıvanç - Yazar/Belgeselci, Ümit Özdemir -
Kütüphaneci, Ümit Biçer - Akademisyen/Tıp Doktoru, Ün İskender -
Mühendis/Şirket sahibi, Ünal Onbaşlı - İnşaat Y. Mühendisi, Ünsal
Dinçer - Yeşil Sol Parti Söke İlçe Eşsözcüsü, Üstün Reinhart - Emekli
Akademisyen, Üzeyir Uludağ - Mühendis/Şirket sahibi, Vahap Salman -
Sağlık Çalışanı, Vakkas Kılınç - Mersin Mezitli Bld. Başk. Yard., Vecdi
Sayar - Sanat Yönetmeni/Yazar, Vedat Erincin - Oyuncu, Vedat Tekden -
PSAKD Ayvalık Şube Bşk., Vega Sankur - Kimya Mühendisi, Veli Coşar -
Emekli Öğretmen, Veli Deniz - Akademisyen, Veli Saçılık - Sosyolog,
Veysel Nargül - Akademisyen, Veysi Dündar - Gazeteci/Yazar, Veysi
Sarısözen - Gazeteci, Vezan Karabulut - Mühendis, Viki Çiprut -
Emekli Gazeteci, Yakar Çal - Şair, Yakup Benli - Makine
Mühendisi/Yönetici, Yalçın Ergündoğan - Gazeteci/Yazar, Yaman Öğüt -
Çevirmen, Yaprak Zihnioğlu, Yasemin Ceylan - Akademisyen, Yasemin
Çongar, Yaşar Kaynak - Reklamcı, Yener Turan - Emekli, Yeşim Zühre
Karayel - Emekli, Yıldırım Şahin - Endüstri Mühendisi, Yılmaz Demiral -
Tiyatrocu, Yusuf Alataş - Avukat, Yusuf Can - Öğretmen, Yusuf Kızılocak
- Emekli işçi, Yusuf Köse - İş İnsanı, Yusuf Nazım - Yazar, Yusuf
Ziya Can, Yücel Göktürk - Gazeteci, Yüksel Akkaya - Akademisyen, Yüksel
Uygun - Fotoğraf Sanatçısı, Zahit Mutlu - Emekli Bürokrat, Zehra
Kabasakal Arat - Akademisyen, Zehra Şenoğuz - Emekli, Zerrin Kurtoğlu -
Akademisyen, Zeynep Gambetti - Akademisyen, Zeynep Nilgün
Salmaner - Emekli, Zivin Kılıç - Şair, Ziya Bayram, Ziynet
Özçelik - Avukat, Zübeyir Düzenli - İş İnsanı, Zülfü Livaneli -
Müzisyen/Yazar.
573 people filed a complaint about torture in Turkey in
11 months
Today is December 10 Human Rights Day, which marks the 72nd year since
the adoption of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) by the
United Nations (UN) General Assembly in 1948.
On this occasion, the Human Rights Foundation of Turkey (TİHV) and
Human Rights Association (İHD) have released a joint statement.
"As we did in the past, we will continue to make violations visible by
documenting and reporting them, and thereby to prevent and fight
impunity and to foster respect for human rights," the statement has
stressed.
The rights organizations have underlined that in the 72nd year of the
adoption of the UDHR, we are faced with a global crisis with its
political, social, economic and ethical dimensions, which have been
aggravated by the novel coronavirus (COVID-19) pandemic.
"While the outbreak makes the weaknesses and deficiencies of the
international system blatantly obvious, it also shows where this
concerning state of affairs might evolve," the organizations have noted.
"Despite all these negative developments, peoples from all parts of the
world raise their objections with their demands for freedom, justice,
equality and human rights. As for the responses of states and
governments to these objections, they systematize and spread violence
of every stripe and imposes them on societies as the only reality of
life."
December 10 Human Rights Day
Human Rights Day is observed every year on 10 December — the day the
United Nations General Assembly adopted, in 1948, the Universal
Declaration of Human Rights (UDHR). The UDHR is a milestone document
that proclaims the inalienable rights which everyone is entitled to as
a human being - regardless of race, colour, religion, sex, language,
political or other opinion, national or social origin, property, birth
or other status. Available in more than 500 languages, it is the most
translated document in the world.
The Universal Declaration of Human Rights entered into force in Turkey
after it was published in the Official Gazette on May 27, 1949.
'Outbreak addressed as a "security problem"'
On this occasion, the TİHV and İHD have also issued a report
documenting the state of freedoms and human rights in Turkey.
"Addressing the outbreak as a problem of security rather than an action
for prevention and protection, the government has cancelled human
rights first, as it always does in such cases," the statement has
protested and briefly added:
"As a result of this, all basic rights and freedoms, especially right
to obtain information, right to healthcare, right to work, freedom of
expression and freedom of assembly and organization have been
systematically violated.
'Torture has taken on a new dimension'
"Though it is absolutely prohibited and considered a crime against
humanity under the universal law, which Turkey is also a part of,
torture has been the major human rights problem in the country in 2020
as well.
"In addition to the official detention centers, the practices of
torture and maltreatment committed by law enforcement during their
intervention in peaceful assemblies and demonstrations, in the street
and open places or places such as houses and workplaces, i.e. in
unofficial places and cases of detention, have taken on a new dimension
and intensity.
"As a result of the political power holders' governing style based on
pressure and control, the entire country has turned into place of
torture in a sense.
"In the first 11 months of 2020, 573 people applied to the TİHV,
complaining that they had been subjected to torture and other forms of
ill treatment.
'Armed conflict environment persists'
"Today, prisons are packed as the law is used by the political power
holders in Turkey as a tool of pressure and intimidation. Prisons are
the places where grave and serious violations ranging from the
violation of right to life to torture and access to healthcare take
place. Prisons are one of the riskiest places in terms of COVID-19
outbreak.
"Kurdish question is still one of the most basic obstacles standing in
the way of Turkey's democratization.
"As a result of the government's failure to take sincere and
comprehensive steps for a peaceful, democratic and just resolution of
the problem and the developments in the Middle East, the armed conflict
environment that started right after the General Elections on June 7,
2017 still persists today, causing grave and serious violations of
human rights, especially right to life.
'It affects women, children, refugees most'
"Turkey is going through one of the most severe economic crises of the
last 40 years. This picture has been aggravated by COVID-19 outbreak.
"The violations of rights faced by people who do not have the
opportunity to stay home and have to/ are forced to work in
construction sites, factories and markets in conditions lacking
adequate measures vary considerably.
"Occupational homicides rank first among these violations. Unemployment
and poverty affect women, children and refugees most.
'No reforms in such a picture'
"The political power holders' talks of reform in human rights and
judiciary should not be seen as a realizable pledge in such a picture.
"If there is really a will for reform, it is a must to draft a new and
democratic constitution based on separation of powers and to usher in a
real resolution process for the conflict that will ensure facing the
past.
"Anything that will be done without taking these steps will not be a
reform, but a window dressing in response to the international
reactions."
(BIA, 10 December 2020)
Près
de 200 arrestations liées au mouvement guléniste
Les autorités turques ont arrêté mardi 198 personnes, dont de nombreux
militaires, soupçonnées d'être proches du prédicateur Fethullah Gülen,
bête noire d'Ankara qui l'accuse d'avoir fomenté une tentative de
putsch en juillet 2016, selon l'agence de presse étatique Anadolu.
Les arrestations ont eu lieu sur ordre du bureau du procureur d'Izmir,
dans l'ouest de la Turquie, qui a émis des mandats d'arrêt contre 304
personnes soupçonnées d'avoir eu des échanges téléphoniques avec des
dirigeants du mouvement guléniste.
Parmi les suspects recherchés, 295 sont des militaires en service, a
rapporté Anadolu.
Dans une autre opération visant également des partisans présumés de M.
Gülen, 21 personnes, dont de nombreux médecins militaires, ont été
arrêtés mardi à Ankara.
Le prédicateur Fethullah Gülen, installé aux États-Unis depuis une
vingtaine d'années, dirige un réseau accusé par Ankara d'avoir infiltré
les institutions turques dans le but de renverser le président Recep
Tayyip Erdogan.
M. Erdogan accuse M. Gülen, un ancien allié, d'être le cerveau de la
tentative de coup d'État de juillet 2016, ce que l'intéressé dément.
Depuis le putsch avorté, les autorités traquent les partisans de M.
Gülen et ont déclenché des purges d'une ampleur sans précédent dans
l'histoire moderne de la Turquie. Plusieurs dizaines de milliers de
personnes ont été arrêtées et plus de 140.000 limogées ou suspendues de
leurs fonctions.
Fin novembre, 337 personnes, dont des officiers et pilotes, ont été
condamnés à la prison à vie à l'issue du principal procès sur la
tentative de coup d'Etat. (AFP, 8 déc
2020)
Students facing three-years in jail for
celebrating Pride
must be acquitted
Leading human rights organisations have come together to demand the
acquittal of 19 human rights defenders for their participation in a
Pride parade in 2019, ahead of the verdict expected on Thursday.
The 18 students and an academic at the Middle East Technical University
(METU) are facing prison sentences of up to three years simply for
organising and participating in a Pride march on campus that the
University management had unlawfully banned.
“In the summer of 2019, students and others peacefully participating in
a celebration of love and solidarity were met with police pepper spray,
plastic bullets and tear gas. Nineteen of them have also been dragged
through the courts on baseless criminal charges and face absurd jail
sentences,” said Nils Muižnieks, Amnesty International’s Europe
Director.
“The ban of the Pride march lacked legal grounds and these brave
students who defied it had their rights to freedom of expression and
peaceful assembly violated. They must be acquitted.”
The 19 individuals are charged with “participating in an unlawful
assembly” and “failing to disperse despite being warned”. This is
despite the fact that in February 2019, the Ankara Administrative
Appeals Court had lifted the blanket ban prohibiting all LGBTI+
activities in Ankara introduced under the state of emergency, which
University management relied on as the legal basis to stop the annual
campus based Pride March from going ahead.
Despite appeals on them to ensure the March went ahead, the university
authorities called the police to disperse the students on the day. As
they peacefully sat on the lawn, students were met with pepper spray,
plastic bullets and tear gas. Several were injured, many arbitrarily
detained.
A year later in June 2020, another administrative court in Ankara
overturned the university’s unlawful ban, confirming that it had no
legal basis.
“Against the backdrop of increasing homophobia in Turkey, METU students
and staff have marched through their campus each year to celebrate
Pride and demand equality and dignity for LGBTI+ people as they have a
right to do so,” said Nils Muižnieks.
“The only just outcome in the unfair prosecution of 19 human rights
defenders for their participation in a peaceful Pride march is their
wholesale acquittal.” (amnesty.org, 7 December 2020)
New
resolution on Osman Kavala makes clear his
detention must end
immediately
Following the strongly worded interim resolution by the Council of
Europe Committee of Ministers demanding Turkey release Osman Kavala
from prison immediately, Amnesty International’s Europe Director Nils
Muižnieks said:
“Almost a year to the day after the European Court for Human Rights
issued a binding judgment finding that the detention of Osman Kavala is
politically motivated, today’s resolution demanding his immediate
release sends a clear message to the Turkish authorities that his
continued imprisonment cannot and will not be tolerated.
“Today’s resolution and last year’s Court judgment cannot be brushed
aside by the Turkish authorities. Their continuing refusal to comply
with the ruling and Osman Kavala’s continued imprisonment – which is
now in its fourth year – are unlawful. Each day Osman Kavala spends
behind bars is yet another confirmation of the ulterior motive behind
his imprisonment.
“The Turkish authorities have no choice but to release Osman Kavala and
drop the criminal proceedings against him. Anything less would be a
further breach of his human rights and yet another shameful stain on
Turkey’s already broken justice system.”
Background
The Council of Europe’s Committee of Ministers, tasked with monitoring
the implementation of European Court of Human Rights judgments,
considered the Kavala v Turkey judgment for the first time in September
2020 as Osman Kavala completed 34 months held in pre-trial detention.
Last year on Human Rights Day (10 December), the Strasbourg Court found
that Osman Kavala’s extended detention had an “ulterior purpose, namely
to reduce him to silence as an NGO activist and human rights defender,
to dissuade other persons from engaging in such activities and to
paralyse civil society in the country” and violated the European
Convention on Human Rights, a ruling which was confirmed in May 2020.
In its interim resolution, the Committee of Ministers additionally
found that Turkey failed to challenge the strong presumption that
Kavala’s current detention is a continuation of the violations found by
the Court and regretted the lack of action by the Constitutional Court
on Kavala’s case.
Prominent civil society figure Osman Kavala was first detained in
October 2017, remanded in pre-trial detention on 1 November 2017 and
has been behind bars ever since. In February 2020, he was acquitted of
all charges in the Gezi trial. In October, a new prosecution accusing
him of attempting to overthrow the constitutional order and espionage
was accepted by an Istanbul Court. The first hearing in the trial is
set for 18 December. (AI, 4 December 2020)
Trial of Osman Kavala: European foundations reject
Turkey's allegations
Several European foundations and cultural institutions have rejected
the allegations that they are engaged in intelligence activities in
Turkey.
In the bill of indictment linking Osman Kavala, a businessperson and a
rights defender who has been in prison more than three years, to the
2016 coup attempt, the Heinrich-Böll Foundation, the Robert Bosch
Foundation, the Goethe Institute, the European Cultural Foundation and
the Mercator Foundation are indirectly accused of espionage.
"As organizations that are committed to building relations with Turkey
and its people, irrespective of their religion, ethnicity or political
opinions, we categorically reject this accusation," said a joint
statement by the groups.
Kavala was first sent to prison for organizing the 2013 Gezi Park
protests to overthrow the government, of which he was acquitted in
February. However, before leaving the prison, a court remanded him in
custody for taking part in the coup attempt.
Previously, Kavala was kept in prison despite an ECtHR decision stating
that he should be released immediately.
The organizations sent their joint statement to the Council of Europe,
the European Parliament and Germany's Bundestag ahead of a meeting of
the Committee of Foreign Ministers of the Council of Europe under
Germany's presidency today (December 1).
Here is the full text of the statement:
Osman Kavala has been held in pre-trial detention for over three years.
Despite his acquittal by an Istanbul court in February of this year, a
new charge was brought against him on 8 October 2020. We see no
evidence for the allegations that have now been raised, which link him
to the failed coup d'état attempt of 15 July 2016. According to the
judgment of the European Court of Human Rights (ECHR), his continued
imprisonment is a violation of the European Convention on Human Rights,
of which Turkey is a signatory. The new bill of indictment accuses
European and American organizations that operate in Turkey of engaging
in intelligence activities. As organizations that are committed to
building relations with Turkey and its people, irrespective of their
religion, ethnicity or political opinions, we categorically reject this
accusation.
We work in different ways to promote exchange with Turkish society with
a view to strengthening European-Turkish relations. In times of growing
social polarization in and around Europe, cross-border cooperation in
the areas of civil society and culture have a vital role to play. We
have been promoting such collaboration for many years through a variety
of initiatives that we intend to further consolidate in the future –
all over Europe, including in Turkey. We firmly believe that there are
few viable alternatives to encounters, discussions and a joint search
for the right path into the future. We can only achieve this by working
together with Turkish partners on the basis of trust. With partners who
are committed to dialogue and shared values such as the rule of law,
open-mindedness and tolerance.
Osman Kavala is one of these partners. As the founder of the
organization Anadolu Kültür and the supporter of a whole host of art
and cultural projects, he has devoted himself for many years to better
understanding between Turkey and Europe, as well as between people in
Turkey.
The ongoing imprisonment of Kavala and the accusations that have now
been levied against him constitute an attempt to criminalize this
dialogue.
This course of action will harm not least Turkey itself in its efforts
to paint a more positive picture of Turkey abroad, to attract foreign
visitors and to present itself as an attractive economic partner for
Europe. Without bridge builders between Europe and Turkey there can be
no joint future.
We believe it is important for the Council of Europe to provide impetus
for the reshaping of European-Turkish relations. A common understanding
of constitutional and democratic principles must form the basis for
lasting cooperative structures with Turkey. Among other things, this
requires the Turkish government to meet the obligations to which it has
committed itself. Without freedom there can be no basis for dialogue
and exchange – it is the duty of the Council of Europe to translate
this certainty into political action. (BIA, 1 December 2020)
Pression
sur les médias / Pressure on the Media
Le journaliste d'opposition en exil Can
Dündar condamné à 27 ans de prison
Un tribunal turc a condamné mercredi à plus de 27 ans de prison le
journaliste d'opposition exilé Can Dündar, devenu la bête noire du
président Recep Tayyip Erdogan après avoir révélé des livraisons
d'armes d'Ankara à des groupes islamistes en Syrie.
M. Dündar, qui vit en exil en Allemagne, a été reconnu coupable d'aide
à un groupe terroriste et d'espionnage pour avoir publié en 2015 une
enquête, images à l'appui, sur ces livraisons d'armes par les services
secrets turcs, dans le quotidien d'opposition Cumhuriyet dont il était
le rédacteur en chef.
En mai 2016, M. Dündar, 59 ans, avait été condamné à cinq ans et dix
mois de prison pour divulgation de secrets d'Etat dans cette affaire
qui avait provoqué la colère de M. Erdogan, dont le pays soutient des
groupes de l'opposition syrienne contre le régime du président Bachar
al-Assad.
Mais ce verdict avait été annulé en 2018 par une haute cour qui a
ordonné un nouveau procès contre M. Dündar pour des accusations
d'espionnage comportant une peine plus lourde.
Dans les attendus du verdict rendu mercredi, le tribunal a précisé que
M. Dündar a été condamné à 18 ans et six mois de prison pour
"divulgation d'informations confidentielles et espionnage" en lien avec
la publication de l'enquête sur les livraisons d'armes, et à huit ans
et neuf mois de prison pour "aide à une organisation terroriste", en
l'occurrence le réseau du prédicateur Fethullah Gülen.
M. Gülen, qui vit en exil aux Etats-Unis, est accusé par Ankara d'avoir
orchestré le putsch avorté contre le président Erdogan en juillet 2016.
- "Vendetta" -
M. Dündar s'était réfugié en Allemagne en 2016 après sa première
condamnation.
"C'est une décision politique et une vendetta qui n'a rien à voir avec
le droit", a réagi M. Dündar au téléphone auprès de l'AFP. "Le but est
aussi de décourager les journalistes de publier ce genre
d'informations".
"Erdogan a promis de me faire payer le prix et il essaye maintenant de
le faire. On assiste à la déchéance de la justice en Turquie", a-t-il
ajouté.
M. Erdogan avait confirmé lors d'une visite à Berlin en septembre 2018
vouloir l'extradition du journaliste, l'accusant d'être un "agent"
ayant divulgué des "secrets d'Etat".
En février 2016, M. Erdogan s'en était violemment pris à la Cour
constitutionnelle, plus haute autorité judiciaire du pays, après
qu'elle a ordonné la libération de M. Dündar pendant la durée de son
procès, après plus de 90 jours en détention provisoire.
"C'est une décision insensée et ignoble qui confirme que le régime du
président Erdogan ne sait pas s'arrêter dans sa fuite en avant
autoritaire", a réagi au verdict Pauline Adès-Mével, rédactrice en chef
de RSF qui considère que le cas de M. Dundar "illustre au plus haut
point l'acharnement judiciaire que subissent les journalistes en
Turquie".
"Que peut-on penser d'un système judiciaire qui condamne des
journalistes à d'aussi lourdes peines simplement pour avoir fait leur
travail?", s'est interrogé de son côté le secrétaire général de la
Fédération européenne des journalistes Ricardo Gutiérrez.
Mais les directeur des communications à la présidence turque Fahrettin
Altun, a affirmé que "présenter Can Dündar comme un journaliste -- et
sa condamnation comme une atteinte à la libre expression --
est une insulte aux vrais journalistes".
Pendant son procès, M. Dündar avait échappé à une attaque à l'arme à
feu devant le tribunal d'Istanbul. L'auteur des tirs avait été condamné
à dix mois de prison.
Outre la peine de prison annoncée mercredi, la justice turque avait
ordonné en octobre la saisie des biens de M. Dündar et le gel de ses
comptes bancaires.
Cumhuriyet, le plus ancien quotidien en Turquie, n'appartient pas à un
grand groupe d'affaires, mais à une fondation indépendante, ce qui en
fait une cible facile pour les autorités.
Ainsi, un tribunal turc a maintenu en novembre 2019 les condamnations,
prononcées en 2018, de 12 ex-collaborateurs et dirigeants du journal à
des peines allant jusqu'à plus de huit ans de prison pour avoir "aidé
des groupes terroristes", à savoir le réseau du prédicateur Gülen et le
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).
Outre l'épreuve judiciaire, Cumhuriyet a traversé une difficile
transition en 2018 avec un changement brusque de l'équipe dirigeante
qui s'est accompagné du départ des journalistes jugés.
La Turquie est régulièrement épinglée par les ONG pour ses atteintes à
la liberté de la presse.
Ce pays occupe la 154e place sur 180 au classement de Reporters sans
frontières (RSF). (AFP, 23 déc
2020)
Rapport
du CPJ sur les journalistes emprisonnés
Un nombre record de journalistes ont été emprisonnés dans le monde en
raison de leur travail en 2020, les pays autoritaires ayant arrêté de
nombreux journalistes qui couvraient le COVID-19 ou l’instabilité
politique. En pleine pandémie, les gouvernements ont retardé les
procès, restreint les visites et ignoré le risque sanitaire accru en
prison ; au moins deux journalistes sont morts après avoir contracté la
maladie en détention.
Dans son enquête mondiale annuelle, le Comité pour la protection des
journalistes a recensé au moins 274 journalistes emprisonnés à cause de
leur travail au 1er décembre 2020, dépassant ainsi le record de 272
atteint en 2016. La Chine, qui a arrêté plusieurs journalistes suite à
leur couverture de la pandémie, a été le pire geôlier au monde pour la
deuxième année consécutive. Elle est suivie par la Turquie, qui
continue de juger des journalistes en liberté conditionnelle et d’en
arrêter de nouveaux ; par l’Égypte, qui n’a pas ménagé ses efforts pour
maintenir en détention des journalistes n’ayant été reconnus coupables
d’aucun crime ; et par l’Arabie saoudite. Parmi les pays dans lesquels
le nombre de journalistes emprisonnés a augmenté de manière
significative se trouvent la Biélorussie, où des manifestations de
masse ont eu lieu suite à la réélection contestée du président de
longue date, et l’Éthiopie, où les troubles politiques ont dégénéré en
conflit armé.
En Turquie, où chaque journaliste emprisonné fait face à des
accusations d’hostilité envers l’État, le nombre de détenus a diminué
depuis la forte augmentation de 2016, année marquée par un coup d’État
manqué en juillet. Alors que les fermetures d’organes de presse, les
prises de contrôle par des hommes d’affaires pro-gouvernementaux et
l’hostilité judiciaire ont effectivement éradiqué les médias grand
public, la Turquie a autorisé un plus grand nombre de journalistes à
rester libres dans l’attendre de leur procès. Le CPJ a recensé 37
journalistes emprisonnés cette année, soit moins de la moitié par
rapport à 2016, mais les autorités continuent d’arrêter des
journalistes – et leurs avocats. En raison du COVID-19, les procédures
judiciaires ont été suspendues pendant trois mois en 2020, ce qui a
prolongé la durée de détention des journalistes en garde à vue et
l’anxiété des ceux laissés libres dans l’attente de leur procès.
Dans les semaines précédant le recensement du CPJ, les autorités
turques ont arrêté au moins trois journalistes travaillant pour
l’agence de presse pro-kurde Mezopotamya, dont Cemil Uğur, suite à leur
couverture critique, et notamment une histoire dans laquelle ils
alléguaient que du personnel militaire avait détenu et torturé deux
villageois et les avait jetés d’un hélicoptère ; l’un d’entre eux est
décédé par la suite. (Les autorités turques ont déclaré que les civils
avaient été blessés en résistant à l’arrestation). (CPJ, 15 décembre
2020)
At
least 40 journalists prosecuted in November
Formed by a group of voluntary journalists and documenting lawsuits
against journalists in Turkey for two years, the Press in Arrest
initiative released its November 2020 Press Freedom Report in early
December.
According to the Press in Arrest report titled "'Publicity of Trial
Principle' Violated Under the Pretext of the Pandemic", at least 40
journalists, including 8 women, were prosecuted in at least 30
press-related trials in 8 provinces.
The report has further shown that in the trials concerning these 40
journalists, the prosecutor's offices demanded 2 of aggravated life
sentences and a total of 201 years 4 months to 497 years 2 months in
prison.
Press in Arrest has observed that, in the press trials held in Turkey
since the onset of the novel coronavirus (COVID-19) pandemic in the
country in mid-March 2020, hearings have been held closed to observers
and the public in an arbitrary manner, under the pretext of "protection
measures".
"In the period from March to the beginning of December, in 38 hearings
concerning 73 journalists, observers were not admitted to the courtroom
or a restriction was imposed on the number of observers attending the
hearings, under the pretext of the coronavirus outbreak," it has noted.
22 faced terror charges, 9 accused of insult
Some highlights from the report are as follows:
In November in Turkey, in at least 30 press-related trials in 8
provinces, at least 40 journalists were prosecuted. 8 of them were
women.
In the trials concerning these 40 journalists, the prosecutor's offices
demanded 2 counts of aggravated life sentence, and a total of 201 years
4 months to 497 years 2 months in prison.
A total of 1 million 470 thousand TRY was requested in non-pecuniary
damages in claims for damages against 3 journalists and 3 media outlets.
Women journalists appearing before a judge faced 33 years 7 months 15
days to 86 years 1 month 15 days in prison.
Two female journalists presented their defense in lawsuits where they
faced 1 million 270 thousand TRY in claims for damages.
Journalist Hazal Ocak faced a total of 1 million 220 thousand TRY in
non-pecuniary damages in three separate claims for damages in November.
28 journalists were prosecuted in high criminal courts, and 11 in
criminal courts of first instance:
At least 28 journalists appeared before a judge in
high criminal courts.
Trials against at least 11 journalists continued at
criminal courts of first instance.
Under the scope of lawsuits for damages, 3
journalists and 3 media outlets appeared in civil courts of first
instance.
22 journalists were charged as per "Anti-Terror Law":
At least 22 journalists had to present their defense
statements against charges of terrorism offenses
At least 8 journalists were charged with "membership
of an armed terror organization,"
7 journalists with "spreading propaganda for a
terror organization," and
3 journalists with "targeting a state official who
took part in anti-terrorism efforts."
On the other hand, at least 6 journalists were
charged with "knowingly and willing aiding a terror organization
without being part of its hierarchical structure".
9 journalists were accused of "insult":
A total of 9 journalists appeared before a judge for
alleged "insult".
At least 6 journalists continued to stand trial for
"insulting the President." In this scope, two journalists were
sentenced to prison.
3 journalists charged with "insulting a state
official" were acquitted.
"Publicly inciting the population to hatred and
enmity", "slander", "disclosing confidential information concerning the
state's security and domestic and foreign interests" etc.
At least 3 journalists continued to face the charge
of "publicly inciting the population to hatred and enmity" in ongoing
trials.
One journalist was charged with "intentionally
damaging the reputation or assets of a bank, or disseminating
groundless news stories,"
One journalist with "slander,"
One journalist with "showing resistance to prevent
an official from performing their duty,"
One journalist with "attempting to overthrow the
Turkish government through force and violence" and "attempting to
overthrow the constitutional order through force and violence," and
Four journalists with "disclosing confidential
information concerning the state's security and domestic and foreign
interests"...
10 journalists in total started being retried:
10 journalists appealed the verdicts of the district
courts in courts of appeal and Court of Cassation, which overturned the
previous verdicts.
District courts complied with the decisions of the
courts of appeal and Court of Cassation, and as a result 10 journalists
started being retried in district courts.
In November, the first hearings were held in these
retrials against a total of 10 journalists.
4 journalists were handed down prison sentences:
In November, at least 4 journalists were sentenced to a total of 19
years, 11 months in prison.
Journalist Ali Ergin Demirhan was sentenced to 1
year, 2 months and 17 days in prison for "publicly insulting the
President."
Journalist Onur Emre Yağan was sentenced to 1 year,
2 months, 17 days in prison for "publicly insulting the President in a
continuous manner" even though President Tayyip Erdoğan had withdrawn
his complaint. The court deferred the announcement of the verdict.
Journalist Mehmet Baransu was sentenced to a total
of 17 years, 1 months in prison on the charges of "obtaining
confidential information", "disclosing this information in a continuous
manner" and "obtaining and publishing information and documents
regarding the activities of the National Intelligence Organization
(MİT)"
Journalist Yılmaz Özdil was sentenced to 5 months in
prison under a trial for "violating the Military Penal Code". The court
deferred the announcement of the verdict.
4 journalists were acquitted:
On trial for allegedly "insulting a state official
on duty" due to a news story from the time when he served as
editor-in-chief, journalist Uğur Güç was acquitted.
The court acquitted journalists Uğur Koç and Mustafa
Kömüş from the charge of "publicly insulting a state official on duty"
in the lawsuit filed upon a criminal complaint by the ex-Minister of
Treasury and Finance, Berat Albayrak.
In a trial where he was prosecuted alongside Mehmet
Baransu since 2014, journalist Murat Şevki Çoban was acquitted of the
charges.
Trials of 33 journalists were adjourned:
The trials of 33 journalists appearing before a
judge in November were adjourned. The trial of two journalists in İzmir
was postponed since an earthquake damaged the courthouse. (BIA, 10 December 2020)
13 journalists died of coronavirus in
Turkey
The Federation of Journalists of Turkey (TGF) has announced that 13
journalists have lost their lives due to the novel coronavirus
(COVID-19) since the onset of the outbreak in the country in mid-March.
In a statement released by the TGF, it has been stressed that
journalists are among the occupational groups most affected by the
pandemic.
Underlining the serious increase in the number of cases and deaths, the
TGF has noted that journalists contract the virus while they are doing
their job and they are one of the risk groups in that regard.
"As they are face to face with people working for the public good,
bureaucracy and politicians, our colleagues must be vaccinated against
COVID-19 right after healthcare workers so that they can work in an
healthy environment," TGF Chair Yılmaz Karaca has indicated.
According to the statement, the following journalists have lost their
lives since the outbreak of the pandemic in Turkey:
*Hikmet Bakan / Van - Atv - Show Tv
*Yılmaz Tarancı / Diyarbakır - dokuz/haber.com
*Akif Çelik / Malatya – Anatolia Sports Media and Columnists Association
*Cengiz Koncuk / Antep - Amatörce Newspaper
*Ahmet Kekeç / İstanbul - Star
*Hacı Bozkurt / Adıyaman - Demirören News Agency (DHA)
*Ferhat Koç / Ankara - Milli Gazete
*Hasan Can / TRT - Konya Ereğli
*Süleyman Usta / Rize - Sarıyer Newspaper, Çay TV
*İbrahim Toru / Urfa - Kanal Urfa TV
*İlhan Erk / Adana / Sports Columnist
*Tevfik Fazlı Doğan / Hatay - Zafer Newspaper
*Yakup Kocabaş / Gazipaşa-Antalya - Gündem Newspaper
(BIA, 10 December 2020)
Une
journaliste condamnée en lien avec le
"terrorisme"
Une journaliste turque a été condamnée lundi à plus de six ans de
prison pour "appartenance à une organisation terroriste" par un
tribunal de Diyarbakir, dans le sud-est à majorité kurde de la Turquie.
Aysegül Dogan a été condamnée à six ans et trois mois de prison pour
appartenance au "Congrès de la société démocratique" (DTK), une
organisation que les autorités turques accusent d'être liée au Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK), un groupe classé "terroriste" par
Ankara et ses alliés occidentaux.
Mme Dogan était journaliste et coordinatrice des programmes à IMC TV,
chaîne d'opposition et
pro-kurde, avant sa fermeture par les autorités en 2016.
"Le procureur insiste pour voir autrement mes activités
journalistiques", avait-elle déclaré dans une interview accordée avant
le verdict au magazine en ligne Duvar, affirmant que le tribunal avait
refusé de tenir compte de "preuves" la disculpant .
Mme Dogan prévoit de faire appel du verdict, a déclaré un de ses
avocats à l'AFP.
Des défenseurs des droits humains et des journalistes ont protesté
contre la condamnation de Mme Dogan sur les réseaux sociaux en
partageant le hashtag en anglais #JournalismIsNotACrime (le journalisme
n'est pas un crime).
Des dizaines de journaux et de chaînes de télévision ont été fermés par
les autorités dans la vague de répression qui a suivi une tentative de
coup d'Etat contre le président turc Recep Tayyip Erdogan en 2016.
Les milieux prokurdes font aussi l'objet d'une répression implacable
depuis plusieurs années en Turquie.
Le pays est classé à la 154e position sur 180 à l'index de la liberté
de la presse publié par RSF. (AFP, 7 déc
2020)
Deux journalistes d'une chaîne de
télévision russe arrêtés en Turquie
Deux journalistes de la chaîne de télévision
russe NTV ont été arrêtés par la police en Turquie, a annoncé vendredi
cette chaîne fédérale dans un communiqué.
Jeudi matin, "le journaliste Alexeï Petrouchko et son caméraman Ivan
Malychkine ont informé la rédaction qu'ils avaient été arrêtés par des
policiers (...) à Istanbul", indique le communiqué.
Jeudi soir, ils étaient toujours détenus, selon un message envoyé à ses
collègues par M. Petrouchko et cité par la chaîne.
Travaillant tous les deux pour l'émission Tsentralnoïe televidenie qui
se positionne comme un show d'information hebdomadaire, les
journalistes ne répondent plus depuis au téléphone ni aux messages,
selon le communiqué.
Selon une source au sein du ministère turc des Affaires étrangères, les
journalistes ont été arrêtés au moment où ils "filmaient une fabrique
de drones sans aucune accréditation".
"Ils sont arrivés à Istanbul pour un tournage, mais n'ont reçu ni
autorisation, ni accréditation" pour filmer, a affirmé à l'AFP cette
source.
Le bureau du gouverneur d'Istanbul a annoncé vendredi soir que la durée
de la garde à vue des journalistes avait été prolongée de trois jours
et que l'enquête à leur sujet était en cours.
Pour sa part, l'ambassade de Russie en Turquie a déclaré être en
contact avec les autorités turques pour éclaircir la situation.
"Nous comptons sur une coopération opérationnelle" du côté turc, a
souligné l'ambassade dans un communiqué publié sur sa page Facebook.
Cette arrestation intervient alors que la Turquie, soutien sans faille
de l'Azerbaïdjan, a annoncé cette semaine un accord avec la Russie sur
l'établissement d'un centre conjoint d'observation qui aura pour
mission de surveiller le cessez-le-feu au Nagorny Karabakh, enclave
séparatiste azerbaïdjanaise peuplée majoritairement d'Arméniens.
Des combats meurtriers entre forces azerbaïdjanaises et séparatistes
arméniens, déclenchés fin septembre dans cette région, ont fait
plusieurs milliers de morts en six semaines.
Un accord de cessez-le-feu, signé le 9 novembre entre Bakou et Erevan
sous patronage russe, a mis fin aux hostilités. (AFP, 4 déc
2020)
Journalists
mark 26th anniversary of Özgür Ülke newspaper
bombing
Journalists and politicians have marked the 26th anniversary of the
bombing of the offices of Özgür Ülke, a Kurdish issue-focused newspaper
published in the 1990s.
A transport worker, Ersin Yıldız, was killed and 23 others were wounded
in the bombings on December 3, 1994.
Journalists from Yeni Yaşam newspaper and members of the Peoples'
Democratic Party (HDP) and the Human Rights Association (İHD) attended
the event in İstanbul's Kadırga quarter, where one of the bombed
offices is located.
Zekine Türkeri, who was one of the reporters of Özgür Ülke at the time,
said in the event that "Tansu Çiller [then PM) gave the order for this
assault. The purpose was to inflict a bit more damage. But they didn't
achieve their goal. This newspaper and its successors are continuing on
their path."
Speaking after Türkeri, Yeni Yaşam's newspaper's editor-in-chief,
Ferhat Çelik, said, "We were living in the days when dozens of our
journalist and distributor friends, most notably Ape Musa, were
murdered on the street."
"In the morning on December 3, we were in pain, angry but not
surprised. We knew why they attacked us, why those bombs exploded and
we all said only one thing: This newspaper will be published tomorrow.
And it did," said Çelik.
İHD Co-Chair Eren Keskin recalled that she was an attorney for the
newspaper at the time and said the order for the attack was given by
the army's "Special Warfare Department" while HDP İstanbul Provincial
Chair Elif Bulut said the parliament should investigate the bombings.
After the speeches, carnations were laid in front of the newspaper's
office.
What happened?
On December 3, 1994, Özgür Ülke newspaper's technical headquarters in
İstanbul's Kadırga quarter, central office in Cağaloğlu quarter and
office in the capital city of Ankara were bombed.
Transport worker Ersin Yıldız (32) and 23 workers were wounded.
Following the incident, the newspaper could only run with the help of
other newspapers, which let Özgür Ülke staff work in their offices.
On December 4, 1993, the newspaper was published with four pages with
the headline "This Fire Could Burn You As Well".
About 15 days after the bombing, Özgür Ülke newspaper published an
article about a top-secret document signed by then-PM Tansu Çiller.
The document cited the following with direct reference to the newspaper:
"The activities of media outlets supporting the separatist and
annihilating [organizations] has recently turned into an overt threat
against the future of the [Turkish] state and its moral values. In
order to wipe out this threat against the unity of country and nation,
precautions need to be taken..." (BIA, 3 December 2020)
IPI report: Turkey's social media law
threaten free
public debate
The International Press Institute has released a report about freedom
of the press in Turkey after a mission to Turkey between October 6-9.
The report examines the new social media law that came into effect at
the start of October, regulatory bodies' punishment of independent
outlets and the situation of judicial independence in the country.
While the number of imprisoned journalists decreased from 2017 when it
was the highest, Turkey is still one of the world's largest jailers of
journalists, says the report titled, "Turkey's Journalists on the Rope".
"Regulators, with their extensive powers to grant and remove licenses
and impose financial penalties, are able to force independent media to
either comply or risk closure," the report stresses. "This strategy is
expected to ensure media self-censorship so the intervention of the
courts becomes less necessary and less frequent."
"The Social Media Law, if fully enacted, would also require social
media companies to comply with government censorship demands or
eventually face being blocked within the country.
"Meanwhile, in its communique of October 2, the Council of the European
Union offered improved economic ties with Turkey without reference to
Turkey's human rights record."
"The government is determined to use all available tools to suppress
criticism whether on broadcasters, in print and online", IPI Head of
Europe Advocacy Oliver Money-Kyrle said.
"The international community and the European Union, in particular,
must be prepared to make improved relations contingent on an end to the
media crackdown and improved human rights in general," he added.
The report has been prepared by IPI with the support of the following
organizations: Association of European Journalists (AEJ), Committee to
Protect Journalists (CPJ), European Centre for Press and Media Freedom
(ECPMF), European Federation of Journalists (EFJ), Osservatorio Balcani
Caucaso Transeuropa (OBCT), PEN International, Reporters without
Borders (RSF), South East Europe Media Organisation. (BIA, 2 December 2020)
Kurdish
Question / Question kurde
Le Conseil
de l'Europe redemande la libération du leader
pro-kurde Demirtas
Le Conseil de l'Europe a redemandé mercredi la libération du leader
pro-kurde Selahattin Demirtas, emprisonné depuis 2016 en Turquie, au
lendemain d'une condamnation d'Ankara par la Cour européenne des droits
de l'homme (CEDH) dans ce dossier qui a provoqué l'ire du président
Recep Tayyip Erdogan.
"Selahattin Demirtas doit être libéré de prison -- et libre d'exercer
de nouveau sans plus de délais ses droits politiques dans une société
démocratique", ont indiqué dans un communiqué les rapporteurs de
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) pour le suivi
de la Turquie.
Ancien député et ex-coprésident du Parti démocratique des peuples (HDP,
pro-Kurde), Selahattin Demirtas est emprisonné depuis novembre 2016,
quelques mois après le putsch manqué de juillet contre M. Erdogan. Il
est accusé par Ankara de "terrorisme" et risque jusqu'à 142 années de
prison dans son principal procès.
Il est détenu depuis plus de quatre ans dans les geôles turques, ont
rappelé deux des rapporteurs, Thomas Hammarberg et John Howell. "Notre
assemblée a souligné à plusieurs reprises que la place des députés est
au Parlement, pas en prison", ont-ils ajouté.
"La libération immédiate de Selahattin Demirtas constituerait (...) un
signal fort et significatif de la volonté de la Turquie de respecter
les jugements" de la CEDH ainsi que son "engagement fort" à respecter
"les valeurs fondamentales liées à son appartenance au Conseil de
l'Europe", vigie des droits de l'homme sur le continent et qui avait
déjà demandé, en vain, la libération de M. Demirtas, ont estimé les
rapporteurs.
Émanation du Conseil de l'Europe, la CEDH a rendu mardi un arrêt
cinglant dans le dossier Demirtas, relevant plusieurs violations de la
Convention européenne des droits de l'homme.
L'arrêt, qui exigeait déjà la libération "immédiate" de l'opposant, a
suscité mercredi les foudres du président turc, M. Erdogan condamnant
une "décision entièrement politique" et "hypocrite".
Par ailleurs, quelques heures après la publication de cet arrêt, le
site internet de la CEDH a été victime d'une cyberattaque massive qui
l'a rendu inaccessible entre mardi à partir de 17H40 jusqu'en milieu de
matinée mercredi, a indiqué le service de presse de la Cour.
La CEDH dit ignorer pour l'instant l'origine de cette attaque qui n'a a
priori pas occasionné de perte de données, relevant simplement qu'elle
s'était produite après la publication de l'arrêt condamnant Ankara. (AFP, 23 déc
2020)
L'ex-députée
kurde Leyla Güven condamnée à 22 ans de prison
pour "terrorisme"
L'ex-députée kurde Leyla Güven a été condamnée lundi à 22 ans et trois
mois de prison par un tribunal de Diyarbakir, dans le sud est de la
Turquie, pour des accusations en lien avec le "terrorisme".
Déchue de son mandat en juin par un vote parlementaire, Mme Güven, 56
ans, a été reconnue coupable d'"appartenance à un groupe terroriste",
en l'occurrence le parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) et de
"propagande" en faveur de cette organisation, selon les attendus du
verdict.
Un mandat d'arrêt a été lancé contre l'ex-députée qui comparaissait
libre et qui envisage de faire appel du verdict, a affirmé son avocat à
l'AFP. Mme Güven n'a pas assisté à l'audience de lundi et il n'était
pas possible de savoir dans l'immédiat où elle se trouvait.
Mme Güven est la co-présidente du "Congrès de la société démocratique"
(DTK), une organisation que les autorités turques accusent d'être liée
au PKK, classé "terroriste" par Ankara et ses alliés occidentaux.
"Ma mère a été condamnée pour ses activités en lien avec le DTK, qui
était autrefois considéré comme un interlocuteur par les autorités", a
réagi Sabiha Temizkan, la fille de l'ex-députée sur Twitter.
"Cette condamnation est l'exemple concret de l'application d'un droit
de l'ennemi envers les Kurdes", a estimé de son côté Ebru Günay,
députée et porte-parole du HDP, le Parti démocratique des peuples dont
Mme Güven était députée avant d'être déchue de son mandat.
Cette déchéance a été votée en juin par le Parlement, à la suite de la
confirmation d'une précédente condamnation à la prison de Mme Güven
pour "appartenance à une organisation terroriste armée".
Mme Güven, alors élue du HDP, avait été arrêtée en janvier 2018 après
avoir critiqué l'offensive militaire turque alors en cours dans
l'enclave en majorité kurde d'Afrine dans le nord de la Syrie.
Elle avait lancé un mouvement de grève de la faim en prison en novembre
2018 pour protester contre les conditions de détention du leader kurde
Abdullah Öcalan, l'un des fondateurs du PKK.
Ce mouvement, suivi par des milliers de détenus, avait pris fin en mai
2019.
Mme Güven avait bénéficié d'une remise en liberté conditionnelle en
janvier 2019 jusqu'à l'expiration de sa peine.
Les milieux prokurdes, en particulier le HDP, font l'objet d'une
répression implacable depuis plusieurs années en Turquie.
Le pouvoir turc accuse le HDP d'être une "vitrine politique" du PKK,
une accusation rejetée par le parti prokurde qui se dit victime de
répression en raison de sa farouche opposition au président turc.
Selahattin Demirtas, ancien dirigeant emblématique du HDP est détenu
depuis novembre 2016 pour des accusations en lien avec le "terrorisme".
Plusieurs maires pro-kurdes dans le sud-est de la Turquie ont été
déchus de leur mandat et arrêtés ces derniers mois pour leurs liens
présumés avec le PKK. (AFP, 21 déc
2020)
Deux
députés belges demandent dss
visas pour 50 soldats kurdes
De retour
d’un
voyage en Syrie, les députés Georges Dallemagne (CDH) et Koen Metsu
(N-VA) ont déposé, jeudi, à la Chambre, une proposition de résolution
pour demander de débloquer 50 visas humanitaires temporaires afin de
soigner les soldats kurdes blessés au combat contre Daech.
"La
première
étape pour lutter contre le terrorisme, c’est d’être là pour ses
victimes, a justifié Koen Metsu. Les Kurdes ont donné le meilleur
d’eux-mêmes pour protéger l’Europe contre […] Daech."
Contacté
par
Belga, le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Sammy Mahdi
(CD&V), a indiqué ne pas être contre l’idée, mais, selon lui, la
délivrance de tels documents "doit être bien sous-pesée et sans
négligence, comme ça a pu être le cas dans le passé". (La Libre
Belgique, 19 déc 2020)
Sixteen-year-old killed by soldiers' gunfire in
Hakkari
Özcan Erbaş, 16, was killed on Monday (November 30) after border troops
opened fire upon him and his friends in the Kurdish-majority province
of Hakkari.
The child lost his life after being hit in the back about 400 meters
away from the Turkey-Iraq border, according to the eyewitnesses quoted
by Mesopotamia Agency.
The Governor's Office of Hakkari stated after the incident that Erbaş
and the people with him were involved in illegal border trading and
soldiers warned them before opening fire.
The child was killed as a result of soldiers "firing shots in the air"
and judicial and administrative investigations were opened into the
incident, said the governor's office.
The uncle of Erbaş said that the soldiers didn't act while he was lying
in blood and he had to carry his nephew on his back.
Several children have been killed by soldiers' gunfire near border
areas in the Kurdish-majority provinces over the past years.
The Human Rights Association (İHD) released a statement on the incident
today (December 4), saying that "We won't get used to the killing of
children."
"People continue to lose their lives or get injured every year in the
border areas of the Kurdish region because of arbitrary fire by
security officers.
"Because no effective objective and transparent investigations are
carried out against the perpetrators, violations cannot be prevented
and become permanent.
"As human rights defenders, we won't get used to this situation! We
declare once again that we will fight for the quest of justice of every
child whose right to life and development are taken away form them." (BIA, 4 December 2020)
Lawyers
commemorate Tahir Elçi five years after
his killing
Lawyers in İstanbul, İzmir and Mersin have commemorated Diyarbakır Bar
Chair Tahir Elçi, who was shot dead during a press meeting in the
southeastern province on November 28, 2015.
His murder has not yet been solved as a trial began only last month.
Lawyers from the Proggressive Lawyers' Association (ÇHD) and
Association of Lawyers for Freedom (ÇHD) gathered, showing banners that
read, "We won't forget you," "No to police state" and "Tahir Elçi is
immortal."
Reading out a statement in front of the Bakırköy Courthouse in
İstanbul, ÖHD İstanbul Chair Arzu Eylem Karaoğlu said, "We promise that
will never forget Tahir Elçi, who was the lawyer of the Kurdish people
and all of the oppressed peoples in Turkey."
Also speaking at the event, ÇHD İstanbul Chair Gökmen Yeşil said that
the process that led to the killing of Elçi was planned in advance.
"We have lost Tahir as a result of a political assassination. This was
neither the first nor the last political homicide," he said.
However, he added, "new Tahir Elçis are born" in a country where there
is "poverty, exploitation and oppression."
"I commemorate our colleague, my brother. Tahir Elçi lives and will
live in our struggle. These lands will give birth to many more Tahir
Elçis. Those who murdered him should be afraid of us," said Gökmen.
What happened?
Tahir Elçi attended a live TV program on CNN Türk hosted by Ahmet Hakan
on October 15, 2015. Elçi said, "The PKK [Kurdistan Workers Party] is
not a terrorist organization." While the channel was fined 700 thousand
lira over these words, Tahir Elçi was detained in his office in
Diyarbakır Bar Association and taken to İstanbul on November 20.
While the prosecutor's office referred Elçi to court with a request for
his arrest, the Bakırköy 2nd Heavy Penal Court released him on
probation. A bill of indictment was brought against Elçi on charge of
"propagandizing for a terrorist organization." Elçi faced up to 7.5
years in prison.
Diyarbakır Bar Association Chair Tahir Elçi was murdered while making a
statement for the press in front of the Four-Legged Minaret in Sur,
Diyarbakır on November 28, 2015. (BIA, 30 November 2020)
Minorités
/ Minorities
La résolution du Parlement fédéral
belge sur Haut-Karabakh
Le
Parlement
fédéral belge a adopté à la quasi-unanimité une résolution demandant à
la Turquie "qu’elle n’interfère plus militairement dans le conflit" du
Haut-Karabakh et prônant le retour diplomatique de la France et des
États-Unis dans la recherche d’une solution "pacifique et durable".
La
résolution a
été adoptée dans la nuit de jeudi à vendredi à la Chambre. Elle émanait
de la majorité, signée par Michel De Maegd (MR), André Flahaut (PS) et
consorts. Plusieurs amendements plus corsés ont été acceptés en
provenance de l’opposition, de Georges Dallemagne (CDH) en particulier.
Seul le PTB
s’est abstenu lors du vote.
Une
proposition
du député Peter de Roover (N-VA) de nouer des liens diplomatiques avec
la République autoproclamée du Haut- Karabakh a été rejetée. Le 25
novembre, le Sénat français avait été la première institution
internationale à appeler à la reconnaissance de l’enclave arménienne,
mais ce pas n’a pasété franchi en Belgique, sans doute par crainte d’un
effet ricochet sur la politique intérieure.
La
résolution
demande à la Turquie de ne plus interférer militairement dans le
conflit, de ne plus "jouer un rôle déstabilisateur dans la région du
Caucase" et de "mettre son influence au service d’une résolution
pacifique et durable au conflit".
Elle
contredit
la version officielle de Bakou, pour qui la guerre a repris le 27
septembre dernier à cause d’une incursion arménienne. La Chambre
"condamne la reprise des hostilités par l’Azerbaïdjan" et l’"agression
militaire menée avec l’appui des autorités turques et de mercenaires
étrangers".
Son but
principal est de réclamer, comme l’Union européenne ou le Parlement
wallon (qui a adopté une résolution similaire le 16 décembre), le
retour en scène du Groupe de Minsk (Russie, France, États-Unis).
"Le Groupe
de
Minsk est la seule instance internationale autorisée à faciliter les
négociations pour une solution globale et durable de la question du
Haut-Karabakh", a insisté la ministre Sophie Wilmès, après avoir reçu
successivement vendredi à Bruxelles les ministres arménien et azéri des
Affaires étrangères. (La Libre Belgique, Ch. Ly., 19 déc 2020)
Les
socialistes "bouleversés et inquiets" de
leur déplacement au Haut-Karabakh
Les cadres du Parti socialiste partis en délégation au Haut-Karabakh
ont confié mercredi être revenus "bouleversés" par les récits de
soldats arméniens défaits par l'Azerbaïdjan en automne, et "inquiets"
d'un cessez-le-feu instable et de l'absence de la France dans la
résolution du conflit.
La délégation, composée du premier secrétaire et député Olivier Faure,
du secrétaire national aux Affaires internationales Jean-Marc Germain,
de la députée Isabelle Santiago et du militant franco-arménien Jules
Boyadjian, a rencontré quatre jours durant à Erevan puis au
Haut-Karabakh, début décembre, les autorités des deux territoires,
ainsi que des soldats arméniens et des familles victimes du conflit.
Le Nagorny Karabakh (Haut Karabakh), théâtre d'une guerre meurtrière de
1988 à 1994, a été secoué cet automne par six semaines de combats qui
ont fait plus de 4.000 morts et permis à l'Azerbaïdjan de reconquérir
une partie de la région.
"Nous sommes revenus bouleversés et très inquiets sur le risque de
destruction totale du Haut-Karabakh et d'instabilité internationale", a
résumé Jean-Marc Germain lors d'une visioconférence de presse mercredi.
Il a rapporté "une attaque coordonnée, massive de l'Azerbaïdjan avec
une implication massive et concrète de la Turquie et une présence
massive de djihadistes venus du théâtre syrien".
M. Germain a dénoncé une "violation du droit international": "bombes à
fragmentation, au phospore, décapitations, exactions, massacres de
soldats", avec une "dimension génocidaire puisqu'il y a eu élimination
des 18 ans à 20 ans d'origine arménienne" et "destruction du patrimoine
historique arménien".
"Dans ces guerres-là il n'y a plus de zone de contact, le front c'est
tout le pays, avec des bombardements par drones dont les munitions
lourdes ont fait des trous de trois mètres de profondeur", a-t-il
relaté.
Selon Olivier Faure, au-delà de la dimension humanitaire "ce n'est pas
un conflit anecdotique": "Ce qu'il s'y joue c'est notre vision du
monde, est-ce que désormais les empires nouveaux ou anciens imposeront
leur loi au mépris de toute concertation et dialogue avec la communauté
internationale?"
Les socialistes ont déploré "l'inaction de la France" dans la
résolution du conflit et constaté que "la paix est russe", ayant dû
traverser plusieurs points de passage de l'armée russe et ses "colonnes
de soldats, pas là pour témoigner mais pour s'installer".
L'Assemblée nationale et le Sénat se sont tous deux prononcés pour la
reconnaissance du Haut-Karabakh, dans des résolutions non
contraignantes. Le gouvernement s'y est opposé, réaffirmant
l'importance du groupe de Minsk pour résoudre le conflit. (AFP, 16 déc
2020)
Erdogan
veut que "la lutte" de l'Azerbaïdjan contre
l'Arménie continue
Le président turc Recep Tayyip Erdogan, en visite à Bakou pour célébrer
la victoire de l'Azerbaïdjan au Nagorny Karabakh, a affirmé jeudi que
"la lutte" de son allié contre l'Arménie devait se poursuivre.
Son accueil en grande pompe dans ce pays turcophone du Caucase
intervient un mois après la déroute militaire arménienne, qui a dû
céder d'importants territoires au Nagorny Karabakh.
La république autoproclamée, peuplée quasi exclusivement d'Arméniens,
continue d'exister, affaiblie et amoindrie, sans que son statut soit
réglé par l'accord de cessez-le-feu négocié sous égide de Moscou tandis
que des soldats russes de maintien de la paix y ont été déployés.
S'adressant notamment à des soldats azerbaïdjanais, M. Erdogan a assuré
que "le fait que l'Azerbaïdjan a sauvé ses terres de l'occupation ne
signifie pas que la lutte est terminée".
"La lutte dans les sphères politiques et militaires va se poursuivre
désormais sur de nombreux autres fronts", a-t-il clamé.
Appelant les dirigeants arméniens à "revenir à la raison" après leur
défaite dans cette guerre de six semaines menée à l'automne, il a
assuré que la reconquête de nombreux territoires par l'Azerbaïdjan
"sera le début d'une nouvelle ère".
L'Arménie "doit voir qu'elle n'obtiendra aucun résultat avec les
encouragements des impérialistes occidentaux", a encore tonné M.
Erdogan, dont le pays est membre de l'Otan, accusant par ailleurs
Erevan de s'être livré à des crimes de guerre au Nagorny Karabakh et de
n'y avoir apporté que "massacre, destruction et larmes".
- Précieux soutien turc -
L'ONG Amnesty International a elle appelé jeudi à des enquêtes
indépendantes pour identifier les auteurs de crimes de guerre commis
par les forces azerbaïdjanaises ou arméniennes afin de les "traduire en
justice".
Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a de son côté salué le soutien
sans faille d'Ankara, qui a "donné confiance au peuple azerbaïdjanais".
"L'Arménie n'a pas été en mesure de nous concurrencer tant sur le plan
économique que sur le plan militaire", s'est-il félicité.
Les deux hommes ont assisté à un défilé militaire à Bakou, impliquant
3.000 soldats et un large contingent turc et où ont aussi été présentés
les drones turcs qui ont joué un rôle stratégique dans le conflit et du
matériel arménien capturé.
Les soldats et M. Aliev s'affichaient sans masques, bien que la guerre
a aggravé l'épidémie de coronavirus en Azerbaïdjan.
S'exprimant après un entretien en tête-à-tête avec son homologue
azerbaïdjanais, M. Erdogan a ensuite assuré "ne pas avoir de haine
envers le peuple arménien" mais seulement un "problème" avec ses
dirigeants.
Critiquant le groupe de Minsk (Etats-Unis, France, Russie), chargé sans
succès de trouver une issue pacifique au conflit depuis les années
1990, il a évoqué un projet de "plateforme pour restaurer la paix
régionale" qui comprendrait six pays: "Russie, Turquie, Azerbaïdjan,
Iran, Géorgie et si elle l'accepte, l'Arménie".
- "Une nation, deux Etats" -
La récente victoire de son allié azerbaïdjanais, armé par la Turquie,
permet à Ankara de renforcer son poids géopolitique dans le Caucase,
pré carré russe.
"L'Azerbaïdjan n'aurait pas été capable d'obtenir un succès militaire
au Karabakh sans le soutien politique ouvert de la Turquie", a souligné
auprès de l'AFP l'analyste Elhan Shahinoglu du centre de réflexion
Atlas, basé à Bakou.
Cette défaite humiliante pour une Arménie qui avait vaincu les forces
de Bakou lors d'une première guerre conclue en 1994 a provoqué la
fureur à Erevan, où l'opposition manifeste quasi-quotidiennement pour
la démission du Premier ministre Nikol Pachinian.
Durant la guerre, l'Arménie a accusé la Turquie d'être impliquée
directement dans les combats, ce qu'Ankara dément. Plusieurs pays dont
la France ont également dénoncé l'envoi aux côtés des forces
azerbaïdjanaises de combattants pro-turcs venus de Syrie.
Symbolisée par le slogan "Une nation, deux Etats", l'alliance entre la
Turquie et l'Azerbaïdjan a été forgée lorsque Bakou a obtenu son
indépendance de l'URSS en 1991 et s'est renforcée sous la présidence de
M. Erdogan.
Cette coopération politique, économique et militaire a notamment permis
à la Turquie d'aider l'Azerbaïdjan - turcophone - à entraîner et
équiper son armée, facilitant aussi les exportations d'hydrocarbures de
Bakou vers l'Europe, en contournant la Russie. (AFP, 10 déc
2020)

Erdogan célébrera avec Aliyev leur conquête de
Haut-Karabakh
Le président turc Recep Tayyip Erdogan, dont le pays a été le principal
soutien de Bakou dans son occupation du Haut-Karabakh, se rendra en
Azerbaïdjan le 9 décembre 2020 afin de célébrer avec le président
Aliyev leur "victoire" grâce au soutien tacite des puissances du monde.
En effet, il s'agit pour Erdogan d'une nouvelle étape dans sa conquête
turco-islamiste qui vise le contrôle des sources d'énergie de la Région
du Caucase et l'ouverture à un accès direct aux pays turcophones d'Asie
centrale.
Dans mon article publié le 19 novembre 2020 par le journal digital Arti
Gerçek, j'avais critiqué non seulement la complicité génocidaire du duo
Erdogan-Aliyev, mais également le soutien honteux de tous les partis
politiques turcs, à l'exception du Parti démocratique du Peuple (HDP),
aux opérations militaires d'Erdogan dans plusieurs pays de la région:
Irak, Syrie, Lybie, Chypre, Méditerranée orientale et dernièrement dans
la Région du Caucase au détriment du peuple arménien, déjà victime des
génocides commis par les Ottomans en 1895 et 1915.
Ci-après, je partage cet article en français.
*
Ils soutiennent le 3e génocide arménien!
Dogan Özgüden
Artı Gerçek, 19 novembre 2020
J’ai exercé mon métier de journaliste dans tous les domaines
imaginables, mais je n’ai pas eu le bonheur d’être correspondant
parlementaire… Pourtant, à l’époque où je dirigeais le journal Akşam et
la revue Ant, je faisais le trajet d’Istanbul à Ankara et suivais les
débats de l’assemblée pour voir de près la lutte antifasciste et
anti-impérialiste que les quinze députés du Parti des travailleurs de
Turquie donnaient depuis l’estrade et mieux la transmettre aux lecteurs.
La dernière fois que j’ai assisté aux séances de l’assemblée, c’est
lorsque j’étais allé, début 1968, réconforter Çetin Altan et Yunus
Koçak, députés du Parti ouvrier de Turquie (TIP) lorsqu’ils s’étaient
fait tabasser par des députés enragés du Parti de la justice… Malgré
l’agression, les députés du TİP étaient encore plus déterminés, tandis
que les députés agresseurs étaient en proie à la panique des coupables…
Trois ans plus tard, cette assemblée, y compris les députés du CHP,
allait approuver le coup d’État du 12 mars des généraux fascistes,
rester silencieuse face à l’emprisonnement et à la torture de milliers
de révolutionnaires et de démocrates, et pire encore, voter la
condamnation à mort de Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan et Hüseyin İnan.
Cinquante-deux ans plus tard, grâce aux technologies avancées de notre
époque, j’ai pu suivre attentivement, pour la première fois, le soir du
17 novembre, une séance de l’assemblée sur la chaîne parlementaire TBMM
TV… L’ordre du jour était, après la victoire dans le Haut-Karabagh,
l’approbation de la feuille de route prévoyant l’envoi par Erdoğan de
soldats turcs en Azerbaïdjan.
Cinq jours plus tôt, le 12 novembre, j’avais déjà suivi attentivement
un débat à la Chambre des représentants de Belgique, là encore sur
l’attaque dans le Haut-Karabagh, sur la chaîne parlementaire belge.
Prenant la parole lors de cette séance, le député cdH Georges
Dallemagne avait raconté ce qu’il avait vu et vécu en personne dans le
Haut-Karabagh où il s’était rendu, bravant tous les dangers, lors de
l’attaque azéro-turque, et avait accusé les dirigeants belges et de
l’Union européenne de ne pas s’être opposés à l’agression et d’avoir
abandonné le peuple arménien à lui-même sur ses propres terres où il
était victime du troisième génocide de son histoire.
« J’ai vu de mes propres yeux l’agression azerbaïdjanaise,
s’exclamait-il. Oui, J’ai vu comment drones et bombes à sous-munitions
étaient utilisés contre le peuple arménien. J’ai vu le bain de sang.
J’ai vu comment les Arméniens avaient été abandonnés de tous face à la
barbarie, livrés à leur solitude. Personne ne s’est opposé à
l’acheminement de terroristes depuis la Syrie, l’Arménie a été obligée
de se rendre. La véritable victoire, derrière celle de l’Azerbaïdjan,
c’est celle de la Turquie. La Turquie, qui se comporte de manière
totalement illégale et hors de tout contrôle, qui utilise des
terroristes ralliés en Syrie, a piétiné au vu et au su de tous les
accords de l’OTAN et des Nations Unies. »
Il s’en prenait ensuite au gouvernement belge : « Pendant que tout cela
avait lieu, le groupe de Minsk est resté à l’écart, et l’Europe n’a pas
bougé le petit doigt. Vous dites maintenant que vous accueillez ce
cessez-le-feu avec satisfaction. Mais avez-vous bien réfléchi à ce qui
va se produire après ce bain de sang ? Accepterez-vous que le plus fort
fasse accepter tout ce qu’il veut au seul pays réellement démocratique
de la région ? Accepterez-vous qu’un pays membre de l’OTAN utilise
contre un pays voisin des terroristes et des armes interdites ?
Acceptera-t-on qu’avec l’ouverture d’un couloir entre l’Azerbaïdjan et
le Nakhitchevan disparaisse la frontière commune de l’Arménie avec
l’Iran, son seul pays ami ? Pire encore, acceptera-t-on qu’Erdoğan, en
ouvrant un couloir permettant de relier directement la Turquie aux
Républiques turciques de la région, réalise son rêve d’un grand Empire
ottoman et prenne le contrôle du futur gazoduc venant de la Mer
Caspienne ? »
Pour en venir à la séance du 17 novembre du Parlement turc, il était de
toute façon clair depuis le début que la feuille de route prévoyant
l’envoi de soldats en Azerbaïdjan serait acceptée… Voici ce que disait,
un mois et demi plus tôt, le communiqué commun émis, oubliant de
mentionner que les forces terrestres et aériennes turques avaient,
lorsque nécessaire, établi des bases sur territoire azerbaïdjanais pour
frapper de concert avec l’armée azerbaïdjanaise l’Arménie et le
Haut-Karabagh par l’AKP, le MHP, le CHP et l’İYİP :
« En tant que partis politiques représentés à la Grande Assemblée
nationale de Turquie, nous invitons la communauté internationale à
soutenir l’Azerbaïdjan qui, aujourd’hui encore, souffre de l’occupation
et des attaques irresponsables de l’Arménie. Ainsi, en tant que partis
de notre Assemblée de ghazis, tout en souhaitant la miséricorde d’Allah
à nos frères azéris tombés en martyres, un prompt rétablissement aux
combattants blessés et toutes nos condoléances à l’Azerbaïdjan, nous
mettons fortement en exergue une fois de plus la volonté de solidarité
de notre nation. »
Voici ce que je m’étais demandé dans mon article, publié dans Artı
Gerçek le 1er octobre, intitulé « Les quatre cavaliers de l’apocalypse
à l’Assemblée des ghazis », rappelant que le mot ghazi qualifie la
personne qui accomplit le gazâ, c’est-à-dire qui attaque, qui se bat,
qui pille, qui fait la guerre au nom de la religion, et qu’il est donné
en tant que titre honorifique aux commandants, voire aux gouvernants,
qui remportent une guerre :
« N’est-ce pas cette même assemblée, fondée le 23 avril 1920, qui, en
assumant dès sa création l’héritage idéologique du comité Union et
Progrès, a autorisé, dès ses premières années, que soient noyés dans la
Mer Noire les leaders du Parti communiste de Turquie, qui en 1925, pour
réprimer les organisations de gauche et la résistance kurde, a permis
de créer les tribunaux de l’indépendance en votant la fameuse loi pour
le rétablissement de l’ordre public, qui a fait cracher le sang aux
forces d’opposition, à l’époque du parti unique comme à celle du
multipartisme, en déclarant des états d’urgence successifs, et qui a
envoyé à la potence des dizaines de jeunes révolutionnaires, à
commencer par Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan et Hüseyin İnan, en votant les
sentences de mise à mort données par les tribunaux militaires ? »
Oui, cette assemblée est vraiment une Assemblée de ghazis… Lors des
débats du 17 novembre que j’ai suivis sur la chaîne parlementaire, les
porte-paroles de l’AKP, du CHP, du MHP et de l’İYİP ont mis à profit
toutes leurs ressources d’éloquence pour montrer qu’ils étaient des
ghazis soutenant du fond du cœur la conquête azerbaïdjanaise de Tayyip.
Ce qu’ont dit à ce sujet l’AKP, dont Tayyip est le président, ou le MHP
et l’İYİP qui sont les porte-paroles politiques du courant raciste et
prosélyte, n’a pas d’importance… Leurs dispositions naturelles
exigeaient qu’ils soutiennent la feuille de route prévoyant la
conquête, et c’est ce qu’ils ont fait.
Ce qui fut dit sur l’estrade parlementaire au nom du CHP, principal
parti d’opposition étiqueté « centre gauche » était à peine croyable.
Il faut tirer les leçons de ce que dit au nom du parti le député
d’Istanbul Ahmet Ünal Çeviköz, porte-parole du groupe CHP, juste au
moment où les députés de son parti faisaient une standing ovation à
leur président qui venait de faire son entrée dans la salle d’assemblée
générale :
« Le Parti Démocratique du Peuple a toujours été aux côtés de son ami
et frère l’Azerbaïdjan, dans la joie et dans la peine. Nous voulons
exprimer une fois encore notre satisfaction de voir les terres
azerbaïdjanaises occupées par l’Arménie rejoindre, sauvées, la mère
patrie. Et nous présentons nos félicitations à l’armée azerbaïdjanaise
qui couronne d’une grande victoire son droit à la légitime défense
exercé depuis le 27 septembre… Le devoir qui échoit maintenant à la
Turquie est de ne pas se contenter d’avoir sauvé ces terres sous
occupation mais de lancer une attaque diplomatique forte pour que le
Haut-Karabagh revienne en Afghanistan et que le Nakhitchevan et
l’Azerbaïdjan soient reliés l’un à l’autre. Sur ce point, l’Azerbaïdjan
ne doit pas être laissé en tête à tête avec le groupe de Minsk, sur le
plan diplomatique, la Turquie et l’Azerbaïdjan doivent absolument agir
de concert. Nous y veillerons jusqu’au bout. »
Ceux qui apportent de l’eau au moulin de Tayyip se résument-ils à ces
quatre partis qui ont l’opportunité de s’exprimer sur la feuille de
route parce qu’ils ont des groupes à l’Assemblée ?
Et les autres partis de l’ordre qui n’ont qu’une poignée de députés à
l’Assemblée ou qui courent après le transfert pour en obtenir ?
Dans toutes les déclarations faites au nom du Parti de la grande unité
(BBP), du Parti démocrate (DP), du Parti de la félicité (SP), du Parti
de la démocratie et de l’élan (DEVA), du Parti de l’avenir (GP) ou du
Parti du renouveau (YP), on applaudit avec un grand enthousiasme la
conquête au nom de la turcité des terres arméniennes dans le Caucase,
et l’installation pérenne de l’armée turque sur ces terres comme cela a
été fait dans le passé à Chypre.
Heureusement qu’il y a un parti, le Parti démocratique des peuples
(HDP), pour sauver l’honneur du pouvoir législatif au sein du
Parlement… Tout comme le Parti des travailleurs de Turquie dans les
années 60, le troisième parti du pays, qui de nos jours résiste face à
tous les obstacles et intrigues, a prouvé lors des débats sur la
feuille de route, qu’il était la seule force politique élevant la voix
du bon sens, du pacifisme et de la fraternité des peuples.
Le soir du 17 novembre, Tulay Hatimoğulları Oruç, députée d’Adana,
déclara par ces mots on ne peut plus clairs que le groupe HDP dirait «
non » à la feuille de route :
« De la même manière qu’hier, le HDP n’a pas dit « oui » au fait de
laisser, sous quelque motif que ce soit, des peuples s’entretuer, les
conflits régionaux s’approfondir et des populations voisines
s’affronter, nous ne dirons pas « oui » aujourd’hui, le HDP n’a, depuis
le jour où il a commencé ses activités dans cette assemblée jusqu’à
aujourd’hui, approuvé aucune feuille de route militaire, nous les avons
toutes rejetées et ce que nous avons toujours exprimé, depuis cette
estrade, dans le domaine de la politique extérieure, c’est notre
détermination à ne pas rejeter au second plan la priorité de tenter de
résoudre les problèmes par le dialogue et des moyens pacifiques et
politiques. »
Elle insistait ensuite, depuis l’estrade de l’Assemblée, sur une
réalité que les autres partis s’efforcent d’étouffer :
« Dans cette guerre, il y a une autre question, apparue pendant le
processus libyen et qui a fait beaucoup parler dans le monde. Il y a
des affirmations selon lesquelles la Turquie convoierait des
djihadistes et salafistes de Syrie vers le Haut-Karabagh, tout comme
elle l’a déjà fait vers le Libye et vers diverses zones de Syrie… Les
groupes salafistes recrutés pour la guerre en Syrie sont devenus dans
les mains du pouvoir un groupe illégal de combattants qui s’est
développé à un niveau effrayant. Le gouvernement exporte des
combattants et en est arrivé au point de pouvoir être jugé devant les
tribunaux internationaux en termes de crimes de guerre. »
La porte-parole du HDP renchérit en exposant clairement comment
l’Azerbaïdjan, porté aux nues en vertu du slogan « Deux États, une
nation » faisait le lit des crimes contre l’humanité commis en Turquie :
« Souvenez-vous des années 90 en Turquie… La mafia et l’État étaient
inextricablement mêlés, des groupes paramilitaires tels que le JİTEM
commettaient des crimes en Turquie, assassinant journalistes,
intellectuels, écrivains, défenseurs des droits de l’homme…
L’Azerbaïdjan était un terrain d’activités et d’entraînement pour cette
organisation. Regardez les procès-verbaux de la commission d’enquête
mise sur pied par le Parlement, et vous verrez comment l’État profond,
la mafia et les forces paramilitaires s’organisent ensemble dans ce
pays… »
Après avoir écouté les déclarations de reddition du Parlement
turc qui continuait à la moindre occasion de se qualifier de « ghazi »,
je me réinstallai vers minuit devant l’ordinateur et réécoutai
l’enregistrement vidéo du discours que Georges Dallemagne, qui n’a
jamais démenti son engagement pour les droits de l’homme en Turquie,
avait fait le 12 novembre devant le Parlement de Belgique. J’éprouvai
un profond respect.
Ensuite, je revisionnai la visioconférence organisée le 5 novembre par
l’Institut kurde de Bruxelles autour de l’attaque dans le
Haut-Karabagh. Lors de cette conférence à laquelle j’avais participé,
ainsi que Freddy De Pauw du journal De Standaard, le Dr. Bogos
Muradian, notre camarade de lutte de l’Association des Arméniens
démocrates de Belgique, avait exprimé très clairement que cette
opération était une troisième tentative de génocide contre le peuple
arménien.
Oui, le peuple arménien, avec le premier génocide lancé par le « Sultan
rouge » Abdülhamid, puis le deuxième organisé vingt ans plus tard, en
1915 par le comité Union et Progrès, avait déjà payé un lourd tribut.
Cent vingt-cinq ans après le premier et cent-cinq après le deuxième, il
était maintenant la cible d’un troisième génocide avec l’attaque
azéro-turque.
Le matin de cette nuit passée à visionner encore et encore des vidéos,
je mis mon masque de protection contre le coronavirus et me jetai dans
les rues de Schaerbeek. Mes pas m’emmenèrent jusqu’à la place Colignon
où s’élève l’hôtel de ville. Rien d’étonnant… Le premier congrès
international organisé sur le premier génocide commis contre les
Arméniens par l’État ottoman en 1895 s’était tenu sur l’initiative de
la mairie de Schaerbeek dans une salle de conférence à proximité de
cette place les 17 et 18 juillet 1902. L’un des intervenants les plus
éminent de ce congrès, réuni malgré les intrigues et les pressions de
la diplomatie ottomane pour l’empêcher, avait été l’un des leaders
historiques de la gauche française, le fondateur du journal L’Humanité,
Jean Jaurès…
Ce Jean Jaurès qui avait été le défenseur, non seulement du peuple
arménien mais de tous les peuples opprimés, qui s’était opposé à la
guerre et qui, pour cette raison, peu avant le début de la Première
Guerre mondiale, le 31 juillet 1914, avait été assassiné par balles.
C’est pris par cette émotion que je descendis jusqu’au parc Josaphat et
m’écroulai sur un banc de la place Jacques Brel, où j’écoutai sur
YouTube le célèbre morceau de ce grand musicien né à Schaerbeek qui
raconte la situation de la classe ouvrière et la folie guerrière de
l’époque où Jaurès fut assassiné :
Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?
Tandis que je rentre au bureau pour écrire ce texte, cette question ne
quitte pas le bout de ma langue… Mais avec une variation de taille… Je
l’inclue dans ce texte avec cette variation :
Pourquoi ont-ils tué les Arméniens ?
Pourquoi tuent-ils toujours les Arméniens ?
(Traduit par Sylvain Cavaillès)
L'Assemblée nationale en France
pour la reconnaissance du Haut-Karabakh
Après le Sénat, l'Assemblée nationale a
adopté massivement jeudi une résolution favorable à une reconnaissance
du Haut-Karabakh, une perspective à laquelle le ministre des Affaires
étrangères Jean-Yves Le Drian s'est déclaré opposé afin de préserver le
rôle de médiateur de la France.
La résolution non contraignante, présentée par le groupe Les
Républicains, a été adoptée par 188 voix contre 3, et 16 abstentions.
Des députés soutiens de longue date de la cause arménienne se
sont mobilisés en faveur de ce texte, deux membres du groupe d'amitié
France-Azerbaïdjan de l'Assemblée ont voté contre.
La résolution demande notamment "la mise en oeuvre d'un processus de
paix et de reconnaissance du Haut-Karabakh", région séparatiste
d'Azerbaïdjan à majorité arménienne, en proie à un conflit meurtrier
cet automne.
M. Le Drian, présent en séance, a toutefois affirmé ne "pas partager"
cette demande de reconnaissance, en soulignant que "nos amis arméniens
ne le demandent pas eux-mêmes".
Une telle décision "reviendrait à nous exclure nous-mêmes de la
co-présidence du groupe de Minsk" qui associe Paris, Moscou et
Washington dans la recherche d'une solution à ce conflit, a-t-il
souligné. "Ce serait renoncer à notre rôle de médiateur".
Le ministre s'est référé à une déclaration des trois capitales
réaffirmant jeudi l'importance du groupe de Minsk pour résoudre le
conflit, alors que la Turquie, alliée de Bakou, revendique un nouveau
format de négociations dont elle serait partie prenante.
Le Sénat français a voté le 25 novembre dernier une résolution
demandant elle aussi la reconnaissance du Haut-Karabakh, provoquant des
protestations en Azerbaïdjan et en Turquie. Le parlement azerbaïdjanais
a réclamé l'exclusion de la France de la médiation, et la Turquie
dénoncé "un exemple du mépris des principes du droit international
(...) pour des considérations de politique intérieure".
Le Nagorny Karabakh (Haut Karabakh), théâtre d'une guerre meurtrière de
1988 à 1994, a été secoué cet automne par six semaines de combats qui
ont fait plus de 4.000 morts et permis à l'Azerbaïdjan de reconquérir
une partie de la région.
Un accord de cessation des hostilités a finalement été signé le 9
novembre sous l'égide du Kremlin, l'Arménie ayant dû s'engager à rendre
plusieurs districts azerbaïdjanais échappant au contrôle de Bakou
depuis 30 ans.
La résolution dénonce la "tentative d'éradication" des Arméniens de ce
territoire, faisant un parallèle avec "les populations chrétiennes,
kurdes ou yézidies" victimes de l'extrémisme islamiste au Moyen-Orient.
Elle demande aussi au gouvernement de "réexaminer avec ses partenaires
européens" la poursuite du processus d'adhésion de la Turquie à l'Union
européenne, de nombreux orateurs dénonçant le rôle d'Ankara dans ce
conflit.
Pierre-Yves Bournazel (groupe Agir) a ainsi fustigé "l'expansionnisme
néo-ottoman du président Erdogan", et Agnès Thill (UDI) estimé que "la
Turquie n'est plus notre alliée au sein de l'Otan" et évoqué des
"sanctions" contre Ankara.
Mais plusieurs parlementaires, tout en proclamant leur solidarité avec
les Arméniens, se sont toutefois démarqués des références
confessionnelles de la résolution, qui souligne la "nécessité de
défendre activement les communautés chrétiennes minoritaires menacées
en Europe, en Orient et dans le monde". Plusieurs groupes ont laissé la
liberté de vote à leurs membres.
Le Haut Karabakh "n'est pas un conflit religieux" mais "territorial", a
notamment déclaré François Mbaye (LREM), en reprochant au texte
d'entretenir la "confusion" sur ce point.
Clémentine Autain (LFI) a elle aussi dénoncé "l'agression infâme"
contre le peuple arménien, mais a mis aussi en cause les affaires
"fructueuses" de la France avec l'Azerbaïdjan, son "premier partenaire
commercial dans le Caucase". (AFP, 3 déc
2020)
Politique
intérieure/Interior Politics
Le
Parlement prolonge le déploiement de militaires
en Libye
Le Parlement turc a adopté mardi une motion prolongeant de 18 mois
l'autorisation de déployer des militaires en Libye, où l'intervention
d'Ankara aux côtés du gouvernement de Tripoli a inversé le cours du
conflit, a rapporté l'agence étatique Anadolu.
La motion votée a été présentée par la présidence turque qui a
notamment invoqué pour la justifier la possibilité d'une reprise des
attaques de l'homme fort de l'Est libyen Khalifa Haftar contre le
gouvernement d'union nationale de Tripoli (GNA) reconnu par l'ONU.
Le Parlement turc avait voté une première motion en ce sens en janvier
2020 en réponse à un appel à l'aide du chef du GNA Fayez al-Sarraj,
confronté à l'offensive du maréchal Haftar.
Elle s'inscrivait dans le cadre d'un rapprochement entre Ankara et le
GNA, illustré par un accord de coopération militaire et sécuritaire et
un accord controversé de délimitation maritime conclus en novembre 2019
entre M. Sarraj et le président turc Recep Tayyip Erdogan.
Le soutien turc au gouvernement de Tripoli, notamment par l'envoi de
conseillers militaires et de drones, lui a permis d'infliger une série
de défaites aux portes de Tripoli aux forces du maréchal Haftar, qui
est soutenu par la Russie et des rivaux régionaux d'Ankara, notamment
les Emirats arabes unis et l'Egypte.
Un cessez-le-feu signé en octobre sous l'égide de l'ONU et globalement
respecté depuis a permis aux parties rivales de retourner à la table
des négociations. Mais de profondes divisions sur le choix d'un nouvel
exécutif de transition compromettent les chances de succès du dialogue
politique. (AFP,
22 déc
2020)
Forces
armées/Armed Forces
La
Turquie effectue des exercices militaires dans
un contexte de tensions
La marine turque a effectué des exercices de tir en Méditerranée
orientale, a annoncé dimanche le ministère turc de la Défense, dans un
contexte de tensions avec la Grèce au sujet de l'exploration gazière.
"Des éléments de notre commandement de la force navale ont effectué des
exercices de tir en Méditerranée orientale", a affirmé sur Twitter le
ministère turc de la défense, sans préciser dans quel secteur de la
Méditerranée ces exercices ont eu lieu.
Le ministère a cependant partagé des photos où les tirs effectués et
les navires turcs sont visibles.
Les exercices militaires d'Ankara interviennent alors que l'Union
européenne a décidé le 10 décembre dernier de sanctionner les actions
"illégales et agressives" de la Turquie en Méditerranée contre la Grèce
et Chypre.
Les travaux d'exploration gazière menés par la Turquie en Méditerranée
orientale, dans des zones maritimes disputées avec la Grèce et Chypre,
étaient depuis des mois au centre de tensions.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a cependant affirmé vendredi à
la chancelière allemande Angela Merkel vouloir ouvrir une "nouvelle
page" avec l'UE.
Affirmant que le rôle de la Turquie est "constructif", M. Erdogan a
accusé la Grèce de refuser de négocier. (AFP, 20 déc
2020)
16 morts, dont trois soldats turcs, dans une explosion
dans le Nord-Est
de Syrie
Seize personnes, dont deux civils et trois soldats turcs, ont été tuées
jeudi dans le nord-est de la Syrie dans l'explosion d'une voiture
piégée à un point de contrôle de la localité frontalière de Ras al-Aïn,
sous contrôle turc, a rapporté une ONG.
Les 11 autres étaient des membres des forces de sécurité ou d'un groupe
proturc en poste sur le checkpoint, selon l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH). Au moins 12 personnes ont également été
blessées.
Ankara a de son côté fait état de la mort de deux gendarmes turcs,
tandis que huit autres ont été blessés.
Ras al-Aïn et ses environs sont contrôlés par les supplétifs syriens de
la Turquie depuis une offensive lancée par Ankara dans le nord-est de
la Syrie en octobre 2019 pour en chasser la principale milice kurde des
Unités de protection du Peuple (YPG).
L'offensive d'Ankara lui a permis de prendre le contrôle à sa frontière
d'une bande de territoire de 120 km de long et d'une trentaine de
kilomètres de large, allant des villes de Tal Abyad à Ras al-Aïn.
Depuis, les attaques sont fréquentes dans la région.
La guerre en Syrie a fait plus de 387.000 morts et des millions de
réfugiés depuis son déclenchement en 2011 avec la répression brutale de
manifestations contre le gouvernement. (AFP, 10 déc
2020)
Un
militaire turc tué dans la région d'Afrine
en Syrie
Un militaire turc a été tué dans des
affrontements avec la milice kurde des YPG dans la région d'Afrine dans
le nord de la Syrie, contrôlée par Ankara et ses supplétifs syriens, a
annoncé vendredi le ministère turc de la Défense.
Le soldat turc a été tué jeudi lors d'affrontements qui ont éclaté "à
la suite d'une tentative d'incursion de l'organisation terroriste
PKK/YPG", a indiqué le ministère
dans un communiqué.
La Turquie contrôle la région à majorité kurde d'Afrine depuis une
offensive menée en 2018 avec le soutien de ses supplétifs syriens
contre les YPG (Unités de protection du peuple, principale milice kurde
en Syrie).
Ankara considère cette milice comme la branche syrienne du Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK) qui mène une rébellion dans le sud-est
de la Turquie depuis 1984.
Mais les YPG sont les alliés de la coalition internationale menée
par Washington dans la lutte contre le groupe Etat islamique.
La Turquie et ses supplétifs syriens contrôlent des pans entiers du
nord de la Syrie à la faveur de trois offensives menées dans ce secteur
depuis 2016. (AFP,
3 déc
2020)
Affaires
religieuses / Religious Affairs
Un Allemand de l'EI mis en
accusation pour des attaques contre des Turcs
Un Allemand, présenté comme sympathisant de l'organisation Etat
islamique (EI), a été mis en accusation pour une série d'attaques
visant des magasins turcs et une mosquée, et des projets d'attentat
avec une arme et des explosifs, a annoncé le parquet fédéral lundi.
Présenté comme Muharrem D., l'homme est accusé de tentative de meurtre
de 31 personnes par incendie volontaire, de blessures graves sur quatre
personnes et d'avoir planifié "un acte violent portant atteinte à la
sécurité de l'Etat".
Il avait été interpellé en mai après une série d'attaques contre des
magasins turcs en Bavière, notamment l'incendie d'un magasin de fruits
et légumes tenu par une personne de nationalité turque, avait alors
annoncé le parquet de Karlsruhe, compétent en matière d'affaires de
terrorisme.
Muharrem D. a entamé une radicalisation religieuse en 2017, adhérant
aux thèses islamo-jihadistes avant de devenir un sympathisant de l'EI,
selon la justice allemande.
Il avait développé une haine contre la Turquie en raison notamment de
son intervention dans le nord de la Syrie et décidé de s'attaquer à des
Turcs ou personnes d'origine turque vivant en Allemagne.
Il avait prévu de perpétrer un attentat contre une mosquée de
l'organisation DITIB, dépendante du ministère turc du culte, dans la
région de Waldkraiburg, près de la frontière autrichienne.
Il prévoyait également une attaque du consulat de Turquie à Munich et
un attentat à la bombe contre l'une des plus grandes mosquées du pays,
à Cologne.
Pour cela, il s'était procuré du matériel pour fabriquer un engin
explosif, dont 34 kilogrammes d'explosif et 23 bombes tuyaux, un
pistolet et des munitions.
Depuis la mi-avril, il s'en était déjà pris à des commerces tenus par
des ressortissants turcs, notamment un salon de coiffure dont il avait
cassé une vitre et lancé un liquide nauséabond à base d'acide
butyrique. (AFP,
21 déc
2020)
La
Turquie va envoyer des
djihadistes du nord-est de la Syrie au Cachemire
Après l'invasion turco-azerbaïdjanaise de la région arménienne autonome
du Haut-Karabakh, la Turquie se prépare a envoyé son armée composée de
mercenaires dans la région du Cachemire contre l'Inde.
Après l’invasion turco-azerbaïdjanaise de la région arménienne autonome
du Haut-Karabakh, la Turquie se prépare à envoyer son armée composée de
mercenaires dans la région du Cachemire contre l’Inde.
Les troupes djihadistes de l’« Armée syrienne libre » (ASL),
rassemblées et entraînées par la Turquie dans le nord de la Syrie,
deviennent de plus en plus l’armée mercenaire internationale de la
Turquie.
Après leurs opérations en Syrie, en Libye, en Azerbaïdjan, dans
l’Artsakh, au Yémen et au Sud-Kurdistan (Irak), les mercenaires de
l’ASL allié du Pakistan, doivent maintenant être envoyés au Cachemire
pour lutter contre l’Inde.
Selon l’agence de presse kurde Firatnews (ANF), le commandant de la
brigade Sulayman Shah de l’ASL Muhammed Abu Amsha, a annoncé il y a
cinq jours aux membres de sa milice dans la ville occupée de Şiyê près
d’Afrin que l’État turc voulait relocaliser certaines unités au
Cachemire. Il a expliqué que des officiers turcs lui avaient demandé,
ainsi qu’à d’autres commandants de l’ASL, de leur fournir une liste de
noms de volontaires. Ceux qui accepteraient d’y aller recevraient 2 000
dollars au départ. Le même processus a eu lieu également a Azaz ,
Jarablus, Bab et Idlib. Les volontaires seraient alors secrètement
emmenés hors du pays.
Le Pakistan est soutenu dans ses ambitions au Cachemire par l’axe
Ankara-Doha. Les agences de presse de l’État turc tentent actuellement
de faire croire à une guerre au Cachemire, comme lors de l’invasion du
Haut-Karabakh.
Approfondissement du conflit au Cachemire
Le déplacement irrégulier des troupes turques intervient à un moment où
la tension entre les puissances nucléaires que sont l’Inde et le
Pakistan s’accroît. Depuis le 13 novembre, les deux parties se
bombardent mutuellement avec de l’artillerie au Cachemire. Au moins 13
personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées dans les deux
camps. Les combats se déroulent sur la frontière de 740 kilomètres
entre l’ « Azad Cachemire » sous contrôle pakistanais et le « Jammu
Cachemire » sous contrôle indien. Au cours des cinq derniers jours
seulement, trois soldats indiens et trois insurgés soutenus par le
Pakistan ont été tués.
Le Cachemire est divisé entre l’Inde et le Pakistan depuis 1947. Il y a
toujours des escalades guerrières entre les deux pays et elles
concernent généralement la région du Cachemire. En particulier, la
majorité musulmane de la population du Jammu Cachemire se bat contre la
domination indienne. Le parti au pouvoir en Inde, le BJP, représente un
nationalisme hindou agressif et incite à la haine des musulmans. Il
fournit des munitions aux groupes islamistes et au Pakistan. Des
dizaines de milliers de civils ont été tués dans la guerre de 30 ans
pour le Cachemire.
Des liens étroits entre la Turquie et le Pakistan
Les relations entre le Pakistan et la Turquie sont de plus en plus
étroites ces dernières années. Le Pakistan, la Turquie et le Qatar ont
récemment engagé une action contre la France sous le prétexte des «
caricatures de Mahomet ». En 2019, la Turquie, la Malaisie et le
Pakistan avaient déjà convenu de créer une chaîne de télévision commune
pour la « lutte mondiale contre l’islamophobie ». En février, le
responsable de la présidence turc de la communication et des médias,
Fahrettin Altun, a déclaré que le Pakistan et la Turquie visaient à
renforcer leur coopération économique en portant les échanges
commerciaux à 5 milliards de dollars d’ici 2023. M. Altun a ajouté que
les deux pays travailleraient ensemble dans plusieurs domaines, dont la
défense et l’énergie.
L’État turc a également fait campagne au Pakistan et au Bangladesh pour
la reconnaissance de la partie nord de la Chypre occupée par la
Turquie. En novembre, les médias affiliés à Erdoğan ont déclaré qu’«
après le succès au Karabakh », la partie nord de Chypre sera également
« reconnue par les pays amis ». Dans ce contexte, le nouveau président
de Chypre occupée par la Turquie, Ersin Tatar, devrait effectuer une «
visite de reconnaissance » au Pakistan, en Libye et en Azerbaïdjan dans
un avenir proche. (ROJINFO, 3 décembre 2020)
Plus
de 900 combattants Syriens rentrés après les
combats
Plus de 900 combattants syriens proturcs
sont retournés par vagues successives en Syrie après la fin des combats
au Nagorny Karabakh, a rapporté mercredi l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH).
A l'issue de six semaines d'affrontements, l'Azerbaïdjan et l'Arménie
ont signé le 9 novembre un accord de fin des hostilités.
La Turquie, qui soutient l'Azerbaïdjan, a été accusée d'envoyer
des combattants syriens au Nagorny Karabakh pour épauler les forces de
Bakou, ce que le président Recep Tayyip Erdogan a démenti.
"Plus de 900 combattants des factions pro-Ankara sont rentrés en Syrie
en plusieurs vagues", a indiqué l'OSDH, soulignant que la dernière
avait eu lieu le 27 novembre.
Ces combattants ont retrouvé les territoires sous contrôle turc dans le
nord syrien, notamment les régions d'Afrine, Jarablos ou encore Al-Bab,
a indiqué à l'AFP le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.
"Plusieurs autres vagues de retour pourraient suivre dans les jours à
venir", a ajouté M. Abdel Rahmane, disant s'attendre à ce que "tous"
ceux qui ont été envoyés en Azerbaïdjan finissent par rentrer en Syrie.
"Le nombre total de combattants syriens envoyés en Azerbaïdjan était de
2.580", a-t-il affirmé, précisant que 293 d'entre eux avaient péri dans
des combats.
La France avait récemment réclamé une "supervision internationale" du
cessez-le-feu au Nagorny Karabakh, notamment pour garantir le retour
des combattants étrangers, en particulier des Syriens.
"Le départ des combattants étrangers déployés dans ce conflit est un
élément fondamental pour la stabilité de la région", soulignait ainsi
une source diplomatique française en novembre. (AFP, 2 déc
2020)
Socio-économique
/ Socio-economic
Eastern Mediterranean: Turkey to
continue exploration until mid-June
Turkey has
issued another navigational telex, or Navtex, for the area in the
Eastern Mediterranean where it will conduct seismic research activities.
According
to
yesterday's (December 22) announcement, the mission, which will be
carried out by the Oruç Reis seismic research vessel, will continue
until June 15, 2021.
A Navtex is
a
maritime communications system that allows ships to inform other
vessels about their presence in an area as well as other information.
Ahead of
the EU
leaders' summit on December 10-11, the Oruç Reis vessel returned to
Turkey's southern port of Antalya on November 29.
The Oruç
Reis
will carry out seismic studies in the Eastern Mediterranean together
with two other vessels, the Ataman and Cengiz Han.
It will
conduct
various geological, geophysical, hydrographic and oceanographic
surveys, especially of the continental shelf, while also searching for
natural resources.
Ankara has
opposed Greece's claim of an exclusive economic zone based on islands
near Turkey's shores.
Over the
past
one-and-a-half years, Ankara has sent several drillships to explore for
energy resources in the Eastern Mediterranean, often in the waters
claimed by Greece and Southern Cyprus. (BIA, 23 December 2020)
‘Minimum wage has become an
average wage in Turkey’
Chaired by
Minister of Family, Labor and Social Services Zehra Zümrüt Selçuk,
Minimum Wage Determination Commission convened for the third time on
December 22 to determine the minimum wage for 2021.
In the meeting hosted by the Confederation of Turkish Trade Unions
(TÜRK-İŞ) on behalf of workers, representatives from the Turkish
Statistical Institute (TurkStat), the state agency commissioned with
producing official statistics on the country, also made an offer and
recommended that the minimum wage should be 2,792 lira (~366 USD) next
year.
The fourth and final meeting of the commission will be hosted by the
Ministry of Family, Labor and Social Services next week.
Ahead of this last meeting, we have spoken with Confederation of
Progressive Trade Unions of Turkey (DİSK) Chair Arzu Çerkezoğlu about
how the minimum wage and the purchasing power of minimum wage earners
have changed in Turkey over the years and how the minimum wage
negotiations have been going on since the first meeting on December 4.
Underlining that the minimum wage has turned into an average wage in
Turkey, Çerkezoğlu says, "Turkey has a minimum wage that has been
significantly deteriorating in terms of purchasing power, that cannot
get its share from the national income and that is constantly
deteriorating against the dollar, gold prices and inflation" and adds:
"It is not acceptable that 15 people, sitting around a table, make a
decision about the lives of millions of people. What we offer as an
alternative is to ensure that the minimum wage is determined in a real
collective bargaining where all confederations and labor organizations
participate."
How has the minimum wage and the purchasing power of minimum wage
earners changed over the years in Turkey, especially amid the COVID-19
pandemic? How do you think the state policies and the attitude of
employers have affected this change?
Both the minimum wage and the purchasing power of workers subsisting on
minimum wage have deteriorated significantly in Turkey over the years.
In fact, all numbers and statistics show how much the minimum wage has
deteriorated in Turkey in terms of purchasing power.
There is a minimum wage in Turkey that is constantly deteriorating
against the dollar, against gold prices and especially against
inflation. This deterioration has now pushed it below the starvation
level. There is a minimum wage in Turkey that is below the starvation
level, let alone the poverty level. There is a minimum wage
deteriorating over the years.
In fact, this can also be understood from some basic figures. When we
consider the course of the minimum wage, which has become an average
wage, from this perspective, and when we compare it with the per capita
income as well as with the dollar, gold prices and inflation rate, we
see a serious deterioration. While the share of the labor, the wage
earners in the total value, in the value that we produce, i.e. in the
per capita income, was around 50 percent in early 2000s, even hitting
52 percent, it dropped as low as 30 percent before the onset of the
crisis, before the pandemic.
With the outbreak of the pandemic, this fall has increased further;
therefore, the fact that the share of the labor, the wage earners in
the per capita income has dropped from 50 percent to 30 percent is, in
fact, a basic macro indicator which shows us how the minimum wage,
which has become an average wage, has deteriorated over the years.
For instance, based on the gold prices of the Central Bank, a minimum
wage earner could afford 25 cumhuriyet (republic) gold coins with his
or her annual income 10 years ago; this number has now dropped to 10
coins.
Again, on a dollar basis, the minimum wage was as high as 460 dollars
in Turkey in 2006-2007; but, it has now dropped below 300 dollars, in a
first. When we compare it with other countries, we have one of the
lowest minimum wages among the OECD countries. (BIA, 22 December 2020)
Match PSG-Basaksehir interrompu: Erdogan dénonce
"fermement" le racisme
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a "fermement" condamné mardi les
propos "racistes" attribués à un arbitre assistant qui ont abouti à
l'interruption du match de Ligue des champions entre le Paris SG et
Basaksehir, appelant l'UEFA à sévir.
"Je condamne fermement les propos racistes tenus à l'encontre de Pierre
Webo, membre du staff technique de Basaksehir, et suis convaincu que
l'UEFA prendra les mesures qui s'imposent", a déclaré M. Erdogan sur
Twitter.
"Nous sommes inconditionnellement opposés au racisme et aux
discriminations dans le sport et tous les autres domaines de la vie",
a-t-il ajouté.
Dans un geste inédit dans l'histoire de la Ligue des champions, les
joueurs du Paris SG et du Basaksehir Istanbul ont quitté la pelouse en
cours de match pour protester contre des propos racistes supposés du
quatrième arbitre.
Cet épisode a suscité une vive émotion en Turquie, où clubs et
ministres se sont succédé pour exprimer leur solidarité avec Basaksehir.
M. Erdogan dénonce régulièrement ce qu'il qualifie de "montée du
racisme et de l'islamophobie" en Europe.
Le président du club Göksel Gümüsdag, un proche de M. Erdogan, a
affirmé que ses joueurs refuseraient de revenir sur la pelouse si le
quatrième arbitre n'était pas écarté.
Il a affirmé que le quatrième arbitre avait utilisé le mot "negro" pour
qualifier Pierre Achille Webo, membre camerounais de l'encadrement du
Basaksehir.
Pour ne rien arranger, l'arbitre a expulsé M. Webo du banc de touche,
après que ce dernier eut protesté avec véhémence. (AFP, 8 déc
2020)
Méditerranée orientale: Erdogan appelle à une
"formule gagnant-gagnant"
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé lundi à une "formule
gagnant-gagnant" pour régler les contentieux
en Méditerranée orientale avec la Grèce et Chypre, à l'approche d'un
sommet européen pendant lequel la question de sanctions contre Ankara
sera sur la table.
"J'appelle tous nos voisins et riverains de la Méditerranée, en
particulier la Grèce, à ne pas voir cette question comme un jeu à somme
nulle", a déclaré M. Erdogan dans un message vidéo diffusé lundi.
"Je suis convaincu qu'une formule gagnant-gagnant préservant les droits
de chaque partie pourrait être trouvée", a-t-il ajouté.
Des sanctions contre Ankara sont à l'ordre du jour du sommet européen
du 10 décembre, en raison des travaux d'exploration gazière menés par
la Turquie en Méditerranée orientale dans des zones maritimes disputées
avec la Grèce et Chypre.
L'Union européenne a condamné vendredi la poursuite des "actes
unilatéraux" et la "rhétorique hostile" de la part de la Turquie, mais
reste à ce stade divisée sur la manière de sanctionner ces
comportements.
L'UE avait adressé en octobre une proposition d'ouverture à Ankara,
assortie d'une menace de sanctions si la Turquie ne cessait pas ses
actions.
Mais plusieurs États membres, dont l'Allemagne, sont opposés à
l'adoption de sanctions, selon des responsables européens.
Les tensions entre Athènes et Ankara se sont intensifiées avec le
déploiement en août par la Turquie du navire Oruç Reis, escorté par des
bâtiments de guerre, pour procéder à des explorations au large de l'île
grecque de Kastellorizo, à deux kilomètres des côtes turques.
Ankara a annoncé fin novembre le retour au port de l'Oruç Reis.
"Nous demandons à nos interlocuteurs de ne pas ignorer la main tendue
par la Turquie", a affirmé M. Erdogan, en référence à sa proposition
d'organiser une conférence internationale pour le règlement des
désaccords en Méditerranée orientale.
Le chef d'Etat turc a aussi exhorté l'UE à ne pas "se laisser manipuler
par la Grèce et les Chypriotes grecs", qui poussent pour des sanctions
contre la Turquie.
(AFP, 7 déc
2020)
WHO says it wasn't aware of Turkey's real Covid-19
numbers
The World Health Organization (WHO) has said that it didn't know the
number of all cases in Turkey before the Ministry of Health started
including asymptomatic cases in its daily count.
WHO asks every country to report all cases and it was "relieving" that
Turkey finally started to do so, Dr. Irshad Ali Shaikh, the head of the
WHO office in Turkey, told Deutsche Welle Turkish.
The accuracy of Turkey's official figures has been disputed by medical
organizations and opposition politicians since the start of the
outbreak.
In late September, Minister of Health Fahrettin Koca admitted that
Turkey was not including asymptomatic cases in its daily count.
On November 25, the ministry announced that it started to announce all
cases and has been reporting about 30,000 daily infections since then,
confirming that Turkey is one of the most affected countries by the
pandemic.
However, the Turkish Medical Association (TTB) said last week that the
real number should be around 60,000.
Amid growing suspicion on the ministry figures, the İstanbul
Municipality has also been announcing the daily number of deaths by an
infectious disease since November 22.
The municipality's figures for İstanbul usually match or exceed the
ministry's death toll for the entire country.
Turkey's numbers were "worrying" just as other countries, Shaikh said,
adding that he hoped the new measures implemented at the start of
December would prevent the spread of the virus.
The government has been enforcing a number of measures, including
weeknight and weekend curfews to slow down the outbreak. (BIA, 7 December 2020)
Des
restaurations bâclées en Turquie
suscitent l'inquiétude
Des travaux bâclés, des monuments
historiques endommagés voire défigurés: la restauration du patrimoine
culturel suscite des controverses en Turquie où des experts imputent
ces ratés à un favoritisme alimentant une course aux profits et à des
considérations idéologiques.
La Tour de Galata, un monument emblématique d'Istanbul construit au
14ème siècle, est le dernier édifice dont la rénovation a fait l'objet
d'une telle controverse. La démolition de l'un de ses murs au
marteau-piqueur en août a été interrompue de justesse après la
diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo de cette scène qui a
suscité l'indignation.
Le ministre de la Culture, Nuri Ersoy, avait alors tenté d'éteindre la
polémique en assurant que les travaux au marteau-piqueur avaient été
menés sur des murs "ne faisant pas partie de la construction
originale", tout en promettant des sanctions contre les responsables du
chantier.
Des mosaïques romaines endommagées par une restauration bâclée, du
béton coulé au milieu d'un amphithéâtre antique, des citadelles
historiques qui paraissent désormais flambant neuves: la liste des
monuments mal rénovés s'est allongée ces dernières années.
Pour Osman Köker, fondateur de la galerie Birzamanlar, un lieu
d'exposition sur la diversité culturelle du pays, "une grossièreté"
envers des édifices anciens, tendant à effacer les traces des minorités
non-musulmanes, a toujours existé en Turquie.
- "Profits avant tout" -
Pourtant, le tableau fut autrement plus reluisant au début des années
2000, à l'aube du pouvoir du président Recep Tayyip Erdogan, alors
Premier ministre.
"Dans le cadre des efforts pour l'adhésion à l'Union européenne, la
restauration des monuments à haute valeur symbolique était alors
privilégiée", explique M. Köker.
Ainsi, en 2011, la restauration réussie de l'église arménienne
d'Ahtamar, dans l'est de la Turquie, avait reçu de nombreux éloges.
Mais l'éloignement d'Ankara de l'UE ces dernières années et le
durcissement du pouvoir islamo-conservateur de M. Erdogan ont changé la
donne, souligne Korhan Gumus, architecte spécialisé en protection du
patrimoine.
"Les appels d'offres de rénovation ne sont désormais attribués
par le gouvernement qu'à des groupes privilégiés. Ceux-ci ont instauré
un monopole et voient les projets avant tout comme un moyen de générer
des profits", déplore-t-il.
Il impute ces dérives à "un système qui gère les rénovations uniquement
par le biais des appels d'offres, sans réflexion préalable sur
l'histoire ou l'environnement".
"On se contente d'une restitution de l'original, ce qui donne des
résultats caricaturaux. Or, les monuments comportent souvent des
parties ajoutées au cours des siècles par différentes civilisations
qu'il faudrait conserver", ajoute-il.
Sollicité par l'AFP, le ministère de la Culture n'a pas réagi aux
critiques.
- "Décisions arbitraires" -
C'est Mahir Polat, directeur du Département de l'héritage culturel à la
mairie d'Istanbul, qui a tiré la sonnette d'alarme sur la destruction
au marteau-piqueur d'un mur de la Tour de Galata.
La mairie, dirigée par une figure de l'opposition, a déposé une
plainte, mais la demande de M. Polat d'inspecter le site a été rejetée
par le ministère de la Culture, qui pilotait les travaux.
"Lorsque la restauration n'est perçue que comme une activité de
chantier, on rate le but de conservation", estime M. Polat.
Le tableau est aussi assombri selon lui par certaines "décisions
arbitraires", qui court-circuitent les organismes en charge de la
protection du patrimoine.
Il dit ainsi avoir découvert en juillet qu'une fontaine historique à
Uskudar, dans la partie asiatique d'Istanbul, avait disparu du jour au
lendemain dans le cadre de l'élargissement d'une route.
La municipalité du district, dirigée par le parti au pouvoir, avait
décidé selon lui de "déplacer" la fontaine sans avoir obtenu les permis
nécessaires. "La valeur historique d'un monument n'a de sens que dans
le lieu où il se trouve. Vous ne pouvez pas le transporter comme un
objet quelconque".
"On n'a d'ailleurs pas de nouvelles de cette fontaine depuis",
ajoute-t-il.
Pour Tugba Tanyeri Erdemir, chercheuse à l'Université de Pittsburgh, la
Turquie privilégie "une mise sous domination du patrimoine culturel
plutôt que sa conservation".
"Nous l'avons vu avec les décisions de reconversion de la basilique de
Sainte-Sophie et de l'église de la Chora", souligne-t-elle.
La reconversion récente de ces édifices en mosquées avait suscité des
inquiétudes sur le sort de leurs mosaïques byzantines.
"La mémoire d'une ville est intimement liée à son espace. Nous n'avons
pas su vivre avec les édifices anciens dans le passé", déplore M.
Polat. "J'espère que nous nous rendrons un jour compte que nous avons
un trésor entre nos mains". (AFP, 2 déc
2020)
Relations
turco-européennes / Turkey-Europe Relations
Nouvelle mise en garde de l'UE à la
Turquie sur les droits fondamentaux
L'Union européenne a dénoncé vendredi la lourde condamnation infligée
par contumace au journaliste turc Can Dündar et a mis en garde Ankara
contre les conséquences de "l'évolution négative" de la situation des
droits de l'homme pour leurs relations.
En exil en Allemagne, Can Dündar, devenu la bête noire du président
Recep Tayyip Erdogan a été condamné mercredi à plus de 27 ans de prison
par un tribunal turc pour son enquête publiée en 2015 sur des
livraisons d'armes par les services secrets turcs à des groupes
islamistes en Syrie.
"L'Union européenne a fait part à plusieurs reprises de ses graves
préoccupations concernant l'évolution négative continue de la situation
en matière d'État de droit, de droits fondamentaux et du système
judiciaire en Turquie", a souligné Nabila Nassrali, la porte-parole du
chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.
"Des recommandations ont été faites à la Turquie pour remédier à cette
situation, mais la décision d'un tribunal turc de condamner le
journaliste Can Dündar pour ce qui est de son droit fondamental à la
liberté d'expression va malheureusement dans la direction opposée, tout
comme la détention préventive continue de (l'homme d'affaire) Osman
Kavala", a-t-elle déploré.
"En tant que pays candidat et membre de longue date du Conseil de
l'Europe, la Turquie doit de toute urgence faire des progrès concrets
et durables dans le respect des droits fondamentaux, qui sont une
pierre angulaire des relations entre l'UE et la Turquie", a-t-elle
averti.
"Cela inclut la mise en oeuvre rapide par le système judiciaire turc
des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et la libération
de toute urgence d'Osman Kavala et de Selahattin Demirtas (le
coprésident du Parti démocratique des peuples)", a-t-elle affirmé. (AFP, 25 déc
2020)
La CEDH victime d'une
"cyberattaque" après un arrêt condamnant la Turquie
Le site internet de la Cour européenne des droits de l'homme a été la
cible d'une "cyberattaque de grande ampleur qui l'a rendu
temporairement inaccessible" juste après la publication mardi d'un
arrêt sévère condamnant la Turquie pour la détention d'un opposant
pro-kurde, a annoncé mercredi la CEDH.
"A ce stade, aucune perte de données" n'a été constatée, a précisé à
l'AFP le service de presse de la Cour.
La cyberattaque, dont l'origine n'est pas encore été formellement
identifiée et qui a duré plusieurs heures, a été constatée "à la suite
du prononcé de l'arrêt" rendu public mardi à 15H00 (14H00 GMT)
concernant notamment la détention depuis novembre 2016 dans les geôles
turques du leader pro-kurde Selahattin Demirtas, a indiqué dans un
communiqué la CEDH, dont le siège est à Strasbourg.
Cette "cyberattaque de grande ampleur (...) a rendu temporairement
inaccessible" le site de la Cour, a indiqué la CEDH, qui "déplore
vivement cet incident grave".
Selon le service de presse de la Cour, l'attaque a duré jusqu'à
mercredi matin. Le site, qui était inaccessible depuis mardi
après-midi, était de nouveau consultable en milieu de matinée, a
constaté l'AFP.
"Nous considérons les suites que nous entendons réserver à cette
affaire", a encore indiqué le service de presse de la Cour.
C'est a priori la deuxième fois que la CEDH est victime d'une
cyberattaque, "mais celle-ci est de grande ampleur", a précisé le
service de presse.
La CEDH a rendu mardi après-midi un arrêt cinglant dans l'affaire de
l'opposant au président turc Recep Tayyip Erdogan. La Cour, qui a
relevé plusieurs violations de la Convention européenne des droits de
l'homme, a également exigé la libération "immédiate" de M. Demirtas. (AFP, 23 déc
2020)
Erdogan condamne une décision de
la CEDH en faveur du leader kurde Demirtas
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a violemment condamné mercredi
l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) ordonnant la
"libération immédiate" du leader kurde Selahattin Demirtas.
"C'est une décision entièrement politique. (...) Demander la libération
de celui qui est responsable de la mort de 39 de nos concitoyens relève
d'une politique de deux poids deux mesures, c'est de l'hypocrisie", a
martelé M. Erdogan.
Il faisait référence aux violentes manifestations qui ont fait des
dizaines de morts en 2014 dans le sud-est de la Turquie, dont les
autorités turques attribuent la responsabilité aux dirigeants du parti
pro-kurde HDP, ce que ceux-ci nient.
La CEDH a condamné mardi la Turquie pour la détention depuis 2016 de
Selahattin Demirtas, exigeant sa libération "immédiate" et accusant
Ankara de poursuivre "un but inavoué d'étouffer le pluralisme".
Ancien coprésident du HDP et un des principaux rivaux du président
turc, M. Demirtas est accusé par Ankara de "terrorisme" et risque
jusqu'à 142 années de prison.
Pour le président turc, la Cour de Strasbourg a rendu un verdict
"d'exception", en examinant le cas de M. Demirtas avant que celui-ci
n'ait épuisé les voies de recours interne, une condition pour déposer
une requête au CEDH.
Or pour la CEDH, le jugement en cours de M. Demirtas devrait être vu
comme une prolongation d'un premier procès pour lequel la Cour avait
déjà statué en 2018 et demandé sa libération, en vain.
"La CEDH doit savoir qu'elle défend une personne en lien avec le PKK",
a dénoncé M. Erdogan en référence au parti des Travailleurs du
Kurdistan (PKK), classé "terroriste" par Ankara et ses alliés
occidentaux.
"Cette personne est coupable aux yeux de notre nation non à cause de
ses discours politiques, mais parce qu'il n'a pas pu se distancier du
terrorisme", a-t-il ajouté.
Les milieux prokurdes, en particulier le HDP, font l'objet d'une
répression implacable depuis plusieurs années en Turquie.
Le pouvoir turc accuse le HDP d'être une "vitrine politique" du PKK,
une accusation rejetée par le parti prokurde qui se dit victime de
répression en raison de sa farouche opposition au président turc.
"Ce verdict ne m'a pas réjoui. Car je ne suis pas le seul à payer le
prix de la destruction du droit et de la démocratie, nos 83 millions de
concitoyens le font de la manière la plus dure", a réagi mardi M.
Demirtas au verdict sur son compte Twitter, géré par ses avocats.
Le site internet de la CEDH a été la cible d'une "cyberattaque de
grande ampleur qui l'a rendu temporairement inaccessible" juste après
la publication mardi de son arrêt, a annoncé mercredi la cour. (AFP, 23 déc
2020)
L'UE
alloue l'aide promise à la Turquie pour
l'accueil des réfugiés
L'Union européenne a alloué jeudi la totalité de l'aide de six
milliards d'euros promise à la Turquie en contrepartie de son accueil
des réfugiés, marquant selon Bruxelles une "étape clé" du pacte signé
entre Ankara et Bruxelles en 2016 au sujets des migrants.
Un accord avait été conclu entre la Turquie et l'UE à la suite de la
crise migratoire sans précédente que l'Europe avait connu depuis la
Seconde guerre mondiale en 2015, avec l'arrivée de plus d'un millions
de personnes.
Avec cet accord, la Turquie a accepté le renvoi vers son territoire de
tous les nouveaux migrants arrivant aux îles grecques, y compris les
demandeurs d'asile comme les Syriens fuyant la guerre.
En contrepartie, le versement d'une aide de six milliards d'euros avait
été promise à la Turquie pour améliorer les conditions de vie des
quelque 3,6 millions de réfugiés qu'elle accueille.
L'aide ne sera pas versée au gouvernement turc mais allouée aux projets
spécifiques au profit des réfugiés.
"Aujourd'hui nous finalisons l'allocation de six milliards d'euros
d'aide de l'Union européenne pour soutenir les réfugiés et leur accueil
par la Turquie", a annoncé l'ambassadeur Nikolaus Meyer-Landrut, chef
de la délégation de l'Union européenne en Turquie.
Pour M. Meyer-Landrut, Ankara et Bruxelles ont ainsi accompli "une
étape clé" et devraient s'assurer du fait que "les projets bénéficient
aux réfugiés".
Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait accusé dans le passé l'UE
de ne pas tenir ses promesses financières à ce sujet.
Ankara jugait insuffisante l'aide octroyée pour la prise en charge de
près de quatre millions de migrants et de réfugiés, principalement
Syriens, qu'elle accueille depuis des années.
Sur 6 milliards d'euros d'aide prévue, 4,7 milliards avaient été
engagés en mars, dont 3,2 milliards qui avaient déjà été décaissés,
selon la Commission européenne.
Le président turc avait cependant affirmé en septembre que la Turquie
avait dépensé 40 milliards de dollars pour l'accueil des réfugiés.
L'annonce de l'allocation par l'UE de la totalité de l'aide intervient
une semaine après les sanctions décidées par Bruxelles contre Ankara.
Les dirigeants de l'Union européenne réunis en sommet à Bruxelles
avaient décidé jeudi dernier de sanctionner les actions "illégales et
agressives" de la Turquie en Méditerranée contre la Grèce et Chypre.
Les travaux d'exploration gazière menés par la Turquie en Méditerranée
orientale, dans des zones maritimes disputées avec la Grèce et Chypre,
étaient depuis des mois au centre de tensions.
Malgré les sanctions, l'UE a affirmé sa volonté pour "continuer à
fournir une aide financière aux réfugiés syriens et aux communautés
d'accueil en Turquie et à coopérer dans le domaine de la gestion
responsable des flux migratoires". (AFP, 18 déc
2020)
Erdogan
à Merkel: la Turquie veut ouvrir une "nouvelle
page" avec l'Europe
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a assuré vendredi à la
chancelière allemande Angela Merkel vouloir ouvrir une "nouvelle page"
avec l'Union européenne, a-t-on appris de source officielle.
Au cours d'une vidéoconférence avec Mme Merkel, "le président Erdogan a
déclaré que la Turquie veut ouvrir une nouvelle page dans ses relations
avec l'UE, et a remercié la chancelière pour ses contributions
constructives et ses efforts en faveur des relations Turquie-UE",
indique un communiqué de la présidence turque.
"Il y a une nouvelle fenêtre d'opportunité" pour renforcer les
relations Turquie-UE, mais certains pays essaient de "créer une crise"
pour perturber cet "agenda positif", affirme-t-elle, sans citer le nom
des pays en question.
Les dirigeants européens, réunis en sommet la semaine dernière à
Bruxelles, ont décidé d'imposer des sanctions ciblées contre Ankara
pour ses "actions unilatérales et ses provocations" en Méditerranée
orientale, riches en ressources gazières et où la Turquie conteste le
tracé des frontières maritimes en menant des travaux d'exploration.
Les relations sont particulièrement difficiles depuis des mois avec la
Grèce et Chypre, aux premières loges de la campagne turque, mais
également avec la France, qui les soutient.
Affirmant que le rôle de la Turquie est "constructif", Erdogan a accusé
la Grèce de refuser de négocier.
Il a aussi appelé à une révision de l'accord conclu en 2016 entre l'UE
et la Turquie sur les migrants, révision qui serait la "clé d'un agenda
positif avec l'Europe".
Cet accord avait été conclu à la suite de la crise migratoire que
l'Europe avait connue en 2015, avec l'arrivée de plus d'un million de
personnes.
La Turquie acceptait alors le renvoi vers son territoire de tous les
nouveaux migrants arrivant aux îles grecques, y compris les demandeurs
d'asile comme les Syriens fuyant la guerre. Ceci en contrepartie du
versement d'une aide de six milliards d'euros destinés à améliorer les
conditions de vie des quelque 3,6 millions de réfugiés qu'elle
accueille.
Depuis lors, Ankara a été régulièrement accusé d'exercer contre
l'Europe un chantage aux migrants.
L'Union européenne a finalement alloué jeudi à Ankara la totalité des
six milliards d'euros promis. (AFP, 18 déc
2020)
Des
sanctions symboliques contre la Turquie en
marchant sur des œufs
Philippe Regnier, Le Soir, 11 déc 2012
C’était un autre gros morceau, coriace, au menu du sommet des chefs
d’Etat de l’UE : la Turquie. Et l’affaire n’a pas été simple, sur ce
front-là non plus. Un front délicat, s’agissant de ce grand voisin
turbulent, membre de l’Otan, hôte de millions de réfugiés syriens et
candidat (de plus en plus théorique) à l’adhésion à l’UE. La discussion
sur la Turquie n’a été tranchée qu’aux alentours d’1h du matin,
vendredi.
Les Vingt-Sept avaient décidé début octobre de décider en décembre.
Face au comportement de plus en plus irritant du voisin, aux «
provocations » en Méditerranée et son activisme militaire sur un nombre
croissant de fronts, une alternative était présentée à Ankara. Soit
engager un « agenda positif ». Soit en subir les conséquences.
L’Allemagne mais aussi le chef de la diplomatie de l’UE Borrell
allaient tâter le terrain, tenter une mission de bons offices.
Trois mois plus tard, le constat est dressé : « La Turquie (…) a durci
ses propos à l’encontre de l’UE (…) et des dirigeants européens. Les
activités unilatérales et provocatrices en Méditerranée orientale se
poursuivent ».
Des conséquences limitées
Conséquences ? Limitées, à ce stade.
Les divergences étaient profondes, entre « faucons » et tenants de
l’apaisement (et la Belgique au milieu). Le compromis ne renonce pas
aux sanctions. Elles restent symboliques et limitées, mais déjà
vivement dénoncées à Ankara. De nouveaux noms seront ajoutés à une
liste établie fin 2019 d’individus sanctionnés (gel des avoirs,
bannissement du territoire) pour les forages « non autorisés » en
Méditerranée orientale. Deux responsables de la société turque de
pétrole figurent déjà sur cette liste. Sans grand effet, visiblement.
La chancelière allemande, très « colombe » sur ce dossier, a jugé le
compromis « équilibré ». La Grèce, Chypre ou le président Macron
régulièrement insulté par son homologue turc espéraient davantage,
comme des sanctions économiques. Athènes proposait même d’imposer à cet
allié un embargo de l’UE… sur les armes. La piste avait été jugée
juridiquement bancale il y a un an. « Il faut envisager d’en discuter
dans le contexte Otan », a dit Merkel.
Un nouvel « état des lieux » est prévu au sommet de mars. « Nous visons
une approche par paliers », explique-t-on à l’UE. Les Européens
comptent « agir en coordination avec les Etats-Unis », qui haussent
finalement le ton (pour l’achat turc de missiles… russes). Biden
pourrait confirmer la tendance, tandis que son prédécesseur couvait les
incartades du président turc. Cela étant, la main tendue pour une
relation « mutuellement avantageuse » reste « valable ».
Macron se félicite que l'Europe
ait fait "preuve de fermeté" face à la
Turquie
Le président français Emmanuel Macron s'est félicité vendredi que
l'Union européenne ait "démontré sa capacité à faire preuve de fermeté"
face à la Turquie en adoptant des sanctions pour ses activités en
Méditerranée orientale.
"Nous avions donné une chance à la Turquie" en octobre, mais "nous
avons unanimement constaté que la Turquie avait poursuivi ses actions
provocatrices", a déclaré le président français à la fin d'un sommet
européen à Bruxelles.
Les 27 ont surmonté jeudi en fin de soirée leurs divisions pour décider
le principe de sanctions individuelles - une liste de noms de
responsables turcs va être établie -, et des mesures supplémentaires
(ajout de nouveaux noms, d'entreprises) pourraient être décidées en
mars lors d'un nouveau point d'étape, si la Turquie poursuivait ses
actions.
"L'ensemble des chefs d'Etat et de gouvernement ont acté ces sanctions,
ce qui a d'ailleurs été immédiatement compris par nos amis turcs, qui
ont réagi dès ce matin", a souligné Emmanuel Macron.
Ankara a qualifié de "biaisée et illégitime" l'attitude de l'UE.
"L'Europe reste évidemment toujours ouverte au dialogue" avec la
Turquie, a souligné le président français.
"Il y a six mois, on disait: la France est toute seule" sur ce dossier,
a-t-il rappelé, en se félicitant que le "travail de conviction" de
Paris soit désormais "mieux compris" car "ce processus est le seul à
mettre suffisamment de pression sur la Turquie". "On a raison parfois
d'être clairs et vocaux quand les comportements sont inacceptables",
a-t-il estimé.
Emmanuel Macron a de nouveau dénoncé les actions de la Turquie en
Libye, où elle "menace nos intérêts sur le plan migratoire puisqu'elle
ne permet pas un bon contrôle des côtes et en introduisant des
jihadistes sur une zone de départ vers l'Europe". "La Turquie continue
d'avoir des actions unilatérales non conformes en Syrie (...) qui nous
font courir le risque de la reconstitution d'un califat", a-t-il
ajouté, en dénonçant aussi ses actions au Caucase.
Depuis des mois, les tensions se sont exacerbées entre Emmanuel Macron
et son homologue Recep Tayyip Erdogan, qui a notamment mis en cause la
"santé mentale" du président français en octobre. (AFP, 11 déc
2020)
Erdogan
dit espérer voir la France "se débarrasser" de
Macron
Le chef d'État turc Recep Tayyip Erdogan a
émis vendredi l'espoir de voir la France "se débarrasser le plus tôt
possible" du président Emmanuel Macron, sur fond de fortes tensions
entre les deux pays au sujet de nombreux dossiers.
"Macron est un problème pour la France. Avec Macron, la France vit une
période très dangereuse. J'espère que la France va se débarrasser du
problème Macron le plus tôt possible", a déclaré M. Erdogan à des
journalistes à Istanbul après avoir participé à la prière du vendredi
dans l'ex-cathédrale Sainte-Sophie transformée en mosquée en juillet.
"Sinon, ils (les Français) n'en finiront pas avec le gilets jaunes, qui
pourraient devenir des gilets rouges", a-t-il ajouté en référence au
mouvement de protestation de fin 2018 en France.
Au cours d'un long entretien au média en ligne Brut vendredi, le
président Macron, interrogé sur ces propos, a plaidé pour le "respect":
"nos sociétés sont de plus en plus violentes, elles le sont aussi parce
que les dirigeants ont donné un exemple de violence et donc je pense
que l'invective entre dirigeants politiques et n'est pas la bonne
méthode", a-t-il dit.
Les relations entre la Turquie et la France se sont progressivement
dégradées depuis l'an dernier, en raison notamment de désaccords sur la
Syrie, la Libye, la Méditerranée orientale et plus récemment le conflit
entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie au Nagorny Karabakh.
Mais les tensions ont été exacerbées en octobre lorsque M. Erdogan a
mis en cause la "santé mentale" de M. Macron, l'accusant de mener une
"campagne de haine" contre l'islam pour avoir défendu le droit de
caricaturer le prophète Mahomet et pour son discours contre le
"séparatisme" islamiste en France.
M. Erdogan a affirmé vendredi que la France, qui copréside le groupe
dit de Minsk chargé de favoriser un règlement au conflit entre
l'Azerbaïdjan et l'Arménie, avait "perdu son rôle de médiateur" après
que le Sénat et l'Assemblée nationale français ont adopté des
résolutions favorables à une reconnaissance du Nagorny Karabakh.
"Mon cher ami Aliev (le président azerbaïdjanais Ilham Aliev) a donné
un conseil aux Français leur disant que s'ils aiment tant les
Arméniens, ils n'ont qu'à leur donner Marseille. Moi aussi, je leur
donne le même conseil", a-t-il ajouté.
Dans une apparente allusion aux actions du gouvernement turc et à leurs
conséquences, M. Macron avait affirmé en septembre que "le peuple turc,
qui est un grand peuple, mérite autre chose".
Ankara avait vivement réagi à ces propos, qu'il a perçus comme une
tentative de dresser le peuple turc contre le président Erdogan.
La France agite depuis plusieurs semaines la menace de sanctions de
l'Union européenne contre la Turquie, notamment en raison des travaux
d'exploration gazière menés par Ankara en Méditerranée orientale dans
des zones maritimes disputées avec la Grèce et Chypre.
L'Union européenne a condamné vendredi la poursuite des "actes
unilatéraux" et la "rhétorique hostile" de la part de la Turquie, mais
elle reste divisée sur la manière de sanctionner ces comportements lors
du sommet européen du 10 décembre.
L'UE avait adressé en octobre une proposition d'ouverture à Ankara,
assortie d'une menace de sanctions si la Turquie ne cessait pas ses
actions déjà condamnées par l'UE.
Mais plusieurs États membres, dont l'Allemagne, sont opposés à
l'adoption de sanctions, selon des responsables européens. (AFP, 4 déc
2020)
L'UE condamne les actes hostiles
d'Ankara mais se divise sur les
sanctions
L'Union européenne a condamné vendredi la
poursuite des "actes unilatéraux" et la "rhétorique hostile" de la part
de la Turquie, mais reste divisée sur la manière de sanctionner ces
comportements lors du sommet européen du 10 décembre.
"Nous avons tendu la main à la Turquie en octobre. Depuis, les choses
n'ont pas été très positives. Nous avons vu qu'il y a eu des actes
unilatéraux et une rhétorique hostile. Nous aurons un débat lors du
sommet européen le 10 décembre et nous sommes prêts à utiliser les
moyens dont nous disposons lorsque nous constatons qu'il n'y a pas
d'évolution positive", a annoncé vendredi le président du Conseil
européen Charles Michel.
"Je pense que le jeu du chat et de la souris doit cesser", a-t-il
averti.
Mais Charles Michel n'a pas prononcé le mot de sanctions, car plusieurs
Etats membres, dont l'Allemagne, y sont opposés, ont confié à l'AFP un
ministre et plusieurs responsables européens.
"Le régime de sanctions, c'est une question qui relève des États
membres. Voyons ce que nous pouvons faire lors du prochain Conseil de
l'UE. Je ne peux pas avancer le résultat de la discussion, je ne fais
que la préparer et proposer des alternatives", a pour sa part précisé
le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell à Rome où il
participait à une réunion.
L'UE avait adressé en octobre une proposition d'ouverture à Ankara,
assortie d'une menace de sanctions si la Turquie ne cessait pas ses
actions déjà condamnées par l'UE. Décision avait été prise d'examiner
la situation lors du sommet de décembre.
"Si Ankara poursuit ses actions illégales, nous utiliserons tous les
instruments à notre disposition", avait averti Ursula von der Leyen,
présidente de la Commission européenne, lors du sommet en octobre.
L'exécutif européen a été chargé d'élaborer des sanctions économiques
et elles sont prêtes à être "utilisées immédiatement", avait-elle
précisé.
"Nous avons tendu la main, nous avons vu les réponses d'Ankara", a
déploré Charles Michel.
"Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de
signaux positifs de la part de la Turquie au cours de ces mois", a
confirmé Josep Borrell. "C'est l'une des situations les plus difficiles
que nous ayons à gérer", a-t-il confié.
Le comportement agressif d'Ankara et sa politique du fait accompli dans
plusieurs crises régionales, notamment en Libye et au Nagorny Karabakh,
ont été condamnés mardi par le secrétaire d'Etat américain sortant Mike
Pompeo lors de sa dernière réunion avec ses homologues de l'Otan. La
Turquie, membre de l'Alliance, a été invitée par les Etats-Unis à
"revenir à un comportement d'allié".
L'unanimité est requise au sein de l'UE pour le recours aux sanctions.
Or l'Allemagne a jusqu'à présent bloqué leur adoption dans l'espoir de
trouver un accord pour "développer une relation réellement constructive
avec la Turquie".
Le Parlement européen a déploré le chantage aux réfugiés et aux
migrants exercé par la Turquie sur les Etats membres.
La Turquie a accueilli sur son territoire près de 4 millions de Syriens
déplacés par le conflit dans leur pays et a menacé à plusieurs reprises
de "ne pas retenir ceux qui veulent partir" pour gagner l'Union
européenne.
"Il y aura des décisions lors du sommet européen (le 10 décembre), mais
leur ampleur n'a pas encore été décidée", ont assuré à l'AFP plusieurs
responsables européens. "Il faudra voir quelles positions vont adopter
l'Allemagne et la Pologne", a expliqué un ministre. (AFP, 4 déc
2020)
Turquie-USA-OTAN /
Turkey-USA-NATO

Les
bases du
terrorisme islamique ont été jetées en 1953 par le président Eisenhower
Doğan Özgüden
Artıgerçek, 12 novembre 2020
Il
est évident que la
victoire électorale du billet Biden-Harris a crée un grand soulagement
dans toutes les démocraties exaspérées par les pressions, les chantages
et les menaces de Trump. Toutefois, le président Tayyip Erdoğan, qui
grâce à lui a pu peaufiner
son dictat islamo-fasciste et prolonger sa conquête islamique, entamée
en Syrie, en Libye, en Méditerranée orientale et pour finir dans les
montagnes du Karabagh, se trouve avec tous ses complices d’intérêts en
état
de panique…
Comme Koray
Düzgören le précise dans son article du 11 novembre 2020 à Artigerçek,
«on voit clairement
qu’Erdoğan, qui jusqu’à présent n’a fondé ses relations aux États-Unis
qu’en fonction de Trump dans un contexte bilatéral, a cette fois misé
sur le mauvais cheval et que pour cette raison, c’est la panique au
palais. Certains mots, certains jugements qu’a pu avoir Biden avant
l’élection sur la Turquie et ceux qui la dirigent doivent causer des
insomnies à l’administration du palais.»
Les
résultats
des élections présidentielles américaines ont toujours eu, depuis la
fin de la Seconde Guerre mondiale, des effets importants du point de
vue des politiques intérieure et extérieure de la Turquie. De son
accession à la Maison-Blanche après la mort de Franklin Roosevelt en
1945 à 1952, Harry Truman a été au commandement de l’établissement de
l’hégémonie idéologique, économique, politique et militaire de
l’impérialisme américain non seulement sur l’Amérique latine, mais
aussi sur l’Europe, l’Afrique et les pays d’Asie. Il avait aussi
commencé à faire plier le gouvernement turc dirigé par İsmet Inönü en
renvoyant à Istanbul la dépouille de Münir Ertegün, ambassadeur turc
décédé à Washington, avec le plus grand navire de guerre de la flotte
américaine, le blindé Missouri.
Après quoi
il
avait lancé la doctrine Truman qui prévoyait la lutte à tout prix
contre l’URSS, qui avait joué le plus grand rôle dans l’écrasement du
nazisme, et les pays socialistes alliés, et avec l’application de cette
doctrine la Turquie, comme nombre d’autres pays, s’était retrouvée en
1947 complètement dépendante des États-Unis en échange d’une aide de
100 millions de dollars dans le cadre du Plan Marshall.
Après la
guerre, il fut mis fin au régime de parti unique et l’on passa au
soi-disant multipartisme, mais avec la mobilisation anti-communiste
initiée par les États-Unis, on ferma immédiatement par l’état d’urgence
les partis et syndicats de gauche qui s’étaient formés et on emprisonna
les intellectuels pacifistes de gauche dans le cadre des arrestations
des membres du Parti communiste de Turquie.
Au même
moment,
avec l’intégration de la Turquie dans l’OTAN en contrepartie de l’envoi
d’une brigade de 4500 hommes en Corée, la soumission à l’impérialisme
américain du pays au niveau militaire devenait complète.
Le mandat
de
Truman, qui avait appliqué avec succès sa doctrine éponyme pendant huit
ans, ayant pris fin, l’élection de 1952 fit entrer à la Maison-Blanche
un président qui allait mettre l’islam au premier plan pour parfaire
l’hégémonie des États-Unis dans le monde : le général Dwight Eisenhower
qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, avait commandé les armées
alliées d’Europe occidentale, et qui commandait l’OTAN depuis 1951.
Le premier
grand geste anti-communiste de ce fameux général à la Maison-Blanche
fut de rejeter d’un revers de la main la pétition qui appelait à
renoncer à l’exécution d’Ethel et Julius Rosenberg, scientifiques
condamnés à la peine capitale à la suite de l’accusation qu’ils
auraient transmis à l’Union soviétique des informations sur l’armement
nucléaire américain. Les Rosenberg, malgré toutes les protestations,
moururent sur la chaise électrique à la prison de Sing-Sing le 19 juin
1953.
Au début de
l’année 1953, quand Eisenhower entra comme président à la
Maison-Blanche, j’avais commencé à travailler au seul quotidien d’Izmir
s’opposant au gouvernement du Parti démocrate, le journal Sabah
Postası. C’était une époque où je me cherchais.
Le 2 juin
1952,
en Angleterre, après que le fameux général était devenu président des
États-Unis, la jeune princesse Elizabeth II passait à la tête de
l’empire « sur lequel le soleil ne se couche jamais » lors d’une
cérémonie fastueuse à l’abbaye de Westminster, dopant ainsi l’image
dans les médias du monde entier des deux pays en tête de la
mobilisation anti-communiste.
Je
n’oublierai
jamais, les services de presse des États-Unis ou d’Angleterre en
Turquie à
cette époque étaient tellement maîtres de leur art que presque chaque
jour nous parvenaient, à nous, journalistes d’Anatolie se débattant
dans mille et un problèmes d’ordre matériel, des dizaines de clichés
métallique ou plastique de photographies de propagande toutes prêts à
être
utilisées. Le seule chose qu’un rédacteur de journal pouvait faire,
c’était d’utiliser ces clichés gratuits.
La seule
solution pour se protéger ne serait-ce qu’un peu de ce lavage de
cerveau officié par deux États impérialistes, c’était de suivre les
informations sur les radios de Moscou, Budapest ou Sofia, et diffuser
d’une manière aussi impartiale que possible les nouvelles du monde à
partir des éléments obtenus de cette manière.
Au lycée de
commerce, j’avais très bien appris la sténographie, qui me permettait
de prendre des notes à la vitesse de la parole, et pour cette raison
c’est moi qui transmettais à la rédaction les informations et
commentaires importants donnés par ces radios après les avoir mis sur
le papier.
Début mars
1953, j’étais comme chaque soir en train d’essayer de trouver des
informations en écoutant les émissions en turc des radios étrangères,
quand la BBC et La Voix
de l’Amérique s’étaient mises à diffuser une nouvelle de dernière
minute difficile à croire : le leader de l’URSS, Joseph Staline, était
mort…
L’opinion
avait
été tellement modelée par la propagande anti-communiste et
antisoviétique exacerbée par la dépendance aux États-Unis que les gens
semblaient croire que Staline disparu, l’Union soviétique allait
rapidement s’effondrer, les peuples des pays socialistes rapidement
retrouver la liberté, et surtout que la Turquie allait être débarrassée
du danger du communiste qui menaçait « l’intégrité indivisible de la
patrie ».
Quant aux
antennes turques de Radio Moscou et des radios des autres pays
socialistes, elles se contentaient de diffuser l’unique
communique officiel qui disait, si je me rappelle bien, que Staline, «
successeur de Lénine, chef du Parti communiste et et enseignant du
peuple soviétique », venait de succomber à une grave maladie.
Et quelques
jours plus tard, les noms de Malenkov et Boulganine allaient être
révélés comme ceux des nouveaux leaders de l’Union soviétique, et le
pays allait continuer à être la force principale face à l’impérialisme
américain pendant l’époque de la guerre froide.
En réponse,
dans l’Amérique d’Eisenhower, l’hystérie anti-communiste allait se
renforcer, et les maccarthistes allaient interroger par millions des
citoyens américains communistes ou sympathisants, la plupart devant
être emprisonnés, torturés et privés de travail. Les cibles de ce
terrorisme, y compris Charlie Chaplin dont les films nous avaient tant
fait rire dans notre enfance, allaient être forcés de quitter les
États-Unis.
Une autre
des
opérations les plus frappantes de l’époque Eisenhower fut le
renversement par un Coup d’État soutenu par la CIA du président
Mossadegh, qui avait décidé de nationaliser le pétrole d’Iran.
En Turquie,
le
procès des arrestations d’intellectuels et d’ouvriers communistes en
1951 allait se solder le 7 octobre 1954 par cent quatre-vingt-quatre
condamnations.
Après son
entrée dans l’OTAN, la deuxième étape importante dans le renforcement
du contrôle de l’impérialisme américain sur la Turquie fut, le 24
février 1955 et sur l’insistance d’Eisenhower, la signature par le
gouvernement Menderes de sa participation, aux côtés de l’Iran, de
l’Irak, du Pakistan et de l’Angleterre, au Pacte de Bagdad.
À cette
époque,
un autre événement honteux pour l’histoire récente de la Turquie fut
l’opposition du même gouvernement à suivre une politique impartiale
indépendante du monde occidental en se comportant comme le cinquième
bras des États-Unis dans la Conférence de Bandung qui fonda le 17 avril
1955 le mouvement des Pays non-alignés.
La seule
nouvelle enthousiasmante dans cet environnement qui chaque jour
s’exacerbait encore plus sous la conduite de l’impérialisme américain
fut, telle que nous l’avons apprise cette fois encore par les radios
des États socialistes, l’attaque des guérilleros menés par Fidel Castro
le 26 juillet 1953 contre la caserne de Moncada de Cuba, qui se
trouvait alors sous le dictat du fasciste Batista… Il est vrai qu’une
partie des guérilléros avaient trouvé la mort, qu’une partie, parmi
lesquels Castro, avaient été condamnés à la prison, mais le Mouvement
du 26 juillet qui allait être fondé par la suite allait étendre sa
guérilla à toute l’île et renverser la dictature de Batista le 12
janvier 1959.
Le début de
l’utilisation de l’islam pour renforcer le contrôle de l’impérialisme
américain sur la Turquie se produit après le vote de la fameuse
doctrine Eisenhower, le 30 janvier 1957 à la chambre des représentants,
puis le 5 mars de la même année au sénat après qu’elle avait été
annoncée le 5 janvier par le président américain.
Après que
les
nouveaux régimes, en particulier en Égypte et en Syrie, eurent pris
position contre l’impérialisme anglo-américain, qu’ils eurent noué des
relations avec l’Union soviétique et les autres pays socialistes, et
particulièrement avec la nationalisation du canal de Suez le 26 juillet
1956 par le président Nasser, Eisenhower avait décidé que la seule
solution pour protéger les intérêts américains au Moyen-Orient était de
politiser l’islam.
La doctrine
Eisenhower prévoyait une aide économique et militaire aux pays
musulmans du Moyen-Orient et l’envoi de forces armées américaines en
cas d’attaque armée contre ces pays de n’importe quel État « se
trouvant sous le contrôle du communisme international ».
En faisant
passer à la chambre des représentants et au sénat cette doctrine
portant son nom, puis en recevant à la Maison-Blanche le roi Saoud ben
Abdelaziz Al Saoud, Eisenhower mettait sous garantie l’allégeance de
l’Arabie Saoudite à l’impérialisme américain.
Le 7
janvier
1957, l’Union soviétique réagissait à la Doctrine Eisenhower dans un
communiqué officiel : « La mise en captivité de ces pays du
Moyen-Orient est guidée par un principe de précaution, c’est une
ingérence grossière dans les affaires du Moyen-Orient par les cercles
militaristes du capitalisme monopolistique américain. »
Quant aux
pays
musulmans du Moyen-Orient, il n’y en eut pas un, à part l’Égypte et la
Syrie, pour réagir face à la doctrine Eisenhower.
En Turquie,
le
gouvernement du Parti démocrate l’adopta comme une continuation de la
doctrine Truman de 1947. Le premier ministre Adnan Menderes, qui avait
dit
lors d’une conférence de presse que les États-Unis étaient « la seule
force pouvant empêcher l’avancée des soviétiques au Moyen-Orient »,
publia un communiqué commun, le 21 mars 1957 avec des officiels
américains à Ankara, où il répétait comme un perroquet les principes de
la doctrine Eisenhower.
Le CHP,
alors
dans l’opposition, ne fut pas en reste en déclarant qu’il soutenait la
doctrine.
C’est avec
la
mise en application de cette doctrine que de jeunes Turcs furent
envoyés en Arabie Saoudite pour y devenir des militants des Frères
musulmans.
À leur
retour
en Turquie dans les années 60, ils se regroupèrent dans les
Associations pour la diffusion de la science,
les Instituts islamiques, les écoles imam hatip, les cours de Coran,
les Associations de lutte contre le communisme, l’Union nationale des
étudiants turcs, le Croissant vert, l’association Hademe-i Hayrat, et,
parmi eux, Necmeddin Erbakan s’éleva jusqu’à la position de secrétaire
général de l’Union des chambres de Turquie, puis à celle de
vice-président de la coalition CHP-MSP dans la période de
pseudo-ouverture démocratique qui suivit le coup d’État de 1971.
Lors du
Dimanche sanglant de 1969, ceux qui avaient grandi sous l’aile des
possibilités offertes par la doctrine Eisenhower n’hésitèrent pas, pour
payer leur dette de reconnaissance à l’impérialisme américain, à
attaquer bassement et à verser le sang des ouvriers et étudiants qui
protestaient contre l’amarrage de la 6e flotte américaine dans le
Bosphore.
Oui, à la
base
de l’escalade de ce terrorisme islamique et de ses méfaits dans le
monde entier dans les années 2000, il y a cette doctrine Eisenhower qui
porte le nom du président américain élu lors de l’hiver 1953 et qu’il a
fait accepter en 1957 aux pays musulmans, dont la Turquie.
Erdoğan et
ses
comparses, qui s’efforcent de faire accepter en Turquie le fascisme
islamique en tant qu’ordre étatique, qui mobilisent l’armée turque pour
une conquête islamique sur trois continents et qui, à la moindre
occasion, affichent leur appartenance en faisant le signe du Rabia des
Frères musulmans,
sont le produit de la doctrine Eisenhower…
(Traduit
par Sylvain Cavaillès)
Pompeo
cherche à calmer le jeu avec Ankara après les
sanctions
Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a assuré à son
homologue turc Mevlut Cavusoglu que les sanctions américaines imposées
lundi à Ankara pour son acquisition du système de défense aérienne
russe S-400, n'étaient pas destinée à affaiblir la défense turque.
Au cours d'un entretien cette semaine avec le ministre turc des
Affaires étrangères, M. Pompeo a "souligné que l'objectif des sanctions
était d'empêcher la Russie de recevoir des revenus, un accès et une
influence substantiels" aux systèmes de défense turcs, a indiqué jeudi
son porte-parole Cale Brown.
Les sanctions "ne sont pas destinées à affaiblir les capacités
militaire ou le niveau de préparation au combat de la Turquie ou
d'autres alliés ou partenaires des Etats-Unis", a ajouté le
porte-parole.
Le secrétaire d'Etat américain a aussi "appelé la Turquie à régler le
problème des S-400 d'une façon conforme aux décennies de coopération de
défense entre nos pays et à revenir à ses obligations de membre de
l'Otan pour acheter des armements compatibles avec ceux de l'Otan",
a-t-il conclu.
Les Etats-Unis avaient annoncé lundi des sanctions contre la Turquie
pour son acquisition du S-400, interdisant désormais l'attribution de
tout nouveau permis d'exportation d'armes à l'agence gouvernementale
turque en charge des achats d'armement, le SSB.
La décision prévoyait aussi des sanctions contre le président du SSB,
Ismail Demir, ainsi que d'autres dirigeants de cette agence.
Le président Recep Tayyip Erdogan a dénoncé ces sanctions mercredi.
"De quel type d'alliance s'agit-il? Cette décision est une attaque
ouverte contre notre souveraineté", s'est-il indigné.
"C'est un prétexte. Le vrai but est de stopper l'élan de notre pays
dans l'industrie de la défense et de nous rendre de nouveau
complètement dépendants". (AFP, 18 déc
2020)
Washington sanctionne la Turquie pour l'achat de
missiles russes
Après des mois d'atermoiements, les États-Unis ont annoncé lundi des
sanctions à la Turquie pour son acquisition du système de défense
aérienne russe S-400, tout en laissant la porte ouverte au dialogue
avec Ankara.
Washington interdit désormais l'attribution de tout nouveau permis
d'exportation d'armes à l'agence gouvernementale turque responsable des
achats d'armement, le SSB, et interdit le territoire américain à ses
dirigeants, a annoncé le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo.
"Les mesures prises aujourd'hui signalent clairement que les États-Unis
[...] ne toléreront pas de transactions significatives avec les
secteurs russes de la défense et du renseignement", a précisé le
secrétaire d'État dans un communiqué.
Washington a invoqué une loi de 2017 qui vise à "contrer les
adversaires de l'Amérique à travers les sanctions" (Caatsa) et qui
prévoit notamment des sanctions automatiques dès lors qu'un pays
conclut une "transaction significative" avec le secteur de l'armement
russe.
La menace de sanctions américaines planait sur la Turquie depuis
qu'elle a pris livraison de ces missiles l'an dernier, mais le
président Donald Trump, qui entretient de bons rapports personnels avec
M. Erdogan, s'était abstenu jusqu'ici de les déclencher.
Or, le Congrès a approuvé vendredi à une large majorité la loi de
financement du Pentagone qui contient une mesure donnant 30 jours à
l'exécutif pour sanctionner Ankara pour les S-400, des missiles
incompatibles avec les systèmes de l'OTAN, dont la Turquie est membre.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait pris les devants en
affirmant vendredi que des sanctions américaines contre son pays
seraient "un manque de respect de la part des États-Unis envers son
allié très important au sein de l'OTAN".
"La Turquie a pourtant décidé de procéder à l'achat des S-400 et de les
tester, bien qu'il existe des solutions de rechange compatibles avec
les systèmes de l'OTAN pour répondre à ses besoins de défense", a-t-il
ajouté.
En réaction à la livraison de la première batterie l'été dernier, les
États-Unis ont suspendu la participation de la Turquie au programme de
construction de l'avion de guerre américain dernier cri F-35, car ils
estimaient que les S-400 pourraient en percer les secrets
technologiques.
Washington a toutefois laissé la porte ouverte au dialogue avec la
Turquie.
"Nous regrettons beaucoup que cela ait été nécessaire et nous espérons
vraiment que la Turquie va coopérer avec nous pour régler le problème
du S-400", a indiqué à la presse le secrétaire d'État adjoint chargé de
la sécurité internationale et la prolifération, Christopher Ford.
Ankara et Moscou dénoncent les sanctions
"Nous invitons les États-Unis à revoir cette décision injuste de
sanctions [...] et nous réaffirmons être prêts à traiter la question
par la voie du dialogue et de la diplomatie, conformément à l'esprit de
l'alliance", a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères.
"Il s'agit d'une nouvelle manifestation d'une attitude arrogante à
l'égard du droit international, une manifestation des mesures
coercitives unilatérales et illégitimes que les États-Unis utilisent
depuis de nombreuses années, depuis des décennies à droite et à
gauche", a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï
Lavrov.
Le président de la commission des Affaires étrangères du Sénat des
États-Unis, le républicain Jim Risch, s'est félicité de l'annonce de
l'exécutif.
"La Turquie a eu largement le temps et l'occasion d'abandonner son
achat russe", a-t-il noté. "Ces sanctions, de même que l'exclusion de
la Turquie du programme du F-35, sont le résultat inévitable de la
décision du président Erdogan de faire passer ses relations avec le
Kremlin avant celles avec l'OTAN."
L'UE a adopté vendredi le principe de sanctions contre la Turquie pour
ses explorations gazières controversées en Méditerranée orientale et
ses démonstrations de force dans des eaux disputées avec la Grèce et
Chypre. (AFP,
15 décembre 2020)
S-400: des sanctions américaines contre la Turquie
seraient "un manque
de respect"
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé vendredi que des
sanctions américaines contre son pays en lien avec l'acquisition d'un
système de missiles russe seraient "un manque de respect", à la suite
d'informations de presse sur l'imminence d'une telle mesure.
"Sous l'administration Obama comme sous celle de Trump, on
s'enorgueillissait d'avoir un membre de l'Otan comme la Turquie.
Soumettre la Turquie à des sanctions serait un manque de respect de la
part des Etats-Unis envers son allié très important au sein de l'Otan",
a déclaré le chef de l'Etat turc, cité par les médias, lors d'une
interview à bord de l'avion le ramenant d'une visite en Azerbaïdjan.
L'achat par Ankara du système de défense aérienne russe S-400 avait
envenimé les relations avec Washington ces dernières années.
Les Etats-Unis font valoir que ces missiles sont incompatibles avec les
systèmes de défense de l'Otan, l'Alliance atlantique, dont Ankara est
membre avec Washington.
Le menace de sanctions américaines plane sur la Turquie depuis qu'elle
a pris livraison de ces missiles mais le président Donald Trump, qui
entretient de bons rapports personnels avec M. Erdogan, s'est abstenu
jusqu'ici de les déclencher.
Pourtant, les mesures punitives d'ordre économique sont inscrites dans
une loi adoptée en 2017 par le Congrès, quasiment à l'unanimité, pour
"contrer les adversaires de l'Amérique à travers les sanctions"
(Caatsa).
Des médias américains, dont le Washington Post, ont affirmé jeudi que
l'administration américaine devrait finalement annoncer des sanctions
contre la Turquie dans les prochains jours.
"Je ne sais pas dans quelle direction les choses vont aller avant que
M. Trump quitte la Maison Blanche, mais pendant les quatre années de
son mandat je n'ai pas eu de souci pour communiquer avec les
Etats-Unis", a ajouté M. Erdogan.
Le président turc a en outre dit espérer voir les relations
turco-américaines s'améliorer sous la présidence de Joe Biden, faisant
valoir les liens qu'il avait noués avec ce dernier du temps où il était
vice-président de Barack Obama.
"M. Biden m'a rendu visite chez moi lorsque j'étais malade. Il me
connaît bien et je le connais bien aussi", a-t-il déclaré.
A la suite des informations sur de possibles sanctions américaines, qui
s'ajoutaient à celles décidées jeudi par l'Union européenne en lien
avec les activités de la Turquie en Méditerranée orientale, la livre
turque, en chute libre ces derniers mois, a encore perdu de sa valeur
vendredi.
La monnaie turque s'échangeait à 8.02 TRY contre un dollar à 11H00 GMT,
enregistrant une baisse de 1% depuis le début de la journée. (AFP, 11 déc
2020)
Lâchée par les Etats-Unis, la Turquie sur la
sellette à l'Otan
La Turquie a été soumise à un feu de
critiques lors de la réunion virtuelle des ministres des Affaires
étrangères de l'Otan et, lâchée par les Etats-Unis, doit se préparer à
subir une vague de sanctions économiques américaines et européennes,
ont affirmé mercredi à l'AFP plusieurs participants.
La surprise est venue du secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, qui a
dénoncé "les manquements" aux règles de l'Alliance et "la politique du
fait accompli" menée par Ankara dans plusieurs crises régionales.
Pompeo a été "très cash" pour sa dernière réunion à l'Otan en demandant
à la Turquie de "revenir à un comportement d'allié", a raconté un
participant. "Son intervention a été très courte, mais très claire", a
précisé un autre.
Le secrétaire d'Etat américain a dénoncé "le cadeau" fait par Ankara à
la Russie avec l'achat du système de défense anti-missile mobile S400
"non inter-opérable avec les systèmes de l'Otan".
Il a également déploré la "prise en otage" des plans de défense
et des partenariats envisagés par l'Otan, une attitude qui "affaiblit
la cohésion de l'Alliance".
Toutes les décisions doivent être prises à l'unanimité au sein de
l'Alliance.
Les agissements turcs avaient été dénoncés lors du sommet de Londres en
2019 par le chef de l'Etat français Emmanuel Macron, mais le président
Donald Trump avait protégé et défendu le président Recep Tayyip Erdogan.
Le secrétaire d'Etat américain avait jugé les actions de la Turquie
"très agressives" lors de sa rencontre avec le président français le 16
novembre à Paris.
Mais le compte rendu de son intervention par ses services
mercredi n'a fait aucune mention de ses prises de position contre
Ankara.
Interrogé par l'AFP, un porte-parole américain s'est refusé à
démentir ou confirmer les déclarations d'une réunion à huis clos.
Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu était
visiblement "mal à l'aise", a confié un des participants.
Emmanuel Macron s'est entretenu au téléphone avec Jens Stoltenberg
après cette réunion. "L'échange a été l'occasion d'aborder directement
et en confiance les préoccupations exprimées par un nombre croissant
d'alliés sur les choix stratégiques faits par la Turquie, qui
nécessitent une clarification par une explication franche au sein de
l'Alliance dans le nouveau contexte trasatlantique" avec le président
Joe Biden, a indiqué l'Elysée dans un communiqué.
La sévérité de l'intervention de Mike Pompeo au cours de la
vidéo-conférence a "désinhibé" les autres participants, et pour la
première fois des accusations en règle ont été portées contre Ankara.
"La Turquie est enfin perçue comme un problème pour l'Alliance, ce qui
été nié jusqu'à présent, et il va falloir le régler", a commenté un
responsable de l'Alliance.
- Le problème turc -
Le chef de la diplomatie du Luxembourg, Jean Asselborn a ainsi
"regretté qu'un État allié, la Turquie, ait été directement impliqué
dans le conflit du Nagorny Karabakh en facilitant l'implication de
mercenaires en Syrie".
"Nous avons insisté sur nos positions concernant le Haut-Karabakh, la
Méditerranée orientale, la Libye et l'intervention illégale contre
notre navire", a soutenu le ministre turc sur son compte twitter.
Une frégate de la marine allemande engagée dans la mission européenne
Irini a arraisonné le 20 novembre un navire turc soupçonné de violer
l'embargo sur les armes en Libye décrété par les Nations unies.
Plusieurs délégations ont jugé que le moment était venu de sanctionner
les agissements de la Turquie.
Les Etats-Unis ont approuvé des mesures économiques après l'achat du
système de défense russe. Bloquées par Donald Trump, elles devraient
entrer en vigueur mécaniquement avec l'arrivée de l'administration du
président Joe Biden, a-t-on expliqué.
Le Canada a pour sa part suspendu les exportations de composants
électroniques utilisées par le drone de combat turc TB2 utilisé en
soutien des forces de l'Azerbaïdjan durant le conflit au Nagorny
Karabakh.
Les Européens doivent décider lors d'un sommet le 10 décembre si de
nouvelles mesures doivent être adoptées contre le comportement d'Ankara
en Méditerranée orientale et les violations de l'embargo des Nations
unies sur les livraisons d'armes à la Libye.
La Commission européenne a préparé un train d'options comprenant
notamment des sanctions économiques sectorielles, prêtes à être
utilisées.
L'unanimité est requise pour leur utilisation et l'Allemagne a jusqu'à
présent bloqué leur adoption dans l'espoir de trouver un accord pour
"développer une relation réellement constructive avec la Turquie".
"Il y aura des décisions lors du sommet, mais leur ampleur n'a pas
encore été décidée", ont assuré à l'AFP plusieurs responsables
européens. "Il faudra voir quelles positions vont adopter l'Allemagne
et la Pologne", a expliqué un ministre. (AFP, 2 déc
2020)
Relations
régionales / Regional Relations
Libye: Haftar appelle à reprendre
les armes pour "chasser l'occupant" turc
Le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est de la Libye, a appelé
ses forces à reprendre les armes pour "chasser l'occupant" turc, au
moment où des pourparlers sont en cours pour sortir le pays de
l'impasse.
La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute du régime de
Mouammar Kadhafi en 2011, et deux autorités s'y disputent le pouvoir:
le Gouvernement d'union nationale (GNA) à Tripoli, reconnu par l'ONU et
soutenu par la Turquie, et un pouvoir incarné par Khalifa Haftar,
soutenu par la Russie et les Emirats arabes unis.
Le soutien turc au GNA, notamment par l'envoi de conseillers militaires
et de drones, lui a permis d'infliger une série de défaites aux portes
de Tripoli aux forces du maréchal.
"Nous devons rappeler aujourd'hui qu'il n'y aura pas de paix en
présence d'un colonisateur sur notre terre", a lancé jeudi le maréchal
en référence à Ankara, dont le Parlement a adopté cette semaine une
motion prolongeant de 18 mois l'autorisation de déployer des militaires
en Libye.
"Nous allons donc reprendre les armes pour façonner notre paix de nos
propres mains (...) et, puisque la Turquie rejette la paix et opte pour
la guerre, préparez-vous à chasser l'occupant par la foi, la volonté et
les armes", a-t-il dit dans un discours à l'occasion du 69e
anniversaire de l'indépendance du pays.
"Officiers et soldats, préparez-vous!", a-t-il martelé devant des
centaines de militaires au garde-à-vous dans la cour d'une caserne à
Benghazi (est).
Au même moment, le chef du GNA, Fayez al-Sarraj, appelait depuis
Tripoli ses compatriotes à "tourner la page des désaccords pour aboutir
à la stabilité".
Cela ne se fera que par "la solidarité entre forces politiques", a-t-il
dit.
Le chef du GNA s'est félicité des conclusions des pourparlers engagés
sous l'égide des Nations unies, notamment l'organisation d'élections le
24 décembre 2021, "une opportunité historique qu'il ne faut pas laisser
passer".
Un cessez-le-feu signé en octobre sous l'égide de l'ONU et globalement
respecté depuis a permis aux parties rivales de retourner à la table
des négociations. (AFP, 25 déc 2020)
Au Maghreb, Ankara accroît son
influence malgré des résistances
Le Maghreb fait l'objet d'une attention particulière de la part de la
Turquie, qui y renforce son influence, selon des analystes. Mais des
oppositions existent, bridant la stratégie volontariste d'Ankara.
Exportations en hausse, activisme diplomatique... la Turquie est
parvenue à renforcer son ancrage au Maghreb, en phase avec la politique
étrangère revendiquée par le président Recep Tayyip Erdogan, malgré un
contexte de difficultés économiques internes.
Son influence y est "en forte croissance depuis quelques années même si
la communication ne s'affiche pas toujours", dit Pierre Vermeren,
historien spécialiste de la région.
La Turquie mène une "stratégie d'ouverture vers l'Afrique", ajoute Ali
Bakeer, analyste politique turc.
Le Maghreb fait office de tête de pont.
"Ce n'est pas chose nouvelle mais les développements régionaux et
internationaux actuels semblent offrir des opportunités", ajoute M.
Bakeer.
Politico-militaire en Libye, la stratégie d'influence turque est
commerciale et/ou politique en Algérie, en Tunisie et au Maroc, aire
démographique qui approche les 100 millions d'habitants.
En Libye, Ankara s'est imposée comme le principal soutien du
gouvernement de Tripoli (GNA), reconnu par l'ONU, face au camp de l'Est
incarné par Khalifa Haftar et soutenu par les Emirats arabes unis,
l'Egypte et la Russie.
L'influence turque dans ce pays en proie au chaos est une "réalité
militaire extrêmement importante", observe Jalel Harchaoui, chercheur à
l'institut néerlandais Clingendael.
"La Turquie possède la plus grande base militaire à la frontière
tunisienne, une base navale et des camps de mercenaires syriens",
précise-t-il.
Elle s'est renforcée après l'échec de l'offensive sur Tripoli lancée en
2019 par Khalifa Haftar, au cours de laquelle le soutien d'Ankara a été
déterminant pour le GNA.
- "Avenue" libyenne -
"Les Emirats ont lancé une offensive car ils voulaient une hégémonie
totale. Ils ont creusé une avenue" dans laquelle la Turquie "s'est
engouffrée", dit M. Harchaoui.
Si Abou Dhabi --soutenu par Paris-- se présente comme un rempart contre
l'islam politique, la Turquie et son allié qatari sont réputés proches
des Frères musulmans --considérés comme "organisation terroriste" par
plusieurs pays arabes dont l'Egypte--, chacun essayant d'imposer son
projet régional.
Ankara s'appuie aussi sur un accord militaire signé il y a un an avec
Tripoli pour revendiquer un plateau continental étendu où la Turquie
mène des explorations gazières, au grand dam des autres pays de
Méditerranée orientale.
L'Union européenne l'a sanctionnée pour ces activités "agressives",
décision jugée "biaisée et illégitime" par Ankara.
En Libye, la Turquie "essaye de tirer parti de son investissement
militaire pour exercer une influence politique et économique", souligne
Emadeddin Badi, analyste à la Global Initiative.
En Tunisie voisine, l'influence turque se traduit surtout par une nette
hausse des importations, poussant des industriels à se plaindre de
cette concurrence de produits à bas prix. Un accord de libre-échange
signé en 2004 a été modifié et des taxes réintroduites en 2018.
Ces importations augmentent notamment dans le secteur
militaro-sécuritaire tunisien.
La présence turque est aussi indéniable en Algérie: Ankara est devenue
en 2017 le premier investisseur étranger --hors hydrocarbures--, aux
dépens de la France. Les deux pays ont convenu de porter leurs échanges
commerciaux à 4,1 milliards d'euros annuellement.
La Turquie est le troisième client de l'Algérie, derrière l'Italie et
la France. Plus de 1.200 entreprises turques y sont implantées, selon
Ankara.
M. Erdogan s'y est rendu début 2020, peu après une visite à Tunis.
La Turquie se montre aussi intéressée par la rénovation d'ouvrages
ottomans, comme la mosquée Ketchaoua d'Alger, en 2017.
- "Succès d'estime" -
Au Maroc, les échanges commerciaux sont déséquilibrés depuis l'accord
de libre-échange de 2006. Le déficit a atteint environ 1,6 milliard
d'euros en 2019, le textile marocain étant grandement touché.
"Les Turcs ont inondé le marché (...) et tué de nombreuses marques",
tempête un industriel local.
Ce déséquilibre a poussé Rabat à introduire des droits de douanes.
En quête de soutiens pour ses actions diplomatiques, notamment en
Libye, la Turquie fait dans ce domaine face à la tradition de
neutralité des trois pays.
Ses tentatives d'influencer la diplomatie tunisienne ont entraîné de
violents échanges au Parlement.
Au Maroc, l'unique visite officielle de M. Erdogan remonte à 2013. Il
était alors Premier ministre et n'avait pas été reçu par le roi
Mohammed VI, malgré l'insistance du Parti justice et développement
(PJD, islamiste) qui l'avait invité.
Dans ces pays, "toute une part de la jeunesse voit dans l'exemple turc
un modèle d'indépendance", explique M. Harchaoui, évoquant toutefois un
"mythe" car Erdogan ne se risque pas à critiquer la Chine ou la Russie.
"Après Nasser, Saddam, Arafat" entre autres, "il y a un autre
personnage méditerranéen qui insulte l'Europe, se présente en défenseur
des musulmans", relève Pierre Vermeren.
"C'est un succès d'estime" mais "qui ne correspond pas à une influence
profonde", nuance-t-il, alors que l'islam politique paraît en perte de
vitesse dans la région. (AFP, 23 déc
2020)
Erdogan
exhorte Bagdad à agir contre le PKK, un
"ennemi
commun"
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé jeudi l'Irak à
intensifier le combat sur son territoire contre les miliciens kurdes du
PKK, lors d'une visite à Ankara du Premier ministre irakien Moustafa
al-Kazimi.
La Turquie mène régulièrement des raids aériens contre les bases
arrières du PKK dans les zones montagneuses du nord de l'Irak, où il a
aménagé des camps d'entraînement et des caches d'armes. Des forces
spéciales mènent parfois des incursions d'ampleur limitée.
Les opérations turques, dont la dernière en date a eu lieu en juin,
suscitent des tensions avec le gouvernement irakien, mais M. Erdogan
répété à l'envi que son pays entend "s'occuper" du PKK dans le nord de
l'Irak si Bagdad n'était "pas en mesure de le faire".
Le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui dispose de bases
arrière dans le nord de l'Irak, livre depuis 1984 une sanglante
guérilla sur le sol turc qui a fait plus de 40.000 morts. Il est classé
comme un groupe "terroriste" par la Turquie, les Etats-Unis et l'Union
européenne.
"Nous sommes convenus de poursuivre le combat contre nos ennemis
communs", a déclaré M. Erdogan lors d'une conférence de presse à Ankara
aux côtés de M. Kazimi, citant notamment le PKK mais aussi le groupe
Etat islamique (EI).
"Notre région ne connaîtra pas la paix tant que le terrorisme n'est pas
écrasé. Notre combat se poursuivra jusqu'à l'éradication des gangs
terroristes", a-t-il ajouté.
M. Kazimi, qui effectuait sa première visite à Ankara depuis sa prise
de fonctions en mai, a pour sa part affirmé que Bagdad "condamne toute
action portant atteinte à la Turquie ou partant du territoire irakien
pour attaquer la Turquie".
"Il ne sera permis à aucun groupe d'utiliser le territoire de l'Irak
pour menacer ses voisins", a-t-il affirmé. "Nous collaborons avec la
Turquie pour faire face à ces groupes, qu'il s'agisse de l'EI ou toute
autre organisation menaçant la sécurité régionale".
"Nous avons récemment pris des mesures importantes dans ce sens à
Sinjar (nord de l'Irak) et nous avons aussi empêché ces groupes de
pénétrer en Irak à travers la frontière avec la Syrie", a-t-il ajouté. (AFP, 17 déc
2020)
L'Iran
critique le président turc pour un poème
séparatiste "mal récité"
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a
critiqué vendredi le président turc Recep Tayyip Erdogan pour un poème
"mal récité" qui sous-entendrait que les provinces du nord-ouest de
l'Iran faisaient partie de la république d'Azerbaïdjan.
"Le président Erdogan n'a pas été informé que ce qu'il a mal récité à
Bakou se réfère à la séparation forcée des zones au nord d'Aras de la
métropole iranienne", a écrit M. Zarif sur Twitter.
L'Iran compte une importante population azérie, principalement dans les
provinces bordant le fleuve Aras et voisines de l'Azerbaïdjan et de
l'Arménie.
M. Erdogan s'est exprimé jeudi lors d'une visite en Azerbaïdjan pour
célébrer la récente victoire de ce pays turcophone du Caucase au
Nagorny Karabakh, face à l'Arménie qui a dû céder d'importants
territoires à cette enclave en territoire azerbaïdjanais disputée
depuis des décennies.
"N'a-t-il pas compris qu'il portait atteinte à la souveraineté de la
République d'Azerbaïdjan?", a ajouté M. Zarif. "PERSONNE ne peut parler
de NOTRE Azerbaïdjan bien-aimé."
Selon l'agence iranienne Isna, le poème récité est "l'un des symboles
séparatistes du panturkisme". Le texte parle d'Aras et "se plaint de la
distance séparant les personnes de langue azérie des deux côtés du
fleuve", ajoute Isna.
Le ministère des Affaires étrangères iranien a dit avoir convoqué
l'ambassadeur de Turquie au sujet des "remarques interventionnistes et
inacceptables" du président Erdogan, et exigé "une explication
immédiate".
Il a signifié à l'ambassadeur que "l'ère des revendications
territoriales et des empires bellicistes et expansionnistes était
révolue", selon un communiqué officiel. L'Iran "ne permet à personne de
s'immiscer dans son intégrité territoriale", affirme le texte. (AFP, 11 déc
2020)
Erdogan,
allié de Bakou dans le conflit au Karabakh, en
Azerbaïdjan le
9 décembre
Le président turc Recep Tayyip Erdogan,
dont le pays a été le principal soutien de Bakou dans son conflit avec
l'Arménie au Nagorny Karabakh, se rendra en Azerbaïdjan le 9 décembre,
a annoncé la présidence turque jeudi.
La visite de deux jours de M. Erdogan sera la première d'un chef d'Etat
étranger en Azerbaïdjan depuis le cessez-le-feu qui a mis fin début
novembre à six semaines de combats et consacré les importants gains
territoriaux de Bakou au Nagorny Karabakh.
Cette visite coïncidera avec une importante parade militaire que Bakou
prévoit d'organiser le 10 décembre.
Pour surveiller le respect de l'accord de cessez-le-feu parrainé par
Moscou et qui prévoit l'évacuation par les Arméniens de certaines zones
qu'ils contrôlent depuis 30 ans, la Russie a déployé une force de
"maintien de la paix" dans la région.
La Turquie a annoncé mardi avoir signé avec la Russie un accord sur
l'établissement d'un centre conjoint d'observation qui aura pour
mission de surveiller le cessez-le-feu au Nagorny Karabakh.
La Turquie, qui a pris fait et cause pour Bakou dans le conflit, avait
salué une "grande victoire" de l'Azerbaïdjan face à l'Arménie au
Nagorny Karabakh au lendemain de la signature de l'accord de fin des
hostilités.
L'Azerbaïdjan a annoncé jeudi la mort de 2.783 de ses soldats dans les
combats. Jusqu'ici, Bakou n'avait pas communiqué ses pertes militaires,
fournissant uniquement le bilan des victimes civiles azerbaïdjanaises
de ces hostilités. (AFP,
3 déc
2020)
L'Azerbaïdjan
hisse son drapeau à Latchin, troisième district
rétrocédé
par l'Arménie
Les soldats azerbaïdjanais
ont levé pour la première fois depuis presque 30 ans mardi leur drapeau
à Latchin, dernier des trois districts rétrocédés par l'Arménie en
vertu du cessez-le-feu ayant mis fin à six semaines de combats au
Nagorny Karabakh.
Peu après minuit, une colonne militaire azerbaïdjanaise est entrée dans
le district, qui était sous contrôle des forces arméniennes depuis une
guerre dans les années 1990 ayant fait des dizaines de milliers de
morts et des centaines de milliers de déplacés.
Des journalistes de l'AFP ont ensuite vu un groupe d'une dizaine de
soldats participer à une cérémonie dans la cour d'un bâtiment officiel
de la ville, au-dessus duquel a été hissé le drapeau azerbaïdjanais.
Le district de Latchin, comme celui d'Aghdam rendu le 20 novembre et
celui de Kalbajar rétrocédé le 25 novembre, formaient une zone tampon
entourant la république autoproclamée du Nagorny Karabakh, à majorité
arménienne.
Quatre autres districts ayant la même fonction avaient déjà été repris
par Bakou au cours des six semaines de combats meurtriers ayant éclaté
à l'automne. Tous échappaient au contrôle de l'Azerbaïdjan depuis la
fin de la guerre en 1994.
Courant le long de la frontière est de l'Arménie, du nord au sud
jusqu'à l'Iran, le district de Latchin est surtout connu pour le
corridor du même nom, contrôlé aujourd'hui par les soldats de la paix
russes, et devenu l'unique route reliant le Nagorny Karabakh à
l'Arménie.
- "Nouvelle réalité" -
Les habitants n'avaient pas attendu pour quitter les lieux, détruisant
et désossant leurs maisons. Certains ont cependant choisi de rester,
comme Levon Gevorguian, propriétaire d'une épicerie-bar sur la place
principale de Latchin.
"Cela fait 22 ans que je suis installé ici, je suis parti de zéro, j'ai
tout construit", raconte l'homme de 48 ans. "J'espère que je vais
pouvoir continuer", ajoute-t-il.
Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a lui salué mardi une "nouvelle
réalité", dans une adresse télévisée à la nation. "Nous avons chassé
l'ennemi de nos terres. Nous avons restauré l'intégrité territoriale.
Nous avons mis fin à l'occupation", s'est-il félicité.
Selon M. Aliev, environ 50.000 Azerbaïdjanais ont habité le district de
Latchin avant la guerre des années 1990 et ils vont y revenir "dans un
avenir proche".
A Bakou, la capitale, les rues étaient envahies d'habitants brandissant
le drapeau national pour célébrer la rétrocession de Latchin, selon un
journaliste de l'AFP.
A Erevan, la capitale arménienne, des dizaines de personnes ont
protesté contre de telles concessions arméniennes, en bloquant
brièvement des rues, alors que d'autres ont défilé en réclamant la
démission du Premier ministre Nikol Pachinian et en le qualifiant de
"traître".
- Statu quo "ambigu"-
Pour Olessia Vartanian, analyste pour l'International Crisis Group, la
remise de ce dernier district est la preuve que l'accord de
cessez-le-feu "fonctionne". Mais le nouveau statu quo n'est "pas
clair", prévient-elle.
"L'accord obtenu par Moscou est très précis en ce qui concerne la
rétrocession des territoires, mais il est ambigu sur un nombre
d'aspects comme le mandat des forces de paix russes et l'organisation
de la vie de la population locale, des Arméniens comme des
Azerbaïdjanais", a-t-elle déclaré à l'AFP.
Entre temps, beaucoup d'habitants du Nagorny Karabakh qui avaient fui
les récents combats ont commencé à se réinstaller dans la région
séparatiste. Mardi, l'armée russe a indiqué qu'elle avait jusqu'à
présent aidé au retour de plus de 26.000 personnes.
Le cessez-le-feu du 9 novembre, signé alors que la situation militaire
était catastrophique pour l'Arménie, consacre la victoire de
l'Azerbaïdjan et lui accorde d'importants gains territoriaux.
Il permet néanmoins la survie du Nagorny Karabakh, amoindri, et
voit le déploiement de 2.000 soldats russes de maintien de la paix.
Signé sous patronage russe, le cessez-le-feu a rappelé le rôle
déterminant de Moscou dans son pré carré caucasien mais aussi montré
l'influence grandissante de la Turquie, soutien de Bakou.
La Turquie a d'ailleurs annoncé mardi un accord avec la Russie
sur l'établissement d'un centre conjoint d'observation qui aura pour
mission de surveiller le cessez-le-feu au Nagorny Karabakh.
A l'inverse, les pays occidentaux semblent en perte de vitesse et ni la
France, ni les Etats-Unis, médiateurs en tant que membres du "groupe de
Minsk" chargé dans les années 1990 de trouver une issue durable à la
crise, n'ont obtenu de résultats probants. (AFP, 1 déc
2020)
Qu'est-ce qui attend le Nagorny
Karabakh ?
La remise de Latchin, le dernier des trois
districts rendus par Erevan à Bakou en vertu d'un accord de
cessez-le-feu au Nagorny Karabakh, a marqué mardi la fin du premier
stade du processus de paix, sous le patronage de Moscou.
Mais le conflit autour de la république autoproclamée du Nagorny
Karabakh, peuplée majoritairement d'Arméniens et qui a fait sécession
de l'Azerbaïdjan à l'issue d'une guerre dans les années 1990, est loin
d'être résolu.
Voici ce à quoi l'on pourrait s'attendre pour la suite:
- Retour à la maison -
L'Arménie s'est engagée à rétrocéder à l'Azerbaïdjan trois districts,
qui formaient une zone tampon entourant le Nagorny Karabakh, dans le
cadre d'un accord de cessez-le-feu signé le 9 novembre.
Le district de Latchin a été rétrocédé mardi, celui de Kalbajar a été
rendu le 25 novembre et celui d'Aghdam le 20 novembre.
Quatre autres districts dotés de la même fonction avaient déjà été
repris par Bakou au cours des six semaines de combats meurtriers qui
ont éclaté fin septembre.
Tous échappaient au contrôle de l'Azerbaïdjan depuis la fin de la
guerre en 1994.
Des dizaines de milliers d'Azerbaïdjanais, qui avaient dû quitter ces
zones il y a 30 ans, pourraient désormais y revenir, même si Bakou
estime qu'il faut d'abord y effectuer des opérations de déminage et
reconstruire des infrastructures.
Pour leur part, les séparatistes arméniens gardent toujours le
contrôle de la majorité du territoire du Nagorny Karabakh. Les
résidents de l'enclave qui ont fui les récents combats - jusqu'à 90.000
personnes au total, soit environ 60% de la population - commencent
aussi à revenir.
La Russie, qui a déployé environ 2.000 soldats de la paix au Nagorny
Karabakh, dit qu'elle a aidé à ce jour au retour de plus de 26.000
personnes.
- Cohabitation difficile -
Riche en pétrole, l'Azerbaïdjan a promis d'investir massivement dans la
reconstruction des districts revenus dans son giron.
Mais l'avenir du Nagorny Karabakh, qui dépend entièrement du
soutien financier de l'Arménie et dont l'économie est actuellement très
affaiblie, reste incertain.
Il n'est pas clair non plus de savoir comment l'Azerbaïdjan, l'Arménie
et les autorités séparatistes du Nagorny Karabakh pourront travailler
ensemble.
"L'accord obtenu par Moscou (...) est ambigü sur un nombre d'aspects
comme le mandat des forces de la paix russes et l'organisation de la
vie de la population locale, des Arméniens comme des Azerbaïdjanais", a
déclaré à l'AFP Olessia Vartanian, une analyste de l'International
Crisis Group.
"Si cette ambiguïté continue, ce sera potentiellement une source de
tensions", prévient-elle.
- Et l'avenir du Karabakh? -
L'accord de cessez-le-feu n'évoque pas non plus la question la plus
épineuse: l'avenir du Nagorny Karabakh à long terme.
Des décennies de négociations parrainées par la France, la Russie et
les Etats-Unis, médiateurs en tant que membres du "groupe de Minsk",
chargé dans les années 1990 de trouver une issue durable à la crise,
n'ont pas abouti à des résultats concrets.
La Russie a joué un rôle crucial pour mettre fin aux combats récents,
confirmant son statut d'arbitre régional.
Mais l'accord de cessez-le-feu a également montré l'influence
grandissante de la Turquie, alliée sans faille de Bakou, qui mettra en
place avec la Russie un "centre de coordination" chargé de surveiller
le respect de la trêve.
La crédibilité du "groupe de Minsk" est par ailleurs remise en question
par l'Azerbaïdjan, qui a appelé la semaine dernière à exclure la France
de la médiation après le vote par le Sénat français d'un texte
réclamant "la reconnaissance" du Nagorny Karabakh.
Selon des experts, le nouveau statu quo pourrait favoriser la relance
des négociations, la rétrocession des sept districts ayant levé l'un
des principaux désaccords entre Bakou et Erevan.
Mais la méfiance dans la région reste profonde et des décennies
d'inimitié seront difficiles à surmonter. (AFP, 1 déc
2020)
Karabakh: accord turco-russe sur
un centre conjoint d'observation
La Turquie a signé avec la Russie un accord
sur l'établissement d'un centre conjoint d'observation qui aura pour
mission de surveiller le cessez-le-feu au Nagorny Karabakh, a annoncé
mardi le ministère turc de la Défense.
"Un accord a été signé à l'issue des pourparlers sur les modalités
techniques de l'établissement et les principes de fonctionnement du
centre conjoint turco-russe", a déclaré le ministère turc de la Défense
sur Twitter.
"Les efforts nécessaires sont fournis pour que le centre soit
opérationnel dans les plus brefs délais", a-t-il ajouté, sans donner de
détail sur cet accord.
Un mémorandum sur la création d'un centre conjoint de contrôle avait
été signé mi-novembre par Ankara et Moscou. La Turquie avait alors
affirmé que ce centre serait établi dans un lieu choisi par
l'Azerbaïdjan.
L'Azerbaïdjan et l'Arménie ont signé début novembre un accord parrainé
par la Russie qui a mis fin à plusieurs semaines d'affrontements
meurtriers au Nagorny Karabakh, région séparatiste d'Azerbaïdjan à
majorité arménienne.
Pour surveiller le respect de cet accord, qui consacre les gains
territoriaux de Bakou et prévoit l'évacuation par les Arméniens de
certaines zones, Moscou a commencé à déployer une force de "maintien de
la paix".
Dans une motion envoyée le 16 novembre à l'Assemblée nationale, le
président turc Recep Tayyip Erdogan a demandé l'autorisation d'envoyer
des soldats en Azerbaïdjan afin de participer à la mission
russo-turque.
(AFP, 1
déc
2020)
Chypre
et la Grèce / Cyprus and Greece
Ankara condamne l'arrestation d'un employé local
d'un consulat turc en Grèce
La Turquie a condamné vendredi l'arrestation d'un employé de son
consulat sur l'île grecque de Rhodes, accusé d'espionnage au profit
d'Ankara, accusant Athènes de violer les conventions internationales.
"La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques a été violée
par la Grèce", a affirmé le ministère turc des Affaires étrangères dans
un communiqué.
Agé de 35 ans et de nationalité grecque, Sebahattin Bayram est employé
comme secrétaire contractuel au consulat de Turquie à Rhodes. Son
interpellation a été annoncée le 12 décembre.
Les autorités grecques lui reprochent de collecter des informations sur
les mouvements des navires de la marine grecque, fournis par un
deuxième suspect travaillant à bord d'un ferry circulant entre Rhodes
et l'île de Kastellorizo, proche d'environ 1,2 km des côtes turques, et
qui lui aussi a été arrêté.
Les deux hommes ont été formellement placés en état d'arrestation
vendredi.
"Nous sommes préoccupés par les publications dans la presse grecque qui
prennent pour cible notre employé, sa famille et le personnel de nos
représentations en Grèce", a ajouté le ministère turc.
Les tensions entre Athènes et Ankara sont montées d'un cran ces
derniers mois en raison de travaux d'exploration gazière menés par la
Turquie en Méditerranée orientale, dans des zones maritimes disputées
avec la Grèce et Chypre. (AFP, 18 déc
2020)
Un
navire turc au coeur des tensions en
Méditerranée rentre au port
La Turquie a annoncé lundi le retour au
port d'un de ses navires d'exploration dont le déploiement dans une
zone potentiellement riche en hydrocarbures en Méditerranée orientale a
suscité des tensions avec la Grèce et l'Europe.
"Notre navire sismique Oruç Reis a achevé ses recherches lancées le 10
août", a annoncé le ministère turc de l'Energie sur Twitter.
Le navire, selon les autorités turques, a collecté des données sur une
zone s'étendant sur "10.955 km2" en Méditerranée, avant de rentrer au
port d'Antalya, dans le sud de Turquie.
Cette annonce intervient à l'approche du Conseil européen prévu les 10
et 11 décembre et qui abordera la question de la mise en place de
nouvelles sanctions contre Ankara en raison de ses activités
d'exploration controversées en Méditerranée.
La découverte, ces dernières années, d'importants gisements gaziers en
Méditerranée orientale a déclenché une course à l'"or bleu" et réveillé
des disputes territoriales anciennes.
Dans ce contexte, la Turquie a suscité la colère de la Grèce et
de Chypre en menant des missions d'exploration dans des eaux
revendiquées par Athènes et Nicosie.
Les tensions entre Athènes et Ankara se sont intensifiées avec le
déploiement en août par la Turquie de l'Oruç Reis, escorté par des
navires de guerre, pour procéder à des explorations au large de l'île
grecque de Kastellorizo, à deux km des côtes turques.
L'Oruç Reis était déjà rentré au port en septembre, ce qui avait été vu
à l'époque par la Grèce et l'Union européenne comme un signe
d'apaisement.
Mais Ankara avait écarté toute reculade et renvoyé son navire
d'exploration dans la zone le 12 octobre, la Grèce dénonçant alors une
"menace directe à la paix".
Les tensions entre les deux pays s'étaient quelque peu atténuées après
un tremblement de terre qui a frappé les deux pays fin octobre. Mais
l'extension de la mission de l'Oruç Reis a entraîné de vives réactions
de la part de la Grèce, qui demande des mesures de l'Union européenne
contre la Turquie.
(AFP,
30
nov
2020)
Immigration
/ Migration
L'arrestation de l'ancien porte-parole
de l'Ambassade turque en Belgique
Le journaliste
français Guillaume Perrier a rapporté 22 décembre 2020 que l'ex
porte-parole de l'Ambassade de Turquie à Bruxelles, Veysel Filiz,
aurait été arrêté à la frontière turco-bulgare avec 100kg d'héroïne
dans son coffre.
Filiz était
connu en
Belgique avec ses activités au service de la propagande de l'AKP et du
MHP et contre les opposants du régime d'Ankara.
Récemment, il
était
souvent dans les émissions des télévisions turques pro-régime en tant
que porte-parole de l'Initiative des Musulmans Européens pour cohésion
sociale (EMISCO).
Des
soupçons d'espionnage
marocain à la Grande Mosquée à Bruxelles
Certains de ses nouveaux dirigeants, qui avaient été désignés pour
mettre fin à l'influence de l'Arabie Saoudite, sont soupçonnés
d'espionnage pour le compte du Maroc, rapportent vendredi De Morgen et
Het Laatste Nieuws. En avril dernier, la gestion du lieu de culte,
financé depuis des décennies par l'Arabie Saoudite, avait été confiée à
l'Exécutif des Musulmans. Ce dernier avait mis en place une direction
provisoire, dans l'attente du dépôt d'un dossier de reconnaissance.
Cette demande a été soutenue par la plupart des autorités concernées,
mais le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld) a
néanmoins rendu un avis négatif, sur base d'éléments de la Sureté de
l'Etat. Ces derniers font état d'une emprise marocaine qui aura pris la
suite de l'influence saoudienne. De l'espionnage est même évoqué, la
Sureté désignant trois collaborateurs de la mosquée, dont un dirigeant,
comme membres des services de renseignement marocains.
La procédure de reconnaissance est suspendue et le ministre exige de
l'Exécutif des Musulmans qu'il fasse le ménage. L'un des espions
présumés y siège également et fait partie de l'association censée
mettre en place un trajet de formation pour les imams. (LLB, 5 décembre
2020)
Les
députés belges demandent à Ankara de
rapatrier les djihadistes du
Karabakh
La Turquie doit cesser d’interférer dans la guerre du Haut-Karabakh,
ramener au pays les quelque 2 500 mercenaires syriens qu’elle y a
envoyés et mettre son influence au service d’une résolution pacifique
du conflit : tel est le message sur lequel les partis de la majorité se
sont entendus dans une résolution qui a été adoptée mercredi par la
Commission des relations extérieures du parlement belge.
Une résolution nettement plus musclée que la précédente, rédigée durant
l’offensive de l’armée azerbaïdjanaise, mais en retrait de celle qui a
été adoptée par le Sénat français, le 25 novembre 2011. Les sénateurs
français avaient demandé à la quasi-unanimité la reconnaissance
internationale du Haut Karabakh.
Pas de trace de reconnaissance, c’est, selon le coauteur de la
résolution, Michel De Maegd (MR) “la ligne rouge” qui a été imposée par
le gouvernement et le ministère des Affaires étrangères, tenu par
Sophie Wilmès (MR). “ Il faut laisser faire le Groupe de Minsk”,
ajoute-t-il.
La résolution demande instamment à l’UE de soutenir ce groupe codirigé
par la Russie, les États-Unis et la France pour passer à la phase
cruciale, qui est le statut final de l’enclave arménienne en
Azerbaïdjan. Le cessez-le-feu du 9 novembre ne dit rien en effet sur ce
statut final. Le texte condamne “le rôle unilatéral” que la Turquie
veut jouer en dépêchant sur place des soldats, aux côtés de l’armée
azerbaïdjanaise et des quelque 2 000 soldats russes dépêchés au
Karabakh.
Les députés demandent aussi au gouvernement de condamner les crimes de
guerre, “notamment l’exécution sommaire de civils et de prisonniers
ainsi que des traitements dégradants sur les corps de soldats tués”.
Des images vidéo, tournées par des soldats azéris, montrent en effet
que des corps ont été décapités et que des maisons et cimetières ont
été saccagés. La Belgique devrait mettre tout en œuvre “ pour que les
criminels de guerre soient poursuivis dans le cadre de la justice
internationale”.
La résolution était cosignée par André Flahaut (PS), Samuel Cogolati
(Ecolo-Groen), Els Van Hoof (CD&V), Goedele Liekens (Open Vld),
Vicky Reynaert (sp.a) et Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen). Elle a été
votée à seize voix pour, zéro contre et une abstention, celle du PTB.
Elle doit passer en séance plénière d’ici deux semaines. (LLB, 2
décembre 2020)
Le
CCIB est connu pour ses liens étroits avec les
Frères
musulmans
Le gouvernement français va dissoudre le Collectif contre
l'islamophobie en France (CCIF). Quel impact sur son avatar belge?
CCIB était autrefois l'anagramme du Consistoire central israélite de
Belgique et non celui du Collectif contre l'islamophobie en Belgique,
mais ce dernier voulait s'inscrire à tout prix dans le sillage du
Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF). Un modèle aujourd'hui
bien embarrassant. Après avoir mis fin à l'existence légale de
BarakaCity (salafiste), du collectif propalestinien Cheikh Yassine et
de celle des Loups gris (extrême droite turque), le gouvernement
français a notifié sa dissolution au CCIF, qualifié d' "officine
islamiste oeuvrant contre la République" par le ministre de
l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le collectif, qui a huit jours pour faire
valoir ses observations, a déjà redéployé une partie de ses activités à
l'étranger.
Le but réel du CCIB est de faire avancer les
objectifs et le discours des Frères musulmans.
Sans doute le CCIB (1) n'est-il pas le CCIF. La notoriété de Mustapha
Chairi n'est pas comparable à celle de Marwan Muhammad, ancienne figure
de proue du CCIF, qui avait fait scander Allahu Akbar aux participants
d'une marche contre l'islamophobie à Paris. A part le signe des Frères
musulmans effectué dans un cadre privé (quatre doigts levés.... "comme
ses quatre fils"), le président du CCIB maîtrise les codes de
l'associatif bruxellois: discours de gauche, mais objectifs jugés par
certains comme très conservateurs.
Selon plusieurs acteurs ou observateurs de la scène musulmane, anonymes
vu la sensibilité du sujet, l'influence du CCIB est surfaite. Il ne
serait pas reconnu par les milieux salafistes ("trop politique") ni par
les jeunes plus attirés par les notions de race et de genre. "Le CCIB
est discriminant et clivant, estime un islamologue. Sans le voile qui
stigmatise les femmes à qui l'on a fait croire qu'il s'agissait d'une
obligation religieuse forte, le CCIB n'existerait pas." Le CCIB se
défend catégoriquement de se contenter d'un seul sujet. Il travaille
aussi sur "les actes incitant à la haine dans l'espace public ou sur
les réseaux sociaux envers des personnes musulmanes: tête de cochon
devant une mosquée à Gand, tentative d'incendie d'une mosquée à
Colfontaine, croix gammée sur le mur d'une mosquée à Sledderlo,
Winterslag et Kolderbos, profanation de tombes musulmanes..."
Au début des années 2010, Mustapha Chairi milite au Mouvement contre le
racisme, l'antisémitisme et la xénophobie (Mrax) où, avec d'autres, il
défend "les droits fondamentaux et une plus grande participation à la
société en faisant reculer les discriminations". Son objectif est
d'acclimater en Belgique les accommodements raisonnables venus du
Canada. Ceux-ci permettent de déroger à la règle commune pour compenser
une inégalité de nature, comme un handicap physique. Aujourd'hui très
controversé au Québec, ce mécanisme a surtout profité aux minorités
religieuses. Le Mrax a bien failli laisser sa peau dans ces débats. En
2012, avec Hajib El Hajjaji, Mustapha Chairi crée Muslims' Rights
Belgium, que Marwan Muhammad (CCIF) soutient de sa présence lors d'une
Journée internationale de lutte contre le racisme à Bruxelles. Il
s'agit d'un "Mrax musulman" qui recensera les actes antimusulmans. La
plateforme intègre aussi des chiites et des progressistes. En 2014,
Mustapha Chairi fonde le Collectif contre l'islamophobie en Belgique
avec notamment Hajib El Hajjaji et Farida Tahar. Ces deux piliers de
l'asbl sont aujourd'hui mandataires Ecolo, l'un à Verviers, l'autre à
Bruxelles. Chairi a été le secrétaire de la locale Ecolo de
Bruxelles-Ville.
Le CCIB reconnaît avoir demandé au CCIF l'autorisation de s'inspirer de
son logo, "pour respecter les droits d'auteur". Bien qu'il s'en
défende, le CCIF navigue dans les eaux internationales de l'islam
politique. Pour le chercheur français Hugo Micheron ( Le Jihadisme
français, Gallimard, 2020), "le CCIF appartient de manière plus ou
moins assumée à la mouvance intellectuelle "frériste"". Selon une
source sécuritaire consultée par le Vif/L'Express, "le CCIB est connu
pour ses liens étroits avec les Frères musulmans. D'un point de vue
structurel, certains administrateurs du CCIB sont actifs dans les
organisations belges des FM. Idéologiquement, les discours du CCIB
reprennent à leur compte les thématiques rhétoriques des FM ainsi que
leurs chevaux de bataille traditionnels, par exemple, la pénalisation
de l'islamophobie et la lutte contre l'interdiction du foulard dans les
écoles et au travail. Dans ce cadre, le CCIB coopère régulièrement avec
des organisations affiliées à la structure belge et européenne de la
Confrérie".
On songe notamment à Femyso (Forum of European Muslim Youth and Student
Organisations), l'une des institutions coupoles, représentée auprès de
l'Union européenne. Elle partage son siège de la rue Archimède, à
Bruxelles, avec le CCIB. Des "accusations" que le CCIB qualifie de
"graves, grotesques et infondées". Car, "contrairement à la confrérie
des Frères musulmans ou des officines islamophobes, le travail du CCIB
n'est pas centré sur une religion, l'islam, mais bien sur les victimes
de l'islamophobie, à savoir des personnes non musulmanes ou musulmanes,
de toutes tendances confondues (sunnites, chiites, soufis ou alevis),
qui font l'expérience de la discrimination car perçues comme
musulmanes".
Le CCIF et le CCIB ont donc le même logo et parfois les mêmes éléments
de langage, comme l'a relevé l'Observatoire des fondamentalismes. Après
la décapitation de Samuel Paty, le 16 octobre dernier, les deux
collectifs (voir les captures d'écran ci-dessous) ont exprimé leurs
condoléances et réclamé le "silence". Il n'y avait pas de volonté de
créer une polémique, décode le CCIB, mais de faire face "aux
expressions politiques et de leaders d'opinion à tout-va". Une
injonction paradoxale qui est au coeur du logiciel des deux collectifs:
s'étendre beaucoup sur les torts faits aux musulmans, éviter que
l'islam soit mis en cause. Quand des conférenciers connus pour leur
antisémitisme forcené ont été annoncés à la Foire musulmane de
Bruxelles ou à celle de Charleroi, le CCIB est resté muet. Il dit
cependant "avoir informé les organisateurs que des orateurs posaient un
vrai problème".
Collaboration avec la fondation Seta
Chaque année, la fondation turque Seta dresse un état des lieux de
l'islamophobie en Europe auquel contribue le CCIB. En 2018, Mustapha
Chairi s'en est vanté sur sa page Facebook (voir capture d'écran
ci-dessous), avant de rétropédaler ("Nous y avons contribué par les
faits et les dossiers que nous suivons. Mais nous n'avons pas pu relire
la version finalisée et donc nous n'en assumons pas le contenu", texto
du 25 mai 2018, lire Comment le soft power truc passe à l'offensive en
Belgique).
Dans l'édition en question du rapport Seta portant sur l'année 2017, la
volonté de l'Etat belge de reprendre le contrôle de la Grande Mosquée
après les "soi-disant attaques terroristes islamiques" de 2016 était
taxé d'islamophobie. Quant à l'Etat français, il était qualifié de
"policier" et de "fascisant" pour avoir durci sa politique
antiterroriste après les attentats de 2015 et 2016. Masochisme? L'Union
européenne finance le site islamophobiaeurope.com qui accueille ces
rapports incendiaires, tout en précisant que leur contenu n'est pas de
sa responsabilité ni ne reflète nécessairement ses vues.
(Le Vif, Marie-Cecile Royen, 27 novembre 2020)
informations du
mois
passé  Informations
of the past month
Informations
of the past month
Toutes les informations depuis 1976  All informations since 1976
All informations since 1976